Né en 1978, Thibault Isabel est rédacteur en chef de la revue Krisis. Docteur en sciences humaines et essayiste, il collabore à des revues universitaires comme L’Art du comprendre ou L’École des philosophes, ainsi qu’à des revues d’idées comme Éléments ou Rébellion. À travers ses livres, il s’interroge sur les dérives de la civilisation moderne, qu’il accuse de rompre avec la sagesse du monde antique. Sa pensée s’inspire à la fois de Nietzsche, de Confucius et de Proudhon.

PHILITT : La conduite saine du débat public en France est devenue quasiment impossible. Le pluralisme n’existe plus et les opinions jugées scandaleuses sont systématiquement diabolisées. Comment interprétez-vous cette forme de violence, qui pourrait paraître anachronique ? Une société civilisée n’est-elle pas plutôt celle qui ne craint pas la diversité des opinions ?
Thibault Isabel : Tout dépend du modèle de civilisation que vous avez en tête. Du point de vue des civilisations modernes, l’État doit pacifier les mœurs. Dans la vie privée, c’est-à-dire dans l’intimité la plus stricte, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, et nul ne peut vous adresser le moindre reproche. Mais, dans la sphère publique, vous devez autant que possible vous abstenir d’adopter des comportements clivants, d’afficher des préférences trop marquées, de brusquer les autres. Telle est la contrepartie de votre tranquillité privée. Comme dit l’adage : « Chacun chez soi, chacun pour soi, et les bons comptes feront les bons amis. » Bien sûr, vous pouvez vous exprimer dans ce qui reste d’arène médiatique (que les Grecs appelaient l’« agora »). Mais vous ne votez que dans la solitude de l’isoloir, à l’abri des regards indiscrets ! Le monde moderne fait en sorte de ramener le vote à un choix purement individuel, presque à un choix de consommation, qui ne concerne que vous.
Au fond, notre époque se méfie de la liberté d’expression, qui attise les rivalités et les haines, et lui préfère la liberté de conscience, qui n’engage que les individus, seuls face à eux-mêmes. L’État a fait depuis longtemps le pari d’aseptiser notre environnement public, pour limiter les heurts entre individus et communautés. On pourrait multiplier les exemples de ce genre, comme le refus du scrutin proportionnel, la méfiance à l’égard des corps intermédiaires, la pénalisation du « politiquement incorrect », voire la tendance croissante des gouvernants à légiférer sur ce qu’il est bon de croire ou de penser en matière de vérité historique. Mais tout cela n’est en quelque sorte que la face émergée de l’iceberg. Le phénomène se manifeste à un niveau bien plus profond, dans les infrastructures anthropologiques de nos mentalités collectives.
Le modèle antique, grec notamment, était d’une tout autre nature. On adorait les joutes verbales et les concours d’éloquence autant que le pugilat. Débattre et se battre, c’est la même chose, comme le rappelle l’étymologie. La culture du débat a donc disparu parallèlement à la culture du combat, au cours des derniers siècles. Mais cette évolution a surtout transformé notre manière d’être, en nous rendant beaucoup plus timorés. À mesure que le monde se pacifie, les joyeuses altercations d’autrefois prennent une allure traumatisante. S’opposer ne relève plus du jeu, mais du crime ; l’adversaire n’est plus un rival, mais un diable. On règle les problèmes en les dissimulant sous le tapis, au lieu de les prendre à bras le corps. Ceux qui sortent des sentiers battus sont ostracisés ou persécutés. Tout le système les prend en grippe.
Nos démocraties actuelles souffrent d’une obsession liberticide pour la pacification et l’unité. On ne doit certes jamais laisser les pulsions humaines dépourvues d’encadrement, sous peine d’ouvrir la porte au chaos ; mais l’excès d’ordre est tout aussi nuisible : on y perd son âme vigoureuse de citoyen.
Le sens commun a tendance à penser que la civilisation correspond à la disparition progressive de la violence. Vous dénoncez quant à vous cette croyance comme une illusion. Dans quelle mesure la civilisation implique-t-elle nécessairement l’usage de procédés violents ?

Toute civilisation s’efforce jusqu’à un certain point de pacifier les mœurs : c’est d’autant plus vrai des civilisations modernes, qui s’articulent presque exclusivement autour de cet impératif. Pour nous sortir de l’anarchie du monde sauvage, l’État nous impose des lois, qui vont réguler la vie sociale. La violence interindividuelle se trouve dès lors proscrite. Si mon voisin m’insupporte, je n’ai plus désormais la liberté de le tuer. En tout cas, si je le tue, j’aurai à rendre des comptes à l’État, et je finirai en prison. Mais le processus de civilisation n’éradique pas pour autant la violence, qui est consubstantielle à la nature (et donc aussi à la nature humaine). L’État se contente de déplacer la violence, depuis la sphère interindividuelle vers la sphère collective. Il s’arroge ce que Max Weber appelait le « monopole de la violence légitime ». Je n’ai pas le droit de m’en prendre à mon voisin, quand bien même il me rendrait la vie insupportable ; mais l’État en a le droit, lui, si mon voisin est jugé coupable au terme d’un procès. Le condamné terminera alors ses jours derrière les verrous ou sur l’échafaud.
Le monopole étatique de la violence nous préserve de certains vices antiques, mais favorise aussi certaines dérives des sociétés contemporaines. Autrefois, on avait surtout à craindre un mauvais usage de la violence par les individus. Aujourd’hui, il faut plutôt craindre un mauvais usage de la violence par l’État. Nous risquons moins d’être victimes d’un meurtre ; mais nous devons davantage prendre garde aux débordements sécuritaires du pouvoir, à la censure et à la limitation des libertés publiques.
Vous avez souvent pris position en faveur des républiques antiques, contre les républiques modernes. Qu’est-ce qui vous déplaît dans la modernité politique ? Et pourquoi le rapport moderne à la violence vous semble-t-il insatisfaisant ?
La modernité a évidemment beaucoup de qualités remarquables : la justice à charge et à décharge, la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire, etc. Nous sommes parvenus à modérer l’excès d’impulsivité des civilisations antiques. Reste malgré tout à savoir si nous ne sommes pas allés trop loin !
La civilisation moderne substitue un régime juridico-légal, fondé sur le droit, à un régime d’honneur, fondé sur la morale. La différence ne réside pas dans l’utilisation de la violence, qui est commune aux deux régimes ; la différence réside dans le caractère étatique ou interindividuel de la pression civilisatrice. Même les sociétés les plus anciennes étaient régulées. Néanmoins, leur système de civilisation reposait encore très peu sur la contrainte extérieure d’un État, puisque les structures politiques étaient locales et embryonnaires. L’homme était tout au plus régulé, à l’extérieur, par l’influence de sa communauté, et, à l’intérieur, par lui-même. L’un des inconvénients de ce système était d’encourager la violence des individus : quand vous devez vous auto-discipliner, il est clair que vous vous régulez moins que si la police vous surveille en permanence. L’avantage du système, en revanche, était de responsabiliser chacun d’une manière plus forte qu’aujourd’hui : la motivation et l’enthousiasme trouvaient à s’exprimer quotidiennement dans l’existence collective.

C’est ce qui explique l’admirable vitalité des républiques antiques, si chère à la tradition européenne de l’humanisme civique. Nos républiques actuelles sont sclérosées par l’indifférence des citoyens, qui ne se sentent plus impliqués dans la vie publique. L’État représente pour nous quelque chose de lointain, d’impersonnel, d’anonyme : « le plus froid des monstres froids », comme disait Nietzsche. Et c’est ce qu’il est ! L’impersonnalité lointaine et anonyme de l’État moderne garantit sa neutralité dans l’exercice du monopole de la violence. Quand la violence interindividuelle était moins canalisée par les lois, moins encadrée par la répression policière, l’État offrait au citoyen davantage de prise directe sur les décisions de la cité. Le pouvoir n’était pas providentiel, mais mobilisateur. Il n’était pas transcendant, mais immanent. Il n’était pas bureaucratique, mais incarné.
La modernité a pacifié les mœurs, en limitant les ardeurs citoyennes, toujours susceptibles de provoquer des tensions. Bien des comportements et des idées se sont donc trouvés bannis. Le goût de la dispute et du débat, l’apologie de l’héroïsme, le gouvernement de soi-même et l’exigence morale (plutôt que la soumission docile à la loi) sont tous des facteurs potentiels de violence ou de sédition, des facteurs de danger. Mais, s’ils ont leurs mauvais côtés, ils ont aussi leurs vertus. Et, en les éliminant de la civilisation humaine, la modernité nous a privés d’une part de notre énergie.
Dans À bout de souffle, vous faites remarquer que, de manière assez paradoxale, les politiques sécuritaires se développent souvent à mesure que les démocraties se libéralisent. L’idéologie libérale produit-elle nécessairement de la violence ?
Il n’existe que deux modes de régulation du comportement : soit par la morale, comme dans les sociétés peu étatisées de l’Antiquité, soit par la loi, comme dans les sociétés modernes hyper-administrées. On voit là deux modèles distincts de civilisation (tandis que la barbarie se caractérise quant à elle par l’absence de régulation, et donc aussi par le refus ou l’incapacité d’encadrer les pulsions).
Le libéralisme a cette particularité de nous affranchir de la morale. C’est sa raison d’être : il nous libère des impératifs éthiques. Nos rapports avec autrui ne sont plus régis par le bien ou le bon, mais par le calcul d’intérêt, ainsi que l’affirme la fameuse « théorie des choix rationnels ». Seulement, si l’intérêt nous guide plutôt que la morale, la vie sociale risque fort de devenir assez vite une foire d’empoigne. Face au reflux de la morale, il faut accréditer le règne des lois. Plus on libéralise les mœurs, plus on doit en même temps sécuriser la sphère sociale. La police est tenue d’intervenir pour départager les individus, car leur conduite n’est plus policée d’elle-même par le devoir. La violence d’État se substitue à la violence des hommes.
L’État sécuritaire s’impose par conséquent pour garantir les libertés privées, dans un monde où l’on se détourne du devoir public. Cette disposition d’esprit débouche sur une société plus apaisée et moins exigeante. D’un point de vue strictement utilitaire, mieux vaut laisser libre cours à l’égoïsme des hommes, sans chercher à discipliner leur désir ; on se contentera plutôt d’enrégimenter la population sous l’action protectrice et maternante d’un pouvoir policier. En revanche, lorsqu’on compte sur le perfectionnement moral des citoyens, on les sollicite d’une manière épuisante, et l’on risque surtout de propager le chaos social en cas d’échec. Car le modèle ancien de la vertu est très difficile à établir, à tel point qu’il était presque condamné à disparaître au fil de l’histoire. La violence est toujours mieux contrôlée en pratique lorsqu’elle est surveillée ; les lois sont plus efficaces que l’élévation progressive des mœurs. Mais si l’efficacité apporte quantitativement davantage de bienfaits, d’un point de vue matériel, elle affadit qualitativement le caractère sur un plan existentiel. Le citoyen moderne jouit de plus de confort, grâce à l’État ; mais il a moins la possibilité d’épanouir sa vertu. On l’abandonne en quelque sorte à sa propre immaturité individuelle, à sa propre absence de morale et de structuration, pour le civiliser d’une façon artificielle, à travers la violence des contraintes juridiques et de la répression sécuritaire. La civilisation moderne n’est plus à certains égards qu’une forme sophistiquée de barbarie. Elle est à la fois excessive dans l’exigence extérieure d’ordre, et laxiste dans l’exigence intérieure de responsabilité.
Pour rebondir sur l’actualité, comment expliquer que les sociétés compassionnelles que sont devenues les sociétés occidentales soient incapables de « penser » une autre violence que celle qui les frappe ? D’un côté, sentiment hypertrophié de la violence subie ; de l’autre, sentiment atrophié de la violence pratiquée, notamment en Orient.
Votre remarque est très juste. Il existe en effet une exacerbation victimaire de la souffrance, en Occident, qui découle du nouveau régime anthropologique dans lequel nous sommes entrés avec l’essor de la modernité. Nous craignons démesurément la violence, à laquelle nous ne sommes plus habitués depuis que l’État en assume le monopole légitime. Toute expression trop directe des passions nous tétanise, nous effraie. Nous nous méfions de ce qui émeut et divise.

Dans l’Antiquité ou au Moyen Âge, on avait beaucoup moins peur qu’aujourd’hui du danger, justement parce qu’il était quotidien. La rapine, la lutte, la chasse aux animaux ou même la chasse à l’homme faisaient partie des nécessités de l’existence et étaient inscrites dans les structures mêmes de la société. Cette familiarité à l’égard du danger se manifestait volontiers à travers un certain sadisme. Au XVIe siècle, à la Saint-Jean, on avait coutume de brûler vif une ou deux douzaines de chats, en guise de réjouissance populaire. Au contraire, la moindre vue de ce qui pourrait rappeler la violence nous devient désormais insupportable. Nous nous gaussons de notre absence de cruauté, que nous percevons comme un progrès moral ; toutefois, reconnaissons qu’il nous est devenu pénible d’observer un spectacle qui évoque la mort, même dépourvu de cruauté, de sorte que notre répugnance est peut-être moins due à notre charité qu’à notre pusillanimité. Accepterions-nous encore qu’un porc soit servi entier à table, rose et saignant, lors d’un banquet, et que sa dépouille soit découpée devant tous les convives : d’abord la tête, puis les pieds, etc. ? Nous préférons de nos jours, dans notre « bienveillance », que l’animal soit préparé dans l’arrière-salle d’une boucherie, puis servi sous une forme qui nous permette d’oublier qu’il était un être vivant.
Le problème, c’est que toutes les populations du monde n’ont pas le même rapport à la violence. Si nous souffrons d’un excès de civilisation, qui nous rend angoissés et craintifs, voire parfois irresponsables à force de fermer les yeux sur le tragique des choses, d’autres souffrent d’un manque de civilisation, qui les rend impulsifs et dépourvus d’empathie (ce qui relève d’une autre forme d’irresponsabilité). Cette divergence prend également une dimension sociale, à l’intérieur même de nos nations développées. L’intensité de la répression pulsionnelle que s’imposent les individus est en règle générale plus forte dans les milieux aisés, où l’on est habitué à des exigences professionnelles rigoureuses, mieux aptes à favoriser l’établissement de comportements régulés. La surveillance de la police est étroite dans les quartiers tranquilles, et la sécurité bien assurée, de telle sorte que la plupart des Occidentaux éprouvent une grande sensibilité face à la violence, qui ne fait pas partie de leur univers mental. De plus, l’accès à un certain confort rend prudent, tandis que la misère incite à la prise de risques. Il se trouve malheureusement que les inégalités sociales se creusent, depuis la fin du XXe siècle. On voit se constituer des poches urbaines ghettoïsées, où se concentrent des communautés qui n’ont rien à espérer de la vie et pour qui la violence n’est guère plus qu’un jeu. Cela provoque une confrontation entre deux mondes que tout oppose : un monde qui craint les altercations et un autre qui n’en a cure, au point même de les rechercher parfois, pour s’amuser.
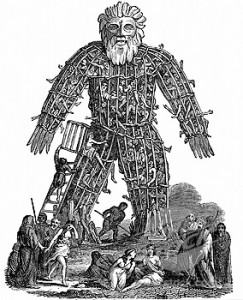
Une des particularités du monde moderne, écrivez-vous, est qu’il tend à dissimuler les morts, tandis que les sociétés traditionnelles les intégraient à la vie de la communauté. Pourquoi cette évolution ?
L’historien Philippe Ariès parlait de la « mort inversée » des modernes, qui ont expulsé le tragique hors du cours normal de la société pour ne pas en perturber le rythme. Nous ne craignons pas il est vrai de laisser les personnes âgées terminer leur vie dans de froides chambres d’hôpital, et les cérémonies funéraires se déroulent maintenant dans des cimetières isolés. On n’imagine plus des pleureuses gémir à grand fracas au milieu des rues pour avertir toute la population du départ de celui qui s’est éteint, comme on klaxonne pour célébrer un mariage. Quant à laisser une chaise et une assiette vides à destination des défunts lors des fêtes, voilà qui paraîtrait plus morbide encore ; on sait que cette coutume était pourtant courante dans le passé, notamment chez les peuples celtes.
Le christianisme moderne sanctifie la vie (au sens de la survie biologique) : chez les peuples chrétiens, la mort apparaît sous un jour particulièrement détestable et effrayant, qu’il s’agit même de conjurer par une « vie après le trépas », dans la paix éternelle de Dieu. Le paganisme antique envisageait au contraire la mort comme la condition de possibilité de la vie, au même titre que la vie est la condition de possibilité de la mort. Tout dans la nature relève d’un grand cycle : la fleur doit s’épuiser et mourir pour que son pollen se répande et féconde la terre. D’où le culte des morts, qui revient à honorer à la fois l’origine et la destination de la vie. D’où aussi l’acceptation de la violence dans la nature, qui explique pourquoi la vie ne peut qu’être une conséquence de la mort : c’est la même nature innocente qui engendre quand elle détruit, et qui détruit quand elle engendre. Accepter la violence et accepter la mort vont symboliquement de pair.
Nous craignons la mort à notre époque parce que notre existence s’est dévitalisée. Nous avons désappris la violence, lorsque l’État moderne nous a ordonné de le faire. Or, la mort est ce qu’il y a de plus violent au monde : nous sommes donc obligés de la refouler pour trouver encore le courage de vivre, alors que les héros d’Homère s’en nourrissaient pour se couvrir de gloire.
La violence brute est une mauvaise chose, bien sûr. Tout ce qui est brutal est médiocre. La vie doit être cultivée et raffinée, sans quoi elle est barbare. Il faut privilégier les formes sublimées de la violence, comme la création artistique ou philosophique, l’ambition, le sport ou la participation aux débats publics. Mais il faut prendre garde aussi, en disciplinant la violence, de ne pas l’abolir. La violence sublimée est une force positive de vie. Une fois métamorphosée et mûrie, elle ne détruit plus capricieusement ce qui nous entoure, mais contribue plutôt à nous élever nous-mêmes.
Dans Le Paradoxe de la civilisation, vous expliquez, en vous appuyant sur les sagesses chinoises, que l’homme civilisé est celui qui a réconcilié en lui la nature et la culture. La modernité compromet-elle l’homme civilisé en voulant nier le naturel ?
On avait coutume de dire en Chine : « La culture tient à la nature, la nature tient à la culture, comme sa bigarrure tient au tigre. Arrachez ses poils à la peau d’un tigre ou d’un léopard, et il ne vous reste que la peau d’un chien ou d’un mouton. » Confucius lui-même mettait déjà ses contemporains en garde contre la tentation de dresser l’une contre l’autre des forces qui gagneraient en fait à s’infuser mutuellement : « Quand le naturel l’emporte sur la culture, cela donne un sauvage ; quand la culture l’emporte sur le naturel, cela donne un pédant. L’exact équilibre du naturel et de la culture produit l’honnête homme. »
L’Occident moderne, influencé à la fois par le christianisme paulinien et le rationalisme des Lumières, a voulu construire une civilisation qui nous arrache au corps et à la nature. Mais si l’homme a besoin de tendre vers le ciel, il doit aussi préserver les racines qui le relient à la terre. Nous ne devons pas livrer notre humanité à ses instincts naturels, sous peine de plonger dans la barbarie ; mais, si nous négligeons nos passions, nous nous dessécherons dans une culture atrophiée.

De même, l’harmonie procède selon vous d’un jeu d’équilibre entre des forces contraires. La modernité semble avoir choisi une conception monolithique du bien et du mal contre l’harmonie. En quoi est-ce un risque ?
L’harmonie traditionnelle envisage la morale d’une façon équilibrée. Il faut tenir compte à la fois de la nature et de la culture, du corps et de l’esprit, de la violence et de la paix. À l’inverse, le dualisme chrétien, qui s’est prolongé dans l’idéalisme sécularisé des Lumières, privilégie les logiques antithétiques : il choisit alors la culture contre la nature, l’esprit contre le corps et la paix contre la violence. Mais il refoule du même coup tout un pan de ce que nous sommes, et tout un pan de ce qu’est la vie. Si bien que ce refoulé sera un jour condamné à surgir de nouveau, sous une forme morbide.
Nous sommes entrés dans une civilisation de l’excès. Notre placidité collective engendre en nous – et autour de nous – un besoin croissant de stimulation frénétique, comme si nous voulions réveiller nos consciences éteintes et notre inaptitude au débat à grands coups de polémiques stériles et hystérisées. Le dialogue public est devenu tellement insipide et ennuyeux que nous recherchons avidement la moindre source d’agitation : nous passons notre temps à stigmatiser les dérapages verbaux d’insupportables trublions médiatiques, qui n’ont de cesse pourtant de nous fasciner par devers nous. C’est alors la surenchère à l’insulte ou à la caricature, au point que l’aseptisation du débat dominant conduit à la radicalisation tout aussi pathologique de ses marges ! Ce constat s’applique d’ailleurs à tous les champs de la vie sociale, qui sont perpétuellement tiraillés entre des excès contradictoires. Notre peur aveugle de la violence entretient ainsi des poches souterraines de barbarie, où prolifère le goût du désordre et de l’agression : nous ne supportons plus la vue d’un cadavre, mais prenons un plaisir morbide à regarder des reportages sur les tueurs en série ou les massacres de masse. Et notre soif sécuritaire de contrôle engendre des mouvements compensatoires de rébellion, d’insubordination, voire d’atomisation urbaine, qui menacent de plus en plus gravement l’ordre public.
Les contraires s’aimantent. Loin de s’opposer, ils se rejoignent. Mais à force de se maudire, de s’exclure et de se diaboliser, ils cèdent l’un et l’autre à ce qu’il y a de plus extrême en eux. La modération nous sauve de nous-mêmes ; elle rétablit l’équilibre fragile de l’harmonie et nous épargne de périlleux retours de balancier. C’est une antique loi de la nature que nous devrions rapprendre des Grecs et des Chinois si nous espérons faire durer un peu notre vieille civilisation fatiguée.
