Pierre Le Vigan est urbaniste et essayiste. Il a publié une dizaine d’ouvrages dont Inventaire de la modernité (Avatar, 2007) et La tyrannie de la transparence (Aencre, 2011). Il vient de faire paraître Achever le nihilisme (Sigest, 2019), essai dans lequel il se propose d’établir une généalogie du nihilisme en s’appuyant sur deux penseurs majeurs : Nietzsche et Heidegger.

PHILITT : Dans la préface qu’il a fournie à votre ouvrage, Rémi Soulié affirme que, selon Heidegger, l’histoire de la philosophie serait « depuis Socrate » hantée par le nihilisme qui est, fondamentalement, oubli de la question de l’être. Pourtant, la philosophie du Dasein se pense comme un retour à l’ontologie d’Aristote, le premier à avoir pensé la question de l’être en tant qu’être. Dès lors, ne fallait-il pas plutôt dire « depuis Aristote » ?
Pierre Le Vigan : Selon Heidegger, la philosophie est hantée par le nihilisme et caractérisée par l’oubli de la question de l’être « depuis Socrate » car il inclut Socrate, et bien sûr Platon, sans lequel Socrate ne serait pas ou très peu connu, dans cet oubli de l’être. Il est vrai que, dans le même temps, Heidegger s’inscrit dans la lignée d’Aristote, en posant la question de l’être comme origine, comme source des étants, et non comme étant suprême. Pour dire les choses simplement, les étants sont les choses, toutes les choses du monde, l’être est la source, ou l’origine des choses, de toutes les choses. L’être donne l’étant, ou encore, l’être s’adonne à l’étant. Dans la perspective d’Heidegger, Aristote est comme une parenthèse grâce à laquelle on a, un temps, cessé d’oublier l’être. À l’exception d’Aristote, l’oubli de l’être s’est installé (si on peut employer cette formule paradoxale) dans la philosophie occidentale, depuis que Socrate a mis fin, par définition, au cycle des présocratiques, qui pensaient cette question de l’être, nous dit Heidegger. En voulant enlever son épaisseur au mystère de l’être, Socrate nous a en fait éloigné de sa compréhension, mais aussi de sa lumière. Cet oubli de la question de l’être aboutit au nihilisme selon Heidegger. Cet oubli est aussi un éloignement. L’oubli relève du temps, l’éloignement relève de l’espace. Plus nous sommes éloigné de l’être, moins nous le voyons, parce que moins il nous éclaire. Si on préfère une autre métaphore, moins la source nous désaltère, plus nous oublions son existence (et moins nous savons où elle se trouve).
À un niveau supérieur de réponse, on doit souligner que l’étant n’est pas le contraire de l’être, ni le non-être, mais l’être donné, l’être en ses limites, tandis que l’être, par définition, n’a pas de limites. Enfin, si Heidegger fait retour à Aristote, cela ne signifie pas que sa définition de l’être soit la même que celle d’Aristote. Le « premier moteur immobile » d’Aristote, celui qui meut toute chose, devrait, de même que les Idées du monde supra-sensible chez Platon, être assimilé à une métaphysique, selon Heidegger. Or, métaphysique veut dire oubli de l’être. Comment éviter cette impasse ? La tâche de l’homme en tant qu’être-là (Dasein) est de faire en sorte que le monde des choses n’entrave pas l’accès à l’être (ce qui serait l’existence inauthentique), mais, au contraire, soit le mode d’être de l’être. « Car le monde et les choses ne sont pas l’un à côté de l’autre, chacun, ils passent l’un à travers l’autre » (Acheminement vers la parole).
Votre propos s’articule autour d’une distinction entre nihilisme actif et nihilisme passif. Pouvez-vous en résumer les implications ?
La distinction entre nihilisme passif et nihilisme actif se trouve chez Nietzsche. Le nihilisme passif consiste à considérer que le monde existant n’a pas de valeur, ne vaut rien, et qu’il y a peut-être un monde qui vaudrait quelque chose mais qu’il n’existe pas, ou est impossible. Le nihilisme passif aboutit à considérer que la vie est un mauvais moment à passer, en se protégeant de la vie. Selon le nihilisme passif, la vie, outre qu’elle ne vaut rien, ne signifie rien, et ne va vers rien. Il est difficile de ne pas caractériser le nihilisme passif comme étant aussi une humeur (noire), et pas seulement un point de vue. Cette humeur est pessimiste, elle est marquée par la fatigue de vivre, l’ennui, la désillusion, la déception.
Le nihilisme actif est selon Nietzsche le nihilisme qui fait tomber ce qui doit tomber : les valeurs inférieures, les fausses valeurs. C’est un nihilisme qui est nécessaire pour faire la place aux valeurs supérieures. Le nihilisme actif est indissociable d’un jugement de valeur : qu’est-ce qui doit tomber ? De quoi doit-on accélérer la chute ? C’est ici que l’on peut (ou pas) se séparer de Nietzsche : dans les jugements de valeurs. On voit la différence avec le nihilisme passif : ce dernier inclut au contraire un jugement de valeur qui est : rien ne vaut. Le nihilisme passif ne mène donc à rien d’autre qu’à lui-même. Le nihilisme actif, au contraire, est une étape. Par quoi remplacer ce qu’il détruit ? C’est toute la question. N’oublions pas que quand Nietzsche s’écrie : « Dieu est mort, et c’est nous qui l’avons tué », c’est un cri d’inquiétude bien plus qu’un cri de joie.

Vous affirmez que Nietzsche et Heidegger « ont fondé la problématique classique du nihilisme ». Pourtant, vous connaissez le rôle décisif de Dostoïevski sur cette question et son influence sur Nietzsche. Dostoïevski, qui est antérieur aux deux philosophes, n’a-t-il pas participé à cette fondation ?
Stavroguine, dans Les Démons de Dostoïevski, explique non seulement qu’il a perdu le sentiment du bien et du mal, mais la croyance en leur existence. Si le bien et le mal n’existent pas, ou sont équivalents, il y a de quoi être nihiliste. Si le bien et le mal n’existent pas, c’est que rien ne vaut rien. Ou bien que seule vaut la volonté. Nietzsche a eu cette tentation d’ériger la volonté en nouveau totem métaphysique. Mais il dit « par-delà bien et mal », et ce n’est pas la même chose que de nier ces notions. Il leur enlève une valeur absolue. Il ne les nie pas. Stavroguine se veut au-delà de la morale comme fondement, et même au-delà de l’interprétation morale des phénomènes. Il n’échappe pas, pourtant, après un viol commis par lui, à une sorte de sentiment de remord. Comme quoi il n’est décidément pas aisé de s’installer au-delà du bien et du mal. Ce n’est pas un hasard si l’au-delà du bien et du mal se situe toujours ou presque du côté de la bassesse. Si le bien est équivalent au mal, c’est une raison de faire le mal bien plus qu’une raison de faire le bien. C’est ce que montre Dostoïevski, ennemi du nihilisme, mais ennemi intime, le connaissant très bien. En effet, Dostoïevski a compris les nihilistes, il a même été l’un des leurs, à peu de choses près. Il a été impressionné par le Catéchisme du révolutionnaire de Netchaïev. Ce faisant, il refuse une interprétation trop large de la notion de nihilisme. Selon Dostoïevski, cette notion ne concerne pas tous les ennemis de l’autocratie, ni tous les partisans de la libération d’un peuple malheureux. Surtout, Dostoïevski se dresse contre le vertige nihiliste. Il le rejette. Non, tout ne vaut pas rien. Tout n’est pas à détruire dans ce monde. Tout n’est pas à nier.
Avant Les Démons (1871) de Dostoïevski, c’est Tourgueniev, avec Pères et fils (1862) qui avait mis en scène un personnage nihiliste avec Bazarov. Ses idées ? Le refus de toutes les valeurs traditionnelles : « Un nihiliste, c’est un homme qui ne s’incline devant aucune autorité, qui ne fait d’aucun principe un article de foi, quel que soit le respect dont ce principe est auréolé. » Ce refus s’accompagne d’un scientisme : « L’important est que deux fois deux font quatre, et tout le reste n’est que du vent. » De son côté, Tchernychevski dira dans Que faire ? (1862-63) : « La nature aussi c’est du vent, au sens où tu entends ce mot. La nature n’est pas un temple, mais un atelier pour que l’homme y travaille. » « Un bidon de pétrole vaut plus que Raphaël », dit un personnage des Démons. Ni religion, ni art, que la science. Pas d’avenir non plus : le nihiliste vit dans le présent. « L’avenir, c’est l’œuvre des générations futures », est-il écrit dans le Catéchisme du révolutionnaire de Netchaïev. « Notre affaire, c’est la destruction passionnée, totale, implacable et universelle. » (les citations sont extraites de la magistrale étude de Jacques Catteau, De l’esprit du nihilisme chez Dostoïevski).
Dans Les carnets du sous-sol, Dostoïevski fait l’apologie du désir, « expression de la totalité de la vie ». C’est là le remède contre le nihilisme. Sans doute le seul remède. Car le nihilisme n’est pas une menace extérieure. Il est en nous et a toujours été en nous, relève Dostoïevski. La liberté même, c’est la liberté d’être nihiliste. Pas de liberté sans risque du nihilisme. Un personnage des Démons, Chigaliov, explique très bien : « Partant de la liberté illimitée, j’aboutis au despotisme illimité. » Avec le nihilisme, on part du refus de la souffrance d’un seul, et on aboutit à la souffrance de tous. C’est que, là encore, le nihilisme est un présentisme, il veut tout, et tout de suite. Il ne donne pas le temps au temps. Il préfère l’instant à la durée. Pire, il ignore la durée. Les principes généraux tuent aussi les cas particuliers, pour le nihiliste. Un personnage de Dostoïevski dit : « Plus j’aime l’humanité en général, moins j’aime les gens en particulier, comme individus… » Et encore : « Qui aime trop l’humanité en général est en grande part peu capable d’aimer l’homme en particulier. »
Vous soulignez justement la contradiction majeure du nihilisme qui nie mais « affirme une négation ». Cette contradiction entre la fin (nier toutes les valeurs) et le moyen (valoriser la négation comme méthode) est-elle indissoluble ?
Il semble qu’effectivement, le nihilisme se caractérise par cette affirmation d’une négation. On n’affirme qu’une seule chose, la négation, mais cette négation concerne toutes les choses. Un nihilisme partiel n’est pas du nihilisme. Dans le cas du nihilisme passif, il y a une sorte d’optimisme du nihiliste : les choses vont aller en s’aggravant. Le pire est certain, dit l’optimiste. Ce qui va mal va aller encore plus mal. Ce qui n’a pas de sens va être encore plus dépourvu de sens. Ce nihilisme passif entretient une certaine proximité avec le pessimisme. Le nihiliste actif est plus contradictoire que le nihiliste passif (ou tout simplement moins complètement nihiliste). En effet, il ne croit pas que la destruction soit vaine. Autrement, il ne la prônerait pas. « Le nihilisme est non seulement la croyance que tout mérite de périr, mais qu’il faut détruire », dit Nietzsche. En ce sens, le nihiliste actif serait plus radical que le passif. Mais est-il plus radicalement nihiliste ? Ou ouvre-t-il la voie à une refondation (des valeurs) ? Croire encore en un « il faut », c’est ne pas être nihiliste. Détruire au nom d’une valeur supérieure (ou de plusieurs), c’est ne pas être réellement nihiliste. (Ne croyons pourtant pas que cela ne fait pas de dégâts. Aussi bien le national-socialisme que le communisme, dans sa forme euphorique, avec Lénine, puis crispée, avec Staline, croyaient à des valeurs, qui n’étaient bien entendu pas les mêmes, et ces deux régimes non nihilistes ont pourtant beaucoup détruit. Tout aussi manifeste, et beaucoup plus durable, est le travail continu de destruction-innovation du capitalisme mondialisé, dont l’idéologie est pourtant, non pas le nihilisme, mais le progrès).
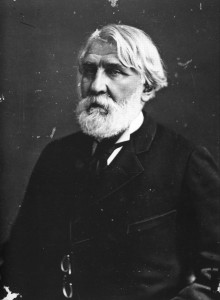
Si l’on prend l’exemple des premiers nihilistes russes, comme Pissarev ou Bazarov (le héros de Pères et fils), on constate qu’ils ne croient pas en rien. Ce sont des matérialistes et des positivistes. Pourquoi ont-ils pris le nom de nihilistes ?
Si on est très optimiste, on dira que les nihilistes russes se sont appelés ainsi, bien qu’ils aient cru en la science, parce qu’ils avaient compris que la science ne pense pas, et que, croire en la science, c’est croire en rien. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas pratiquer la science, mais signifie que la science n’apporte pas de sens en tant que telle. Mais les nihilistes russes, pour la plupart, étaient scientistes : ils étaient donc en pleine contradiction. Pour apporter une réponse plus précise, on constate que la génération de ceux qui eurent 20 ans en 1860 nourrit une contre-culture, et que celle-ci prend comme nom le nihilisme comme négation de toutes les valeurs surplombantes, de toutes les valeurs héritées, et de tous les grands mots. Bazarov, le personnage de Tourgueniev dit : « Notre génération ne se laisse plus avoir par les grands mots […] : aristocratisme, libéralisme, progrès, principes – pensez donc combien de mots étrangers […] et inutiles ! Le Russe n’en a pas besoin même gratis. » Comme le rappelle Michael Confino (Les nihilistes russes des années 1860), le mot nihiliste apparaît en Russie dés la fin des années 1820. Il n’a pas été inventé par Tourgueniev même si ce dernier a contribué à lui donner une grande popularité. Le nihilisme russe se veut anti-religieux, mais il prend la forme lui-même d’une croyance. Celle-ci a quelque chose d’apocalyptique. Scientiste et matérialiste, le nihilisme russe n’est pas pour autant, en général, partisan de l’éducation des masses. Il laissera cela aux bolcheviques. L’éducation suppose un projet et les nihilistes russes vivent dans un présent, entièrement voué à la destruction, et faisant profession d’amoralisme. Le vrai nihiliste ne croit pas à un monde idéal futur, contrairement à Dobrolioubov, qui, de ce point de vue, n’est pas totalement nihiliste. Dans la contre-culture des nihilistes russes, il y avait toutefois l’idée d’une éducation personnelle à la liberté d’esprit, qui n’était pas nihiliste au sens propre puisqu’ils ne niaient pas le caractère réel et bénéfique de la liberté individuelle. On s’éloignait alors de la pureté de la doctrine pour former une contre-culture hétérogène.
Par ailleurs, existe-t-il des nihilistes parfaitement cohérents ? Des nihilistes qui ne trouveraient refuge ni dans le matérialisme, ni dans l’individualisme ni même dans le suicide ? En bref, peut-on imaginer un nihiliste qui ne croirait vraiment en rien, pas même en la négation ?
On peut imaginer des nihilistes non scientistes, ce serait même cohérent de ne croire pas plus à la science qu’en l’autorité héritée d’un roi ou d’un empereur. Si rien n’a de valeur, comment trouver de la valeur à la science, alors que le monde actuel, et même celui du XIXe siècle, était déjà façonné par des découvertes scientifiques, et par l’invention de techniques ? Donc, être nihiliste aurait dû déjà aboutir à ne pas croire à la science, contradiction que n’ont pas vu la plupart des nihilistes russes des années 1860, qui étaient pour la plupart scientistes, en partie du fait d’une réforme de l’éducation faite par le régime tsariste, preuve que ces nihilistes avaient un regard critique limité sur leurs propres conditions de formation.
On peut toutefois imaginer un nihilisme qui n’affirmerait pas une négation. Ce serait un nihilisme qui pense que la négation s’affirme elle-même, que la négation est le principe même du réel. Or, cette conception existe, et c’est la coïncidence des contraires. C’est une idée développée surtout par Nicolas de Cues. On la trouve dans l’Antiquité, avec Pythagore, Empédocle, d’autres présocratiques. Soit les contraires s’attirent, soit ils s’équilibrent, soit ils s’annulent. Cette idée a aussi été développée par les néo-platoniciens. Dans cette conception, la coïncidence des contraires se trouve à un niveau supérieur de la pensée : le niveau le plus bas de la pensée, qui est celui de la raison, obéit encore au principe de non-contradiction ; le niveau au-dessus, l’intellect, n’y obéit plus et permet la coïncidence des contraires ; il amène au niveau supérieur, le divin, qui est l’absorption des contraires l’un dans l’autre. Une telle philosophie représente, en un sens, un nihilisme philosophique, non programmatique, car chaque chose trouve dans son complémentaire opposé le principe de sa négation. Maitre Eckhart écrit ainsi : « Comme la force du ciel n’opère nulle part autant que dans le fond de la terre dans l’absence de tout élément, quelque inférieur qu’il se trouve, car il [le ciel] a la plus grande opportunité d’opérer là […]. Ce qui dans l’âme est le plus élevé de tout, cela est dans ce qui est le plus bas, car c’est le plus intérieur de tout, comme pour celui qui veut aplatir un objet rond ce qui est le plus élevé devient le plus bas. » Le haut devient le bas, l’inférieur le supérieur, l’être le néant. Les choses ne cessent de se déverser en leur contraire, et de s’inverser, en une négation perpétuelle, mais une négation qui est métamorphose et renaissance. Ce peut être un nihilisme radical, mais très éloigné du sens commun du nihilisme passif, lié à l’ennui et à l’ « à quoi bon », et du nihilisme actif, lié à la rage de destruction.
Selon Nietzsche, il est nécessaire de détruire, dans un moment nihiliste, les fausses idoles (celles de la métaphysique, de la morale) pour retrouver le « sens de la terre ». Encore une fois, l’utilisation du mot nihilisme est problématique puisque l’ambition de Nietzsche, partisan d’un grand « oui » à la vie, est de refonder. Dès lors, Pourquoi Heidegger considère-t-il Nietzsche comme un « nihiliste accompli » ?
Nietzsche ne se veut aucunement nihiliste. Sa volonté est d’affirmer la vie, ce qui passe selon lui par un moment nihiliste, qui n’est qu’une étape, et non une fin en soi. Cela ne convainc pas Heidegger. Selon lui, Nietzsche ne clôt pas l’ère des nihilismes, mais l’accomplit en proposant, après Dieu, le socialisme, le progrès, une nouvelle idole, qui serait la volonté de puissance. Regardons-y de plus près. La volonté de puissance est chez Nietzsche l’essence même de la vie. Elle équivaut à la vie, à l’affirmation de la vie, à l’être même. « L’essence la plus intime de l’être est la volonté de puissance », dit Nietzsche. La volonté doit s’orienter vers la puissance, qui lui est interne.
La volonté vers la puissance (c’est l’expression exacte de Nietzsche) est le fait que la puissance se tourne vers ce qu’il y a de plus fort en son intérieur, et de plus intérieur au sein de sa force. C’est la volonté se dévoilant en tant qu’elle est la volonté de vie et la vie. La volonté de puissance n’est pas un moteur extérieur à la vie, ce n’est pas un arrière-monde (qui commanderait le monde visible), ce n’est pas une nouvelle métaphysique selon Nietzsche (et on sait qu’Heidegger ne sera pas convaincu par Nietzsche sur ce point). La volonté de puissance est le vouloir-vivre sans lequel il n’y a pas de vie. Cette volonté constate ce qui est, elle a une dimension ontologique. Mais elle a aussi une dimension axiologique. Elle dit ce qui a le plus de valeur. Plus de volonté de puissance veut dire plus de vie et donc plus de valeur. Nietzsche prétend, tout autant que le fera Heidegger, en finir avec toutes les métaphysiques. On peut se demander si la critique de Nietzsche par Heidegger n’est pas déformée par le contexte historique : il s’agissait pour Heidegger de critiquer, à court terme, toute interprétation nationale-socialiste de Nietzsche et, à plus long terme, toute mise à disposition de la volonté de puissance au service de l’arraisonnement technique du monde.
