Dans La Peur en Occident, l’historien Jean Delumeau explore les craintes des sociétés européennes entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle. En particulier, la peur des épidémies, qui explose après la Peste Noire, a profondément marqué la psychologie et la culture occidentales de son empreinte.

En 1714, l’érudit italien Muratori, auteur d’un traité sur la manière de se gouverner en temps d’épidémie, affirme : « L’appréhension, la terreur et la mélancolie sont, elles aussi, une peste, car elles abattent notre optimisme et disposent la masse des humeurs à recevoir facilement et d’une certaine façon à attirer de loin le poison qui règne. » Au-delà d’un témoignage sur les conceptions médicales du temps, qui voyaient dans l’angoisse l’un des facteurs de la contamination par la peste, cette source révèle l’obsession avec laquelle la pensée occidentale s’aventure, du XIVe siècle au XVIIIe siècle, à étudier la peur, à la disséquer, à la dépeindre. L’Europe de l’époque moderne se caractérise, d’après Jean Delumeau, par une véritable peur de la peur. L’historien retrace ainsi, dans La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles). Une cité assiégée, cette « montée de la peur en Occident à l’aube des temps modernes ».
Certes, toute société est marquée par la peur et, pourrait-on même dire, fondée sur la peur. Certaines peurs sont communes et constituent ainsi un référent social partagé par tous. De la peur de la nuit à la celle de la mer, en passant par la peur du voisin ou de l’étranger, les « peurs du plus grand nombre » qui caractérisent l’homme médiéval sont d’ailleurs similaires à celles de bien d’autres sociétés, qu’elles soient occidentales ou non. Delumeau se fait ici anthropologue et décèle ce qui, derrière des manifestations contingentes, relève des imaginaires et des mécanismes de pensée communs à de nombreuses civilisations. C’est ainsi que la crainte de l’innovation, partagée par les pays catholiques et, contrairement à un tenace lieu commun, protestants, doit être vue comme une garantie de la préservation de la communauté. La peur des maléfices, en particulier du nouement de l’aiguillette, par lequel un voisin malveillant rendrait les mariés stériles ou impuissants, doit être vue comme le contrepoint de l’insistance des sociétés d’Ancien Régime sur la fertilité et la perpétuation des générations. L’omniprésence des revenants, par exemple lors de la vague d’apparition de vampires à la fin du XVIIe siècle en Hongrie, Silésie, Bohême, Moravie, Pologne et Grèce, ne distingue pas les sociétés occidentales des autres sociétés traditionnelles, animistes, dans lesquelles les contacts entre vivants et morts, fréquents, permettent d’affirmer la prégnance du passé et de lier ainsi les générations.
La psychose de la peste
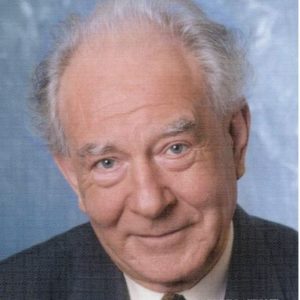
Si ces peurs communes sont le fondement de nombreuses sociétés, l’Occident propose, à partir du XIVe siècle, une trajectoire qui lui est propre, marquée par un « climat de peur ». Au-delà de la seule peur, qui est crainte d’un objet identifié, l’Europe du Bas Moyen Âge se caractériserait en effet, pour Delumeau, par une « angoisse », c’est-à-dire une crainte sans réel objet, un état d’esprit et un climat qui se généraliseraient à la chrétienté entière : « l’accumulation des agressions qui frappèrent les populations d’Occident de 1348 au début du XVIIe siècle créa, de haut en bas du corps social, un ébranlement psychologique profond dont témoignent tous les langages du temps — mots et images ». C’est précisément cette « conjonction de peurs » par laquelle « une civilisation se sentit “mal à l’aise” » que Delumeau se propose d’appeler « la Peur ». Or, pour l’historien, cette Peur est en grande partie causée par la Peste Noire de 1348-1351 et ses répliques successives, comme la peste de Venise et de Milan de 1630, celle de Londres en 1665 ou encore celle de Marseille en 1720.
Les épidémies, de 1348 à 1720, sont une menace permanente pour les villes européennes. Si, d’après les sources, la peste semble avoir disparu d’Europe depuis le IXe siècle, elle devient à nouveau récurrente à l’aube des temps modernes. Entre le XIVe et le XVIe siècle, elle se manifeste dans au moins une ville européenne presque chaque année. En France par exemple, on recense environ une poussée de peste tous les dix ans entre 1347 et 1536, puis une tous les 11,6 ans entre 1536 et 1670. Chaque fois, une hécatombe est à déplorer. La Peste Noire du milieu du XIVe siècle ampute ainsi, d’après le chroniqueur Jean Froissart, « la tierce partie du monde ». Lors de cet épisode, l’Angleterre aurait perdu 40% de ses habitants. Florence a sans doute perdu 30% de sa population, tandis qu’Albi et Castres voient près de la moitié de leurs habitants mourir. Ce chiffre atteint même 70% pour Hambourg. Les épidémies suivantes n’en sont pas moins meurtrières. Ainsi, en 1720, Marseille perd environ la moitié de sa population.
Mais, surtout, la peste frappe par sa rapidité. Le carme parisien Jean de Venette note ainsi que les personnes atteintes « n’étaient malades que deux ou trois jours et mouraient rapidement, le corps presque sain. Celui qui aujourd’hui était en bonne santé, demain était mort et porté en terre ». Les sources dépeignent le chaos inimaginable provoqué par la peste : dans les rues s’entassent « des corps monstrueux, les uns enflés et noirs comme le charbon, d’autres également enflés, bleus, violets et jaunes, tous puants et crevés, laissant la trace du sang pourri ». La ville se remplit de pleurs, de cris et de lamentations. Les fosses peinent à accueillir les charrettes de morts que l’on tente d’enterrer en masse. Les moribonds agonisent dans les rues ou sont parfois confondus avec les morts et mis dans les charrettes. Des hommes, dont on ne sait s’ils sont malades ou non, errent seuls ou en groupe à la recherche de trop rares aliments. Les observateurs, stupéfaits, montrent que la mort saisit sans acception de sexe, de statut social ou de mérite, même s’ils notent aussi que les milieux populaires sont souvent les plus atteints. Dès lors, il est aisé de s’accorder avec Delumeau sur le fait que la « peste […] était donc, même pour les survivants, un traumatisme psychique profond ».
La désagrégation de la société

Mais les individus ne sont pas les seules victimes de la peste. La société entière est déstructurée par les phénomènes épidémiques. C’est pourquoi, lorsqu’apparaissent les premiers cas, les autorités préfèrent refuser de voir le danger. Les médecins convoqués, qui veulent se rassurer eux-mêmes en rassurant la population, montrent généralement dans un premier temps qu’il « ne s’agit pas de la peste à proprement parler ». Ainsi que le dit Delumeau : « Nommer le mal, c’eût été attirer et abattre l’ultime rempart qui le tenait en respect. » Puis, lorsque l’évidence est indéniable, la panique s’empare de la ville. Les riches, qui sont les premiers à fuir, sont vite suivis des masses, ce qui suscite l’affolement collectif. Les fuyards se bousculent, se pressent à des portes que l’on ferme bientôt définitivement.
La cité est alors mise en quarantaine et, parfois, assiégée par des troupes qui vérifient que rien ni personne n’en sort. Les cadres sociaux et familiaux habituels sont abolis : « L’insécurité ne naît pas seulement de la présence de la maladie, mais aussi d’une déstructuration des éléments qui constituaient l’environnement quotidien. Tout est autre. » La ville, déserte et silencieuse, voit quelques rares passants errer dans des rues mortes. Les maisons vides ou les cadavres sont pillés par des brigands improvisés. Il est vrai que les autorités sont désormais suspendues, les magistrats ayant fui ou s’étant terrés dans leurs habitations. Tous les bâtiments, commerces, magasins, voire églises, sont fermés. Sans la présence visible rassurante des autorités politiques ou ecclésiastiques, les habitants sont livrés à eux-mêmes, contraints de s’écarter les uns des autres par peur de la contagion. On ferme les fenêtres et l’on évite de descendre dans la rue. Les habitants qui y sont néanmoins contraints par le manque de vivres prennent leurs précautions. Ainsi, lors de la peste de Milan de 1630, ceux qui osent sortir se munissent d’un pistolet pour tenir à distance toute personne susceptible d’être contagieuse. L’on scelle ou mure les portes des foyers suspectés d’être déjà contaminés, condamnant des familles entières à une mort lente et douloureuse. Daniel Defoe, dans son récit de la peste londonienne de 1665, souligne fortement le « manque de communication entre les hommes ». Les époux se tiennent à l’écart l’un de l’autre, les parents abandonnent leurs enfants, on laisse les malades mourir dans la solitude lorsqu’on ne les passe pas tout simplement par la fenêtre. Les prêtres refusent d’accorder l’extrême onction, sacrement apaisant les esprits et permettant au mourant de faire sereinement face à la mort. Ainsi, d’après Delumeau, la peste fait naître « des conditions insoutenables d’horreur, d’anarchie et d’abandon des coutumes les plus profondément enracinées dans l’inconscient collectif ». La société entière se désagrège et se liquéfie en temps d’épidémie.
Il n’est pas étonnant de voir apparaître, dans ces conditions, des comportements irrationnels résultant d’un effondrement psychologique généralisé. Certains s’abandonnent, jusqu’à en mourir, à la boisson et à la débauche pour se forger l’illusion de jouir des derniers instants de vie qu’il leur reste. D’autres, au contraire, s’amassent dans des processions malgré le risque de répandre ainsi la maladie. Des malades, jaloux de voir d’autres en bonne santé, arpentent les rues pour contaminer les passants, tandis que des hommes bien portants torturent un malade, le tenant pour responsable de la peste. Des infirmières jouent à saute-mouton avec des cadavres. Defoe, dans son Journal de la peste, rapporte même le cas d’un jeune homme dansant nu dans les rues. Le temps de la peste est celui d’une épidémie de folie plus encore que de la maladie.
L’Occident moderne : une « cité assiégée »

Nul doute que les épidémies ont fortement marqué la culture et la société européennes. Le goût pour le macabre en est l’une des conséquences. « Avec un réalisme morbide les artistes s’efforcèrent de traduire le caractère horrible de la peste et le cauchemar éveillé que vécurent les contemporains. », note Delumeau. Les danses macabres, dont le succès caractérise l’art occidental des XIVe-XVIIIe siècles, naissent précisément au lendemain de la Peste Noire. Les peintures, attentives aux moindres détails de la maladie, font la quasi-dissection des pestiférés. Pour Delumeau, cette « évocation de la violence, de la souffrance, du sadisme, de la démence et du macabre » doit être interprétée comme un véritable « exorcisme du fléau […] devant une peur qui se transforme en angoisse ».
Pour l’historien, les épidémies, aux côtés d’autres causes comme la division religieuse issue du Grand Schisme puis de la Réforme, les disettes, les révoltes ou l’avancée turque, contribuent à expliquer le tournant des sociétés occidentales, fortement marquées par l’angoisse, entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle. L’angoisse, ce sentiment général de crainte sans cause, menace de détruire les fondements de la société si elle n’est pas réorientée vers un objet précis. Aussi, tout l’effort des autorités, tant civiles qu’ecclésiastiques, est de nommer l’ennemi : plus que les épidémies, il faut craindre l’œuvre de Satan, dont la manifestation est multiforme : le Turc, les Juifs, les hérétiques, les sorcières. L’invention de l’ennemi permet de transformer l’angoisse en peur et de refonder, ainsi que l’a montré René Girard, la communauté autour d’un bouc émissaire. Il n’est pas anodin de constater que la chasse aux sorcières naît précisément dans la période troublée des divisions confessionnelles et des épidémies. D’autre part, la théologisation du discours culturel se double d’une christianisation disciplinaire des comportements. Une vaste entreprise de conformisation religieuse est mise en œuvre autant par la Réforme protestante que par la Réforme catholique tridentine. La danse, les jeux de hasards et les comportements jugés trop festifs ou trop païens sont combattus, l’absence à la messe ou au culte dénoncée et les comportements marginaux ou déviants fortement condamnés. Se forge ainsi une culture de la « cité assiégée » entre le milieu du XIVe siècle et le milieu du XVIIe siècle : la communauté se définit autant par son conformisme qu’en opposition à l’autre, qu’il soit vu comme un ennemi extérieur (le Turc, le Juif) ou intérieur (l’hérétique, la sorcière). Si elle peut paraître oppressive, une telle « mentalité obsidionale » a en réalité été libératrice, puisqu’elle a permis de « substituer des peurs théologiques à la lourde angoisse collective résultant de stress accumulés ». C’est en nommant théologiquement l’ennemi, en forgeant une chrétienté militante et en normalisant les mœurs et les comportements que la société occidentale a pu combattre ses propres angoisses, « cette maladie de la civilisation dont elle est finalement sortie victorieuse » vers le milieu du XVIIe siècle.
Qu’en conclure pour notre temps ? Delumeau ne peut s’empêcher, en passant, de mettre en parallèle cette société de l’angoisse du début des temps modernes avec notre propre époque. Il décrit avec sérieux et précision l’univers incertain et troublé dans lequel nous vivons : « Les jeux de la Bourse, dont dépendent — hélas ! — tant de destins humains, ne connaissent finalement qu’une règle : l’alternance d’espérances immodérées et de peurs irréfléchies. » Notre société est sans doute aussi celle de l’angoisse, tant les peurs accumulées, qu’elles soient justifiées ou non, se superposent : crainte de la crise économique et du chômage, de la crise écologique et de l’effondrement des écosystèmes naturels et humains, de l’immigration et du déclin occidental, du terrorisme, de la décadence morale et de la sécularisation, de la disparition de l’homme dans le transhumanisme… L’homme occidental est un perpétuel angoissé. Or, une société paralysée par l’angoisse se désagrège nécessairement. La libération consiste alors à nommer l’objet de la crainte, afin de transformer l’angoisse en peur. Il serait dès lors intéressant de se demander si le retour des épidémies, qui marquèrent si profondément l’histoire de l’Europe, dans notre monde contemporain ne permettrait pas d’exorciser à nouveau les craintes paralysant nos sociétés. En nommant un ennemi à combattre, en déclarant la « guerre » à un virus, en mobilisant le monde entier autour d’un même idéal et d’une même lutte, n’use-t-on pas à nouveau du mécanisme ayant présidé à la construction de l’Occident moderne ?
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
