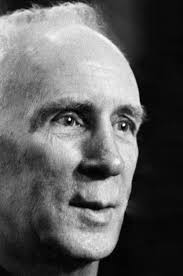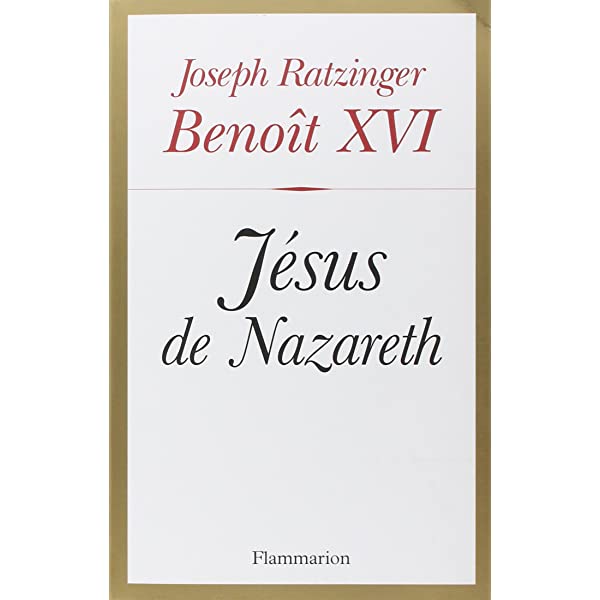Rappelé à Dieu le 31 décembre 2022, le pape Benoît XVI a bâti une œuvre théologique singulière, se confrontant aux enjeux intellectuels de son temps avec un souci pastoral qui déjoue toute réduction universitaire. Le théologien bavarois qui, comme en témoigne son testament spirituel rendu public le jour de sa mort, a œuvré jusqu’à la fin de sa vie pour qu’émerge « le caractère raisonnable de la foi », a posé les jalons, notamment avec sa trilogie Jésus de Nazareth et son introduction au christianisme Foi chrétienne hier et aujourd’hui, d’une théologie christocentrée, adossée à la grande tradition théologique et orientée vers le mystère de la croix, où s’achève et se parachève la révélation divine.
Le souci de pédagogie allié à l’exigence de cohérence qui caractérise la démarche intellectuelle et spirituelle de Joseph Ratzinger dans les trois tomes de Jésus de Nazareth[1] offre le luxe de pouvoir dévoiler d’emblée, sans risquer de se méprendre, l’intuition qui anime le théologien tout au long de ces lignes. Cette intuition, née de la méditation des évangiles et de la lecture des Pères de l’Église, se trouve exprimée à plusieurs reprises par Ratzinger et se résume à ceci que Jésus-Christ, avant d’apporter un message, un royaume ou une pax tant attendue, a apporté Dieu. « Il a apporté le Dieu dont la face s’est lentement et progressivement dévoilée depuis Abraham jusqu’à littérature sapientielle, en passant par Moïse et les Prophètes – le Dieu qui n’avait montré son visage qu’en Israël et qui avait été honoré dans le monde des gentils sous des avatars obscurs – c’est ce Dieu-là, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu véritable qu’il a apporté aux peuples de la terre » (I, 63-64).
Cette thèse, s’il en est, est reprise explicitement dans le tome suivant de Jésus de Nazareth, avec cette fois une insistance significative sur la dimension universelle de la mission du Christ. « Même si Jésus limite consciemment son œuvre à Israël, il est toutefois toujours mû par la tendance universaliste d’ouvrir Israël de façon à ce que tous puissent reconnaître dans le Dieu de ce peuple le Dieu unique commun à tout le monde » (II, 31). La réponse à la question décisive « qu’apporte le Christ ? » fait naturellement surgir deux autres questions : à qui et comment Jésus apporte-t-il Dieu ? Tel est le pôle autour duquel s’articule la christologie de Ratzinger, encore que l’expression, dont il regrette dans Foi chrétienne[2] qu’elle soit si souvent opposée à la « sotériologie » ou divisée en son sein entre « christologie d’en haut » et « christologie d’en bas » (155-156), ne lui convienne qu’à moitié concernant son propre travail (cf II, 10).
Cette christologie s’élabore donc en trois temps. Dans la dialectique du « nouveau et définitif » sur laquelle Ratzinger, lecteur des Pères, insiste avec raison dans chaque mystère de Jésus qu’il contemple, réside la clef de l’articulation délicate entre Israël et les païens. À la fois « lumière pour éclairer les nations » et « gloire de [son] peuple Israël » (Lc 2, 32), le Christ est doté d’une mission dont l’essence même appartient à l’universalité (III, 120). Si bien que, dans la série d’avènements où Dieu semble disparaître de plus en plus – « terre – Israël – Nazareth – Croix – Église » (176) –, Jésus-Christ se présente à la fois comme le nouvel Adam en qui « l’humanité commence de nouveau » (III, 21) et le nouveau Moïse, celui qui « porte à son terme ce qui a commencé avec Moïse auprès du buisson ardent » (II, 113). La croix, chez Ratzinger, est autant révélation que rédemption. Or, que révèle cette rencontre du vertical et de l’horizontal, sinon l’identité de Dieu et celle de l’homme, en la personne du Fils, réponse voilée au nom mystérieux donné par Dieu à Moïse (Ex 3, 14) ? La croix, seul lieu où l’on peut connaître et comprendre le « Je suis » divin (I, 377), devient par conséquent le lieu où le Christ règne, son « trône », « d’où il attire le monde à lui » (II, 242). L’être-ouvert du Christ, les bras étendus en croix, va de pair avec l’ouverture d’Israël aux païens : la christologie proexistente de Ratzinger justifie l’universalisme chrétien.
« Le Juif d’abord, et le païen »
La grande mission que se donne Ratzinger au début de Jésus de Nazareth, représenter le « Jésus des Évangiles » comme une « figure historiquement sensée et cohérente » (I, 17), revient à rendre raison d’un « Messie crucifié » que les Juifs nomment « scandale » et les païens « folie » (1Co 1, 23). Certes, le passage du « n’allez pas chez les païens » (Mt 10, 5) au « de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19), dans l’enseignement du Christ, a trouvé, dès les premiers temps du christianisme, une interprétation cohérente dans l’épître aux Hébreux, chez saint Paul et les Pères de l’Église, fondée sur « l’Israël selon l’esprit », « le temps des païens » etc. Pour autant, le fait qu’un Henri de Lubac, au siècle précédent, ait jugé bon de rappeler à la mémoire des théologiens, à partir d’arguments scripturaires et théologiques, l’unité de l’Ecclesia ex circumcisione – l’Église issue d’Israël – et de l’Ecclesia ex gentibus – l’Église des Gentils, qui naît au pied de la croix avec le centurion romain (II, 255) –, indique combien l’articulation entre l’élément juif et « l’élément grec » (254) dans le mystère chrétien, bien qu’elle soit le fondement de toute ecclésiologie, suscite encore un certain embarras. Sans doute le « souci d’universalité »[3] de la Bible, remis au goût du jour par l’auteur de Catholicisme, a marqué le jeune Ratzinger. En une époque encore bouleversée par les découvertes de l’exégèse historico-critique, Henri de Lubac réaffirme un principe exégétique fondamental propre aux Pères : apprendre à lire spirituellement les réalités historiques, historiquement les réalités spirituelles.
Fort de cette herméneutique spirituelle et conscient de l’importance du factum historicum autant que de ses limites, Ratzinger peut répondre et dépasser les apories apparentes d’une interprétation historico-critique qui, selon lui, « a désormais donné tout ce qu’elle avait d’essentiel à donner » (II, 8). Cet effort de synthèse théologique n’est pas sans rappeler, pour un familier de saint Thomas d’Aquin, la méthode de la Somme de théologie dont la Tertia pars a, selon son propre aveu, influencé le travail de Ratzinger (II, 10). Dans Jésus de Nazareth, les interrogations sont nombreuses et les thèses, même celles que le théologien réfute, sont déployées jusqu’au bout. Pour chaque mystère de la vie du Christ, Ratzinger procède, en quelque sorte, par questions déclinées en divers articles au sein desquels, aux objections formulées – le plus souvent – par l’exégèse historico-critique, le théologien oppose un sed contra issu d’une autorité – l’Écriture ou un Père –, avant de proposer sa propre réponse et ses solutions, en argumentant à partir de sources théologiques, historiques ou scientifiques.
Cet enjeu de méthode nous en apprend davantage sur l’intention première de Ratzinger. Derrière la rigueur démonstrative, on devine une volonté de rendre intelligible un mystère qui, pour beaucoup, apparaît scandaleux ou insensé. Intelligence de l’Écriture pour les Juifs, intelligence de la foi pour les païens. Or les deux, loin de s’opposer, communiquent selon une hiérarchie précise. Le fait, chez saint Augustin notamment, que la seconde comprenne la première et la dépasse se justifie, à l’origine, en la personne de Jésus-Christ, qui est à la fois Jonas – « Καθὼς Ἰωνᾶς » (Lc 11, 30) – et « bien plus que Jonas » – « πλεῖον Ἰωνᾶ » (Lc 11, 32). Remise en route par le Fils de Dieu, l’histoire du salut sera aussi dépassée par lui. Ici réside ce que Ratzinger considère comme « le point central de [sa] réflexion ». D’une part, le Christ est bien un « nouvel Adam » (I, 161), « nouveau Jacob » (I, 65), nouveau Samuel (III, 180), nouveau David (II, 17-18) ; « nouveau Moïse » surtout, puisque le prophète parlait avec Dieu lui-même et a reçu de lui son nom mystérieux (I, 292-293). D’autre part, et dans le même temps, il est le « vrai Jacob » (I, 195), « vrai Salomon » (I, 106) et « vrai Moïse » (I, 101) : la manne, le nom divin et la Loi, les trois dons faits par Dieu à Moïse, sont devenus une personne : Jésus-Christ. Ce que Dieu promet dans l’Ancienne Alliance est accompli avec surabondance dans la Nouvelle : « au moyen des nouveaux événements (…), les Paroles acquièrent leur sens plein et, inversement, les événements possèdent une signification permanente, parce qu’ils naissent de la Parole, qu’ils sont Parole accomplie » (III, 39). De son ministère en Galilée à l’ascension du Golgotha, le Christ ne fait pas qu’accomplir les Écritures et tenir des promesses. En réalisant parfaitement la mission du Serviteur souffrant de Dieu annoncée par le prophète Isaïe (Is 53), il la dépasse et, se livrant non seulement pour les « brebis perdues d’Israël » (Mt 15, 24) mais aussi pour la multitude, lui confère une « universalisation qui indique une nouvelle ampleur et profondeur » (II, 161).
Ce retour à l’universalité première, le « nouvel Adam » récapitulant l’humanité blessée depuis le premier Adam, était déjà annoncé dans l’existence du peuple particulier, élu par Dieu : Israël. Selon la tripartition augustinienne, le régime de la grâce (sub gratia) qui commence avec le Christ, quoiqu’accomplissant les promesses faites par Dieu sous le régime de la Loi (sub legem), donne à l’humanité un nouveau commencement et une universalité inédite depuis le temps qui précédait la Loi (ante legem). Or, à propos des promesses faites au peuple juif, Ratzinger rappelle que, dans l’Ancien Testament, « Israël n’existe pas seulement pour lui-même » mais « pour devenir la lumière des nations » (I, 138), « son élection étant la voie choisie par Dieu pour venir à tous » (I, 42). Les références scripturaires ne manquent pas pour le prouver, la plus célèbre se trouvant aux chants du Serviteur dans le livre d’Isaïe, où apparaît la figure d’un homme, familier du Seigneur et malmené par son peuple. « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » (Is 49, 6). Analysant scrupuleusement ces passages (I, 360, II, 235-237, III, 120) à la suite de nombreux exégètes, Ratzinger peut affirmer qu’en accomplissant cette prophétie d’Isaïe, le Christ réalise la promesse d’universalité faite à Israël. Nouveau Moïse, il est le maître d’ « un Israël renouvelé, qui n’exclut ni n’abolit l’ancien, mais le dépasse en l’ouvrant à l’universel » (I, 87). En Jésus-Christ, le particulier est devenu universel (I, 103). « Des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité » (Ep 2, 14), écrit saint Paul. Si bien que l’affirmation première de la christologie de Ratzinger, le Christ a apporté Dieu, trouve son sens et sa portée définitive dans le thème de l’universalité de Jésus, « centre même de sa mission » (I, 42). Jésus-Christ « a apporté le Dieu d’Israël à tous les peuples, si bien que désormais tous les peuples le prient et reconnaissent sa parole dans les Écritures d’Israël, la parole du Dieu vivant. Il a fait don de l’universalité, qui est une grande promesse, une promesse marquante pour Israël et pour le monde » (I, 139).
Le « buisson ardent de la croix »
À mi-chemin de la réflexion ratzingérienne, une interrogation émerge. Si l’on comprend aisément en quoi la règle herméneutique que Ratzinger emprunte aux Pères de l’Église – la dialectique du « vrai et définitif » appliquée aux figures de l’Ancien Testament qui annoncent le Christ – fait de l’Écriture un ensemble harmonieux, l’on est en droit de se demander quel sort le christianisme, chez Ratzinger, réserve au païen. « Le Juif (Ἰουδαίῳ) d’abord, et le païen (Ἕλληνι) » (Rm 1, 16) : la formule, récurrente chez saint Paul, rappelle l’ordre des priorités. Cependant, le Grec est déjà concerné par l’histoire universelle d’Israël, et notamment par la révélation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent (Ex 3). Au mont Horeb, les païens qui jusque-là vénéraient un Dieu sans le connaître, le « Dieu inconnu » (Ἀγνώστῳ θεῷ) dont saint Paul découvre l’inscription à l’Aréopage d’Athènes (Ac 17, 23), sont convoqués. Ils le sont aussi sur le Sinaï, où a lieu une autre théophanie qui aboutit au don des Lois, et, a fortiori, sur le « nouveau Sinaï », « Sinaï définitif » (I, 87), que Ratzinger identifie à la montagne où a lieu le discours des Béatitudes (Mt 4, 12-25) et, avec plus de raison encore, au mont Golgotha (I, 167).
Historiquement, le sum qui sum d’Ex 3, 14 advient dans un contexte où le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob se choisit un peuple et orchestre sa libération d’une nation païenne qui le tenait en esclavage. Le particularisme dans le mode de révélation du nom divin ne contredit cependant pas la portée universelle de son contenu. Soucieux d’interpréter spirituellement les réalités historiques – et réciproquement –, Ratzinger le prouve de différentes façons. Par l’Écriture, d’abord, en interprétant la fuite en Égypte de la Sainte famille et le retour en Terre promise comme recommencement de l’histoire d’Israël, depuis son origine mosaïque (III, 159) jusqu’aux révoltes maccabéennes. Dans son incarnation, le Verbe qui était auprès de Dieu au commencement vient au monde en Galilée, c’est-à-dire « dans un coin de terre déjà considéré comme à demi païen » (I, 85) et reçoit la citoyenneté romaine sous le règne d’Auguste, empereur considéré comme fils de Dieu, si ce n’est Dieu lui-même, et qui a, sans le savoir, contribué à l’accomplissement de la promesse en instaurant une universalité et une paix politiques dans son Empire (III, 93-95). De sa Galilée native, le Messie va vers Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés (Lc 13, 34), lieu où doit advenir le salut à l’issue d’une montée à laquelle saint Luc, dans son évangile, a donné une connotation géographique autant que spirituelle. Celui qui a trouvé, chez les païens qui lui ouvrent sa porte, plus de foi que chez la plupart des fils d’Israël (Mt 8, 10) qui ne l’ont pas reçu, a fait de Jérusalem le centre d’une révélation qui a commencé avec l’adoration des mages païens à Bethléem et s’accomplit pleinement dans l’annonce de la mort et la résurrection du Christ à toutes les nations. Aussi, à l’autre extrême du Nouveau Testament, Ratzinger est-il en droit d’interpréter la vision de saint Paul, où un Macédonien appelle l’apôtre des Gentils à son secours (Ac 16, 6-10), comme justification de ce que l’on a nommé, le plus souvent pour en faire la critique, l’hellénisation du christianisme. « Ce n’est pas un hasard si le message chrétien, dans son élaboration, a d’abord pénétré dans le monde grec, et s’est mêlé au problème de l’intelligibilité et de la vérité » (35).
Là où certains, craignant la dissolution de la spécificité chrétienne dans la culture et la philosophie grecques, prônent un « repli dans le religieux pur » (82), Ratzinger soutient fermement le « droit imprescriptible de l’élément grec dans le christianisme » (35). L’interprétation ontologique que les Pères de l’Église, et les théologiens médiévaux après eux, ont donné du « Je suis » par lequel Dieu se nomme en Ex 3, 14, fonde, quelques siècles après le coup d’envoi grec, ce que Ratzinger ose nommer « l’identification » du « concept philosophique de Dieu » avec le Dieu biblique (66), moyennant plusieurs transformations non négligeables (84-85). Pascal a beau jeu, dans une formule qui a fait date – souvent pour de mauvaises raisons –, d’opposer le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob à celui des philosophes et des savants, sans le choix de la « chrétienté primitive (…) pour le Dieu des philosophes contre les dieux des religions » (80), le « primat du logos » (91) inhérent à la foi chrétienne aurait été bafoué et il n’y aurait sans doute pas, à ce jour, de philosophes et savants à opposer à la Loi et aux prophètes. On trouve bien, chez Ratzinger, de quoi justifier la « métaphysique de l’Exode » qu’a vigoureusement défendue Étienne Gilson : le Dieu chrétien est le nouveau et le vrai Être suprême dont parlent Platon et Aristote, une fois réduit le « fossé » qui le sépare du Dieu biblique (66), une fois le « premier moteur immobile » transformé au contact du Dieu de la foi (87-89). « En ce sens, il y a dans la foi l’expérience que le Dieu des philosophes est tout autre qu’ils ne l’avaient imaginé, sans cesser d’être ce qu’ils avaient trouvé » (85).
Si, au mont Horeb, Dieu révèle qu’il est l’Être qui subsiste en lui-même et donne à toute chose d’être, la révélation du nom divin ne lève pas entièrement le voile sur son essence. Le sum qui sum, interroge Ratzinger, n’est-il pas plutôt « un refus qu’une déclaration d’identité ? » (72) Opposer aux dieux qui passent le Dieu qui est peut résoudre la préoccupation immédiate de Moïse : le nom divin permet au peuple d’invoquer Dieu dans sa lutte et de se garder d’adorer les idoles païennes. Cependant, la présence immédiate de Dieu, « qui constitue le cœur même de la mission de Moïse comme sa raison intime » (I, 292), se voit rapidement « assombrie ». La réponse du Seigneur à la prière de Moïse, « laisse-moi contempler ta gloire » (Ex 33, 18), pose les limites de la connaissance prophétique de Dieu. L’Ancienne Alliance, en définitive, « ne présente que l’ébauche du bonheur à venir, et non pas l’image exacte des réalités » (He 10, 1). L’Ancien Testament préfigure et prépare (Rm 5, 14) celui qui doit accomplir pleinement ce qui a commencé avec Moïse, mais dont Moïse n’est que l’ombre (Col 2, 17). En Israël, Dieu habitue les hommes à sa présence jusqu’au moment où, reprenant la réponse donnée à Moïse sur le Sinaï – « mon visage, personne ne peut le voir » (Ex 33, 23) –, il offre aux hommes, de sa propre initiative, de le voir et de le connaître en la personne de Jésus-Christ (Jn 1, 18).
Dire qu’il a été donné « au dernier prophète, au nouveau Moïse, ce que le premier Moïse n’avait pu obtenir » (I, 25), revient non seulement à souligner l’intimité et l’alliance absolument singulières qui naissent avec le Christ, Verbe de Dieu, mais aussi à considérer sa venue comme l’achèvement de la révélation faite à Moïse. Si Ratzinger s’attache à relever, dans tout l’évangile, et notamment chez saint Matthieu qui insiste particulièrement sur l’accomplissement des Écritures en Jésus, la façon dont le Christ s’inscrit dans la lignée des grands médiateurs de la révélation, il ne manque pas à chaque fois d’orienter chaque correspondance vers le sommet christologique qu’est la croix. La théologie de Ratzinger, à l’évidence, est christocentrée, et sa christologie est elle-même centrée sur la croix. Theologia a Cruce, pourrait-on dire, théologie à partir ou adossée à la croix, évitant, avec le père de Lubac, l’expression équivoque, surtout depuis Luther, de Theologia crucis. Pour Ratzinger, fidèle à la lecture patristique d’Henri de Lubac, « c’est la Croix qui dissipe la nuée dont jusqu’alors la Vérité était couverte »[4]. Cela est vrai dès les premières annonces de la Passion jusqu’à la « prière sacerdotale » du Christ rapportée par saint Jean (Jn 17), que Ratzinger commente à plusieurs endroits et en laquelle il voit une « réplique néo-testamentaire du récit du Buisson ardent » (76). « Je leur ai fait connaître ton nom » (Jn 17, 26), dit le Fils s’adressant au Père : « Le nom, demeuré depuis le Sinaï – pour ainsi dire – incomplet, est prononcé jusqu’au bout » (III, 51). Plus encore, « le nom désormais n’est plus seulement un mot, mais désigne une personne : Jésus lui-même » (77). Le Christ apparaît comme le Buisson ardent lui-même, d’où le nom de Dieu est communiqué aux hommes.
À cet égard, il y a bien une « métaphysique de la croix » chez Ratzinger, qui prolonge et achève la « métaphysique de l’Exode ». Autrement dit, le mystère de la croix ne se laisse pas réduire au mystère de la rédemption. Dans l’histoire du salut, la rédemption suit toujours la révélation : Dieu sauve en se montrant, en révélant ce qu’il est[5]. En témoigne la distinction de Ratzinger entre les deux types de confession de foi dans l’évangile, confession orientée ontologiquement à partir de substantifs d’un côté – tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant etc. –, confession verbale orientée vers l’histoire du salut de l’autre – l’annonce du mystère pascal de la croix et de la résurrection etc. À l’aune de cette différence fondamentale, il apert que « l’énoncé en termes stricts d’histoire du salut reste dépourvu de sa profondeur ontologique s’il n’est pas clairement dit que celui qui a souffert, le Fils du Dieu vivant, est semblable à Dieu » (I, 326). De la sorte se trouve respectée l’universalité de la mission du Christ qui, sur la croix, n’est pas le « roi des Juifs », expression typiquement « non hébraïque » utilisée par Pilate (III, 145), mais le « roi d’Israël », selon une royauté nouvelle, « royauté de la vérité » (II, 223), et à la tête d’un Israël devenu universel. « L’universalité (…) est mise dans la lumière de la Croix : à partir de la Croix, le Dieu unique se rend reconnaissable par les nations ; dans le Fils, elles connaîtront le Père et, de cette façon, le Dieu unique qui s’est révélé dans le buisson ardent » (II, 33). Dieu se manifeste aux Grecs sur la croix : « entre le monde païen et la Trinité bienheureuse, il n’y a qu’un passage qui est la croix du Christ » (204), écrit Ratzinger, citant Daniélou.
Christologie et ontologie
On l’aura compris, chez Ratzinger, « la croix est révélation » (206). Mais que révèle-t-elle ? Non pas « quelques propositions inconnues jusqu’à présent » (207). Elle révèle qui est Dieu et comment est l’homme. La croix conjugue l’Ecce homo (Jn 19, 5) de Pilate et le « Voici le Seigneur Dieu » (Is 40, 10) du prophète. « Vrai sommet », le Golgotha est la condition sine qua non pour connaître Dieu, pour comprendre le « Je Suis » (I, 377). « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS, et que je ne fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a enseigné » (Jn 8, 28), écrit l’évangéliste. Est-ce à dire que l’énoncé ontologique du buisson ardent recevrait enfin, avec le Christ, l’objet laissé en suspens après la forme verbale, ἐγώ εἰμι chez saint Jean ? Fidèle à saint Augustin, Ratzinger considère plutôt le Christ comme celui en qui le nom divin est prononcé parfaitement. Mieux : celui en qui le nom divin se réalise, devient actuel. De même que dans les psaumes, d’après saint Augustin, « c’est toujours le Christ qui parle, tour à tour comme Chef, ou comme Corps » (II, 172), de même, sur la croix, le Christ devient le sujet du « Je suis » divin. Le mystère de la Passion du Christ est donc « un événement dans lequel quelqu’un est ce qu’il fait, et fait ce qu’il est » (197).
Ici réside la singularité de la christologie ratzingérienne, marquée par l’ontologie johannique et fécondée par l’aristotélisme des théologiens médiévaux. L’être du Christ, rappelle Ratzinger dans Foi chrétienne, est identique à son acte. Empruntant à la notion d’actualitas divina et l’idée, de facture thomiste mais qu’il fait remonter à saint Augustin, de « l’Existence qui est Acte pur » (110), le théologien insiste sur l’identité, en Jésus-Christ, « de l’œuvre et de l’être, de l’action et de la personne, l’absorption totale de la personne dans son œuvre, la coïncidence du faire avec la personne elle-même » (151). La fusion, dans le syntagme « Jésus-Christ », du nom avec le titre témoigne bien de cette identification de la fonction et de la personne (133). Partant, l’on ne peut séparer le « Jésus de l’histoire » du « Christ de la foi », comme l’a massivement fait l’exégèse historico-critique, pas plus qu’il n’est possible d’opposer une théologie de l’incarnation à une théologie de la croix. Ratzinger réconcilie les deux, puisque l’être du Christ est actualité et, réciproquement, son agir est son être, atteint aux profondeurs de son être (155).
Il en va de même pour « la phénoménologie et les analyses existentiales », auxquelles Ratzinger accorde une certaine utilité, tout en les jugeant insuffisantes : « Elles ne vont pas assez profond, parce qu’elles ne touchent pas au domaine de l’être véritable » (154). Dans la formule chère à la phénoménologie chrétienne – Dieu est tel qu’il se révèle –, le verbe être a la préséance : l’identité ne vaut pas comme simple équivalence – Dieu serait un tel qu’il se révèle, un simple acte de donation, le mode devenant substance –, mais comme énoncé proprement métaphysique prononcé depuis l’esse divin. La première affirmation de la théologie, celle d’Ex 3, 14, serait plutôt : Dieu est « tel qu’il est » (1 Jn 3, 2). Or, ayant renoncé à « découvrir l’être en lui-même », pour se limiter au « positif », à ce qui apparaît, la phénoménologie, au même titre que la physique ou l’historicisme, reste au seuil du mystère. Ratzinger regrette que, de nos jours, « l’ontologie [devienne] de plus en plus impossible » et que « la philosophie se [réduise] dans une large mesure à la phénoménologie, à la simple question de ce qui apparaît » (127). Or être et apparaître, dans le Christ, ne font qu’un.
Cette « pure actualité » du Christ se vérifie en premier lieu dans les œuvres ad intra de la Trinité. Ratzinger rappelle que Père et Fils sont des concepts de relation. Ainsi « la première personne n’engendre pas le Fils en ce sens que l’acte de génération s’ajouterait à la personne constituée, elle est au contraire l’acte de génération, l’acte de se donner, de se répandre » (117). Le « règne solitaire de la catégorie substance » s’en trouve brisé : « on découvre la « relation » comme une forme originelle de l’être, de même rang que la substance ». Dès lors, la formule johannique déjà citée selon laquelle le Fils ne peut rien faire de lui-même, nous renseignant sur le faire christique, nous renseigne aussi sur son être proprement relationnel. « Le Fils, en tant que Fils et dans la mesure où il est Fils, n’existe absolument pas de lui-même et de ce fait, il est totalement un avec le Père » (118). De sorte que l’être de Jésus nous apparaît, à la lumière de saint Jean, comme un « être totalement ouvert », « venant-de » et « ordonné-à » (119). Dans Jésus de Nazareth, Ratzinger reprend cette thématique de « l’être-pour » (Sein-für), empruntée notamment à Heinz Schürmann (II, 203). La proexistence de Jésus signifie que « son être est dans un être pour » (II, 158). « Dans la passion et dans la mort, la vie du Fils de l’homme devient pleinement « existence pour », il devient le libérateur et sauveur pour « la multitude », non seulement pour les enfants dispersés d’Israël, mais plus généralement pour les enfants de Dieu dispersés (…), pour l’humanité » (I, 360). L’universalité du salut apporté par le Christ trouve donc son origine dans cet être-pour et les implications ad extra de cette identité intra-trinitaire du Fils. « Véritable loi fondamentale de l’existence chrétienne » (172), le « principe du pour » justifie donc la réconciliation d’Israël avec les païens (Ep 2, 13-16) : ayant donné sa vie pour tous, le Christ devient principe du salut éternel « pour tous ceux qui lui obéissent » (He 5, 9).
Jésus-Christ a apporté Dieu aux hommes : nous voici revenus, après un détour par l’histoire du salut, à la source christologique de cette affirmation évidente mais fondamentale que Ratzinger a jugé bon de rappeler. « Dieu qui sauve », Jésus est Dieu pour les hommes, Dieu parmi les hommes, « Emmanuel ». L’immanence de Dieu, donnée à Israël « dans la dimension de la parole et de l’accomplissement liturgique », est devenue ontologique : « en Jésus, Dieu s’est fait homme. Dieu est entré dans notre être même » (II, 114). Selon Ratzinger, plus que la satisfaction vicaire, l’humanité reçoit son salut de l’identité, maintenue en Jésus-Christ, des deux natures, et avec elle de l’identité entre son être et son acte. Sur la croix, l’identité de Dieu est parfaitement réalisée dans le Christ, et par là-même visible aux yeux de tous : il est vraiment celui qui se donne. La rédemption se joue d’abord dans cet accomplissement parfait du « Je suis ». L’identité de Dieu, qui fait l’objet de tant d’interrogations dans l’Ancien Testament comme dans la philosophie grecque, se révèle sur la croix et se révèle justement comme une identité. Dieu, dans le Christ, est vraiment ce qu’il est. Lors du calvaire, « amour et vérité se rencontrent » (Ps 84, 11), selon un thème que Benoît XVI exposera régulièrement durant son pontificat.
Partant, l’être divin étant ouvert au monde, il offre une voie jusque-là inconnue pour assurer le retour de la création vers Dieu. Jésus-Christ est cette voie, ce « chemin » (Jn 14, 6). L’union réalisée en Jésus de Nazareth « doit s’étendre à l’Adam total et le transformer en Corps du Christ » (182). La voie empruntée par le Seigneur, où Juifs et Gentils marchent de concert, se présente à l’humanité comme une ascension vers la croix conjuguée à une renonciation progressive à soi-même. Romano Guardini, dont on sait l’influence sur la théologie de Ratzinger, écrit en ce sens, dans Le Seigneur, que la vie du Christ consiste, après avoir baissé la divinité vers l’humanité, à « [soulever] son humanité au-dessus d’elle-même jusque dans l’océan divin »[6]. Chez Guardini apparaît déjà la coïncidence littéraire et théologique entre la montée vers Jérusalem, où le roi de gloire comprend progressivement qu’il devra passer par la figure du Serviteur souffrant, et la constitution d’une économie du salut, fidèle à la promesse selon laquelle le salut de Dieu parviendra à toutes les nations. L’ouverture plus large du salut et de l’espérance a une condition : l’humiliation plus profonde du Christ. Ce que le Christ gagne en anéantissement, l’humanité le gagne en élévation ; et réciproquement, puisque « la montée vers Dieu advient quand on l’accompagne dans cet abaissement » (I, 117). « Ce n’est qu’avec le Christ, – l’homme qui est « un avec le Père », l’homme grâce à qui l’être de l’homme est entré dans l’éternité de Dieu –, que l’avenir de l’homme apparaît définitivement ouvert » (254). Telles sont bien la vraie seigneurie et l’authentique royauté qu’exerce Dieu à travers le Christ : le Maître de l’univers, accomplissant l’antique proskynèse, s’abaisse jusqu’à l’extrême limite de la dépossession de soi, se fait serviteur. L’on reconnaîtra les « fils dans le fils » à ceci qu’ils demeurent éternellement dans la maison où leur maître (Jn 8, 35), parce qu’ils en ont formulé la demande (Jn 1, 38), les a introduits : la demeure de l’être qui est celle de l’amour (Jn 15, 9). Grand mystère d’une foi où l’on règne en servant (I, 360), depuis que le dominus ou κύριος, pour n’être jamais plus séparé de sa création, s’est uni à elle, s’est engouffré au « cœur du monde » à une telle profondeur que toute chute à l’avenir serait une chute en lui.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
[1] Les références aux trois tomes de cet ouvrage seront mentionnées entre parenthèses après chaque citation, selon la pagination des premières éditions françaises de chaque tome, dans l’ordre de parution : Jésus de Nazareth, Du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration, Flammarion, 2007 (I), Jésus de Nazareth, De l’entrée à Jérusalem à la Résurrection, Éditions du Rocher, Groupe Parole et Silence, 2011 (II), L’Enfance de Jésus, Flammarion, 2012 (III).
[2] Chaque citation de cet ouvrage sera suivie de la mention de sa page, dans la première édition française : Foi chrétienne, hier et aujourd’hui, Mame, 1969.
[3] Catholicisme, Les aspects sociaux du dogme, Henri de Lubac, Le Cerf, Œuvres complètes VII, 2009, p. 133.
[4] Catholicisme, op.cit., p. 146.
[5] Les divers noms que donnent les disciples et la « foule » au Christ dépendent de la nature de ses manifestations ou « signes », chez saint Jean. On remarque, dans ces pages de Ratzinger, des réminiscences de Romano Guardini, qui écrit dans Le Seigneur : « Quand Pierre fait sa confession, il se tient par la pensée là où le Messie se tient par l’être » (Le Seigneur, Romano Guardini, Salvator, 2018, p. 265).
[6] Le Seigneur, op. cit., p. 513.