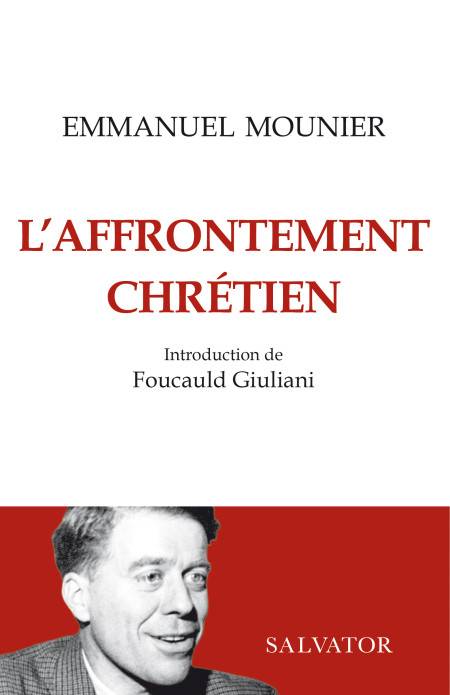Les éditions Salvator rééditent L’Affrontement chrétien, texte d’Emmanuel Mounier (1905-1950) écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Foucauld Giuliani, professeur de philosophie et fondateur du café associatif Le Dorothy, a rédigé l’introduction de la présente édition dans laquelle il revient sur les ambiguïtés du livre et sur les accusations formulées à son encontre notamment par l’historien Zeev Sternhell.
PHILITT : Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte Emmanuel Mounier écrit L’Affrontement chrétien ? Et quel fut précisément son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Foucauld Giuliani : Mounier l’écrit à l’hiver 1943-1944, dans un moment troublé de sa vie personnelle et évidemment de la vie nationale. En novembre 1940, il a décidé de continuer à faire paraître Esprit, malgré le contrôle de la censure, ce qui lui sera fortement reproché, à juste titre à mon avis. Dix numéros paraissent jusqu’à la suspension de la revue par le régime de Vichy à l’été 1941. Mounier est alors accusé de faire partie de la Résistance et il est emprisonné de longs mois. Il fait une grève de la faim, il est finalement relâché et les charges judiciaires à son encontre sont abandonnées. Ces événements le conduisent à renoncer une fois pour toutes à l’espoir d’infléchir l’idéologie du régime.
Je crois qu’un facteur important explique que Mounier ait pu croire un temps à l’idée de « Révolution nationale » : sa conviction qu’il faut dépasser le libéralisme. À mon avis, l’histoire du XXe siècle montre qu’il doit moins s’agir de remplacer le libéralisme politique, entendu comme doctrine des droits de l’homme et pluralisme idéologique dans le cadre des institutions de la démocratie représentative, que de lui conférer de bonnes finalités et de chercher à lui adjoindre des éléments de démocratie directe. Les religions ont sans doute un rôle à jouer dans ce délicat exercice de réforme et de réorientation du libéralisme ainsi défini.
En 43-44, quand il écrit L’affrontement chrétien, Mounier tente de comprendre les conditions qui ont conduit certains pans du christianisme à se compromettre avec l’ordre établi. Il y a décadence du christianisme dès lors qu’on aborde la religion chrétienne comme un dépôt culturel à maintenir et non comme une foi créatrice à faire vivre. Il s’interroge aussi sur les conditions de renaissance d’un christianisme de combat capable de bousculer et d’élever la société plutôt que de la cimenter ou de la justifier. Je veux croire qu’il y aussi chez lui, avec ce texte, une volonté d’autocritique même si cela est plus implicite qu’explicite dans le livre.
Pour Mounier, le chrétien doit se penser comme un éternel dissident. Qu’est-ce que cela implique ?
Mounier montre que le christianisme d’avant-guerre, trop centré sur la question des mœurs et la justification du mode de vie bourgeois, a eu tendance à oublier que la foi chrétienne disposait à vivre en contradiction avec l’ordre du monde. Ce qu’abhorre au plus haut point Mounier, c’est la figure du chrétien tranquille, à l’aise dans son siècle, en adéquation avec l’ordre des choses. Mounier nous rappelle à notre condition ontologique et politique de « dissident », c’est le terme qu’il utilise. On sent en filigrane du livre une confrontation avec la large partie du catholicisme français acquise au pétainisme. Dès les années 30, Mounier a eu l’intelligence et le courage de faire preuve de dissidence et prendre ses distances avec des idées très ancrées dans la société et dans les rangs catholiques. Plusieurs exemples : il critique le système colonial, il soutient les réformes du Front Populaire en 36, il suit Bernanos dans sa condamnation lucide du franquisme espagnol.
La dissidence passe certes par un affrontement extérieur mais aussi par un combat intérieur car le conformisme exploite nos tendances subjectives, tels que les besoins de confort matériel ou de reconnaissance sociale. Mounier comprend sans doute pour lui-même et essaye de nous faire comprendre qu’il faut abandonner à toute prétention à être au pouvoir. Le vrai christianisme, la foi vivante, est appelé à créer depuis les interstices du monde. Il faut lutter en continu contre nos illusions et nos vains espoirs de contrôler l’histoire depuis ses apparents gouvernails, ce qui n’est pas une mince affaire… Car comment concilier cela avec le désir de transformer l’ordre social ? Comment tenir ensemble cette position d’humilité et cette ambition d’une vérité universelle appelée à transfigurer l’ensemble de la réalité ? On voit bien que c’est un problème difficile. Je ne pense pas que Mounier s’y confronte toujours très efficacement.
Dans ce livre, Mounier réfute la critique nietzschéenne du christianisme. Pourquoi ce focalise-t-il sur Nietzsche en particulier ?
Je pense que c’est parce que Mounier trouve Nietzsche stimulant dans sa critique du christianisme sans être pour autant d’accord avec lui. Pour Mounier, le christianisme n’est pas synonyme de haine de la vie même si un certain christianisme sociologique, combinant domination sociale et pessimisme anthropologique, génère selon lui des affects excessivement négatifs comme une culpabilité morale outrancière par exemple.
Mounier se confronte dans ce livre avec un certain nietzschéisme dont a fait usage le fascisme, notamment à travers la valorisation de notions telles que « la force » ou « le sacrifice ». Il cherche à montrer que la foi chrétienne n’est pas une condamnation de la force mais une subordination de la force à l’amour et que les multiples visages du fascisme défigurent le christianisme tout en prétendant parfois l’incarner historiquement.
Mounier semble vouloir utiliser certaines notions nietzschéennes (la force, l’instinct, la virilité) pour refonder le christianisme ou, du moins, pour lui rappeler ses origines. Ne tend-il pas le bâton pour se faire battre, en particulier par Sternhell ?
Je suis assez d’accord et c’est une des limites de ce livre. Sternhell reproche à Mounier sa critique du libéralisme dans les années 30 et son usage de la rhétorique de la « crise de civilisation », qui auraient favorisé la montée en puissance du fascisme. Une telle critique ne peut que faire réfléchir et doit être prise au sérieux.
Mounier n’est pas un penseur nostalgique de la perte d’autorité de l’Église en matière de politique ou de contrôle social. Cela est très net à la fin de sa vie, notamment dans son dernier livre Feu la chrétienté (1950). Ce n’est pas non plus un esprit pleinement satisfait de la modernité libérale et de la séparation totale du religieux et du politique. D’un côté, il est une figure de l’acceptation par le catholicisme du régime républicain (par exemple, il accepte la laïcité en tant que séparation de l’Église et de l’État) mais d’un autre côté il critique très fortement le cadre institutionnel parlementaire des années 30, lui reprochant de favoriser l’extension de l’emprise du capitalisme sur la société et d’abandonner toute ambition de transmission d’une culture de la transcendance. Cette critique du libéralisme questionne dans la mesure où à cette époque elle est également diffusée par les idéologies du fascisme et du communisme étatique qui croissent de façon fulgurante. Faut-il pour autant assimiler Mounier à l’une ou l’autre de ces idéologies ? Ça me paraît excessif mais cela soulève une question difficile qu’il faut affronter. Car une fois qu’on a rangé Mounier dans la catégorie un peu vague des « anticonformistes » des années 30, qui se tiennent à distance respectable des élans les plus totalitaires de l’époque, comment qualifier sa virulente opposition à l’ordre libéral des choses ? Est-elle le signe d’un romantisme révolutionnaire, ambitieux mais impuissant et peu lucide sur son impuissance ? Est-elle le reste d’une dangereuse – et peut-être inconsciente – quête de transcendance politique ? J’essaye de poser et de traiter ce problème complexe dans l’introduction du livre.
Je crois que Mounier a raison de réfléchir aux conditions collectives et culturelles d’épanouissement de la foi car cela permet d’éviter l’alternative un peu abstraite et désespérante entre héroïsme spirituel individuel d’un côté et organisation collective de l’autre. Mais parvient-il efficacement à penser le problème de l’articulation de la foi et de la vie collective ? Certainement pas tout à fait même si le personnalisme communautaire fait office de piste intéressante pour penser la vie sociale à la lumière de l’anthropologie chrétienne.
« Le christianisme devient rapidement dans nos pays une religion de femmes, de vieillards et de petits bourgeois », écrit-il. L’attaque contre la bourgeoisie apparaît légitime. Mais pourquoi cette charge contre les femmes et les vieillards ?
C’est toujours le regret d’un christianisme qui ne parvient pas à susciter de véritables élans créateurs capables de transformer la société à grande échelle mais c’est exprimé ici de façon problématique. Quant au sexisme de la formule, et plus largement de plusieurs autres passages du texte, il est dépassé et est autant la marque de la culture dominante qu’une difficulté à faire preuve d’un recul critique sur ses catégories culturelles de pensée en la matière.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.