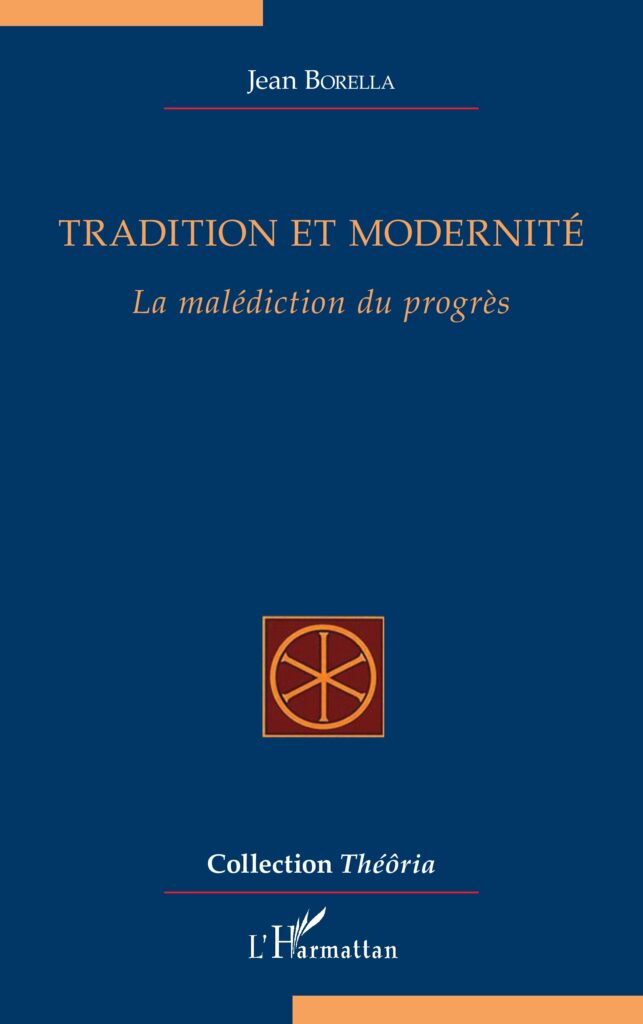Si les grands récits de la modernité occidentale se fissurent dans le contexte d’une post-modernité qui les désavoue en les relativisant à l’excès, il n’y a plus à douter que les causes de leur abandon sont à trouver dans la modernité elle-même. Celui qui fut professeur de philosophie ancienne et médiévale à l’université de Nancy II jusqu’en 1995, Jean Borella, l’explique dans Tradition et Modernité. La malédiction du progrès (L’Harmattan). Ce nouvel essai, qui synthétise les réflexions du philosophe chrétien sur la culture, démontre la manière dont celle-ci se dissout en rompant avec les fondements traditionnels de la nature humaine et de ses conditions d’éducation.
Alors que le philosophe Patrick Dupouey, dans Pour ne pas en finir avec la nature, propose une réévaluation de la pensée moderne de la notion de nature face aux contestations dont elle fait l’objet dans l’anthropologie post-moderne de Philippe Descola, le philosophe platonicien Jean Borella propose quant à lui de revisiter la pensée traditionnelle de cette notion, en tant qu’elle intègre, sans incompatibilité, l’autre notion fort discutée de « culture ». Il faut rappeler en effet[1] que celle-ci n’implique pas d’elle-même une opposition à la nature, car cette opposition provient en fait de l’interprétation tardive et moderne du concept de « culture » en terme de « civilisation », dont le caractère industriel et ethnocentrique, inauguré par Mirabeau au XVIIIe siècle, s’est radicalisé au cours du XIXe siècle sous la plume de l’évolutionniste Lewis H. Morgan. La civilisation, c’est la culture moins la tradition ; la culture moins la tradition, c’est la culture s’opposant à la nature, aussi bien dans l’ordre éthique que dans l’ordre technique et politique. Inversement, la tradition est la réalité dans laquelle la culture et la nature communient au lieu de s’opposer, en s’articulant au surnaturel.
L’hominiculture
Une réflexion traditionnelle sur la culture ne peut pas se passer de la référence à la nature : « On oppose souvent nature et culture comme le donné originel et le donné transformé », constate Borella. Or, si l’on prend le donné transformé dont l’agriculture est un exemple typique, celle-ci « développe certaines virtualités végétales de la nature en leur imposant un ordre qui les conforme à une destination » culturelle, que celle-ci soit « nutritive » (le blé pour sa consommation), « industrielle » (le coton pour le vêtement) ou « esthétique » (les fleurs pour la décoration du jardin). La conclusion est qu’ « il n’y a donc pas de culture pure, c’est-à-dire séparée de toute nature. » « Au fond, la culture s’oppose moins à la nature qu’elle ne l’accomplit », selon des modes « très variés », aussi variés qu’il peut y avoir de représentations différentes d’un même thème artistique, comme celui du « portrait » en peinture. En vertu de cette unité thématique, chère au philosophe des sciences Raymond Ruyer dont Borella est un disciple confirmé, la variété sociale, technique et représentative des cultures ne doit pas nous empêcher de reconnaître que « leur nature et leur fonction demeurent partout identiques ».
L’identité commune aux différentes cultures humaines n’est pas une identité de structure qui rendrait superflues les constructions historiques. Borella se livre en effet à une critique foncière du structuralisme, dans la mesure où cette approche manque le critère essentiel de reconnaissance des modes d’acculturation : celui de la tradition. La tradition implique d’abord un certain usage du temps : elle est la « réception d’un dépôt à transmettre », dans la mesure où, traditionnellement, « le dépôt n’est reçu et maintenu que pour être donné et transmis ». Or, la transmission s’opère dans le temps, tandis que le structuralisme prétend dégager des invariants culturels selon un modèle spatial, celui de la « structure » dont le « modèle » en sciences humaines « achève sous nos yeux la spatialisation conceptuelle de la connaissance scientifique ». D’un côté, « l’espace physique défi[nit] le modèle de tout objet », alors même que « l’extériorité spatiale, c’est, en ultime instance, l’exclusion radicale de toute subjectivité ». À la différence des phénomènes physiologiques, la conscience psychologique est en effet conditionnée par le temps, et non par l’espace : une pensée ou un sentiment quelconque n’a ni étendue ni masse, mais une durée. En faisant de l’espace le modèle du discours vrai, la science moderne oublie alors la vie.
Aussi la science doit-elle trouver dans la « mémoire culturelle » la conscience de ses implications éthiques et de ses applications techniques, car il n’est pas de culture sans continuité temporelle de ses signes, de ses pratiques et de ses représentations. L’éducation joue alors un rôle fondamental, puisqu’elle est le domaine propre de la transmission qui, étant « l’acte » même de tradition, consiste à léguer à « ce non-moi dont [j’ai] la charge » ce « quelque chose qui est plus que moi, qui me précède et qui me suivra ». Ainsi doit-on mesurer l’importance des conditions traditionnelles de « l’hominiculture », c’est-à-dire de la cultivation des petits humains. L’analogie de l’éducation avec l’agriculture se justifie en effet par le fait que, dans les deux cas, il s’agit « d’exercer une action sur un objet afin qu’il passe de l’état embryonnaire à l’état de maturité ». Or, « toute action dont le résultat “demande du temps”, d’une part, et ne peut être librement préformé et projeté, d’autre part, est entièrement dépendante d’un savoir traditionnel », c’est-à-dire d’un savoir qui se fonde moins sur l’originalité inventive de quelque technicien, que sur l’ancienneté cumulative d’intelligences éprouvées par la relative indépendance des réalités sur lesquelles elles ont travaillé au fil des millénaires. D’où la troisième condition commune à l’éducation et à l’agriculture : « la prudence extrême dans toute réforme de ce savoir ».
Démence pédagogique
La pédagogie moderne a pourtant commis la faute désastreuse de manquer d’une telle prudence : en faisant des élèves les sujets des expérimentations de la nouvelle « science de l’éducation », ce sont « des générations d’enfants » qui ont fait les frais de « rêveurs intraitables » dont la témérité a été imprudemment accueillie par les ministères de l’éducation successifs, pareillement obsédés par l’orgueil moderne de l’originalité et de l’innovation à tout prix. Les conditions traditionnelles de l’hominiculture, prudentielles, ayant été ignorées au profit de ses seules conditions scientifiques, expérimentales, la pédagogie révolutionnaire que Louis Legrand appelait de ses vœux en 1983 a transformé l’École en un vaste laboratoire qui, à la différence des véritables laboratoires, tient très difficilement compte des échecs rencontrés à l’épreuve des faits. L’on pourrait parler à ce sujet de la nocivité, maintes fois avérée en sciences, des outils numériques à l’usage des élèves et des étudiants, que les nouvelles stratégies managériales de « l’ingénierie pédagogique » contemporaine feignent encore d’ignorer. Mais il convient d’insister surtout sur l’institutionnalisation, pendant plusieurs décennies, du péché originel de la psychopédagogie moderne : « la meurtrière “méthode globale” de lecture ».
Le fait est que les adversaires de la méthode syllabique « n’avaient rien compris à la Gestalttheorie ». La « psychologie de la forme », d’origine allemande, explique en effet que « toute perception est perception d’une forme sur un fond », ce qui, pour Borella, est « incontestable ». Or, toute « l’erreur des pédagomanes [fut] de croire que la lecture est une perception, alors qu’elle est saisie du sens d’un signe et non perception de sa forme visible » : « quand on sait lire, la forme comme telle devient quasi indifférente et n’est plus que le support presque invisible d’un sens ». La mécompréhension de la Gestalttheorie en pédagogie a donc des conséquences diamétralement opposées au but recherché : « en apprenant à percevoir la forme globale des mots », la méthode globale « empêche précisément qu’on puisse les lire ». Fort de ces décennies de récréation nationale, le niveau scolaire des écoliers s’est progressivement effondré, comme le montre le déclassement de la France au classement PISA. Cette difficulté acquise de la lecture n’explique-t-elle pas aussi, en partie, la diminution de la lecture au profit d’une prédominance « quasi hallucinatoire » de l’image dans les activités quotidiennes de nos contemporains ?
La crise de l’éducation n’est pourtant qu’un symptôme de la crise de la culture, qui se fonde sur l’abandon du principe Tradition. Selon Borella, l’insubordination des activités scientifiques, techniques et politiques à ce principe directeur prend la forme générale du progressisme, avec lequel ne se confond évidemment pas l’authentique « sagesse pédagogique ». D’une part, ce que méconnaît le progressisme, c’est que la tradition n’a rien à voir avec la simple « répétition » passive d’un donné, puisqu’elle implique un « effort » actif de conservation et de transmission d’un dépôt qui ne se communiquerait jamais aux générations futures sans cette décision de sacrifier de son temps et de son énergie à sa fructification. La tradition n’est donc pas le passé, mais l’avenir gros du passé. D’autre part, les théoriciens et poètes du progressisme, qu’ils se nomment Condorcet, Comte, Renan ou Cournot, en absolutisant l’idée de progrès, l’ont détruite, en même temps qu’ils ont porté préjudice à la connaissance et à l’amour de la tradition. Le progressisme repose en effet sur une double « malédiction » : « sur le plan théorique, l’idée de progrès rend le devenir inintelligible », et « sur le plan pratique, elle rend l’homme malheureux ».
Philosophies du progrès
Il n’y a en effet de progrès, normalement, que lorsque « dans un processus déterminé, l’état ultérieur est supérieur à l’état antérieur » par sa proximité avec le stade où ce processus « atteint, sous le rapport déterminé qui fonde le jugement de progrès, un terme qui est sa maturité ». Or, la première contradiction du progressisme est que « l’idée de progrès – absolu – détruit l’idée de progrès – relatif » : en ne considérant « plus aucun processus déterminé, mais tout processus en général », la moindre arrivée à maturité est condamnée à une obsolescence programmée, le progrès obtenu aujourd’hui devant être périmé par rapport aux progrès de demain. D’où l’impossible satisfaction de l’homme, impliquée par cette autre contradiction : « à la fois destin inévitable et exigence impérative » (“il faut être de son temps”, “innover”, “se moderniser”…), le progrès ainsi compris « conduit à ne jamais se satisfaire du moment présent », c’est-à-dire à ne jamais accepter que l’ouvrage soit fait. Le progressiste ne comprend plus cette évidence d’Aristote : « il faut s’arrêter ». À l’opposé du pédagogue antique, l’homme moderne s’obstine à vouloir, « dans tous les domaines », « produire plus, plus vite, et mieux, et consommer de même », en dépit du bon sens et de l’impossibilité écologique d’une telle attitude.
Ainsi Borella retrace-t-il la généalogie de cette mentalité, qui implique à la fois une redéfinition de la nature humaine et de la culture. D’une part, la conception de la nature humaine, et de la nature physique en général, ont été profondément remodelées par les divers avatars de l’« l’évolutionnisme » au XIXe siècle, qui réduisent l’essence des êtres à la genèse historique de leurs figures, tant spirituelles (Hegel) que matérielles (Teilhard de Chardin). Ces philosophies prennent cependant leur origine dans la crise à laquelle Borella a consacré de riches et incontournables analyses dans son maître-ouvrage, La Crise du symbolisme religieux : celle de « la révolution scientifique qui s’opère à partir du XVIe siècle ». Celle-ci est pour Borella la « première étape » de l’absolutisation indue de l’idée de progrès. En effet, les changements opérés en quelques siècles ont été incomparablement plus grands que ceux opérés, « en deux mille ans environ », depuis Aristote jusqu’à Abélard. L’ampleur de ces changements s’explique par l’apparition d’un « nouvel esprit », « celui qu’Auguste Comte appela l’esprit positif » : à l’inverse de la conception traditionnelle de la connaissance, « il consiste très exactement à se détourner d’une connaissance contemplative pour se tourner vers une science technicienne : “savoir c’est prévoir, prévoir pour agir” ».
Dans ces conditions, à partir du XVIe siècle, de symbole le monde devient ustensile, comme en témoigne le tournant cartésien. Les thèses historiquement déterminantes de Descartes ne furent pas, selon Borella, ses thèses phénoménologiques (« sur le doute, le cogito, la substance pensante », etc), mais ses thèses mécanistes dont la Sixième Méditation exprime l’ambition révolutionnaire : remplacer la philosophie par la technologie. « Descartes ne dit pas qu’il va substituer une nouvelle philosophie à une ancienne philosophie spéculative, qui est pour lui la philosophie scolastique, mais qu’il va la remplacer par une philosophie pratique. Pratique ici signifie : qui concerne l’action de l’homme sur le monde ; il s’agit, comme le montre la suite du texte, d’une philosophie de l’âge technique ».
Finalement, par cette critique négative de la modernité, le platonicien Borella vise, plus profondément, à réfuter la « superstition du fait » comme l’appelait Husserl : pour cet animal symbolique qu’est l’Homme, lequel vit dans un monde saturé de signes, il n’existe aucun fait qui ne soit déjà pris dans une signification. La vérité se détermine ainsi fondamentalement dans le champ philosophique du sens. En science même, « il ne suffit pas d’ouvrir les yeux pour faire des découvertes » : « on n’observe que ce que l’on cherche ». L’esprit du savant est nécessairement « orienté dans un champ problématique » : « ce qu’il perçoit du fait, ce n’est pas le fait lui-même, mais le rapport que ce fait entretien avec ce champ problématique ». Par extension, les événements qui adviennent dans l’histoire ont des causes sémantiques, philosophiquement exprimables : ce sont les idées qui mènent le monde, en ceci que « toute pratique, même la plus anodine ou la plus souhaitable, est porteuse d’une thèse philosophique, exprime un principe métaphysique, met en jeu un système doctrinal ». La tâche de la philosophie, en tant que « science des concepts », est alors de vérifier l’adéquation ou l’inadéquation de ces théorisations, non seulement à « la nature des choses », mais à « la nature humaine et à ses conditions d’existence ». L’histoire de la modernité est l’histoire de cette inadéquation.
[1] Cf. « Le nouveau péché originel », Philitt, No. 13, Automne-Hiver 2022, p. 51.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.