L’objectif est de sonder brièvement l’apport conservateur de la tradition libérale afin de relativiser l’antinomie, promue par Jean-Claude Michéa, de la logique libérale progressiste et de la « common decency » conservatrice.
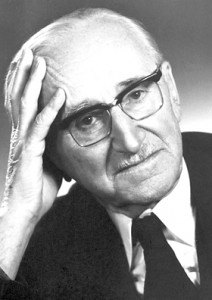
Le règne de l’individualisme dépeint par Jouffroy (voir la citation ouvrant la première partie) suggère, en réalité, une connexion entre l’individu et le sujet. L’individu est, par définition, sous une forme individuelle, à la fois séparé du Tout et unique. Le sujet renvoie quant à lui au « je pense », à l’humain comme subjectivité ; il est celui pour qui il y a de la représentation. A l’individu pensé comme sujet nous devons « l’individualisme le plus exagéré et le plus complet ». Faire de l’individu un sujet et, plus précisément, faire de l’individu un sujet en tant que système de représentation de l’ordre juridico-moral, c’est encore greffer de l’auto-nomie – capacité de se donner ses propres règles, de fonder ou créer un ordre – sur de la pure singularité : c’est exalter l’individu émancipé terreau du relativisme. L’individualisme de Jouffroy ne se soutient, non pas simplement par l’apparition d’un ensemble d’individus – horizon de toute façon incontournable de la modernité – mais, comme le relève Alain Renault, par la construction de l’individualité posée comme princeps, c’est-à-dire par la pénétration du sujet au cœur de l’individu. En effet, la subjectivité n’a pas pour base originelle l’individu. Le rapport à soi du « je pense » peut s’extraire jusqu’à atteindre l’universel : nul sujet n’est, à proprement parler, unique. Le modèle républicain a fait en sorte que le sujet puisse poser de l’objectif (du supra-individuel) à partir du subjectif. La morale kantienne, par exemple, emprunte cette voie ; on évite ainsi que l’individualité soit posée comme princeps.
Cependant une autre alternative, à la fois libérale et conservatrice, demeure possible – elle ne représente qu’un pan du libéralisme – et consiste à intégrer l’individu dans l’ordre immanent généré par la société civile. Une alternative libérale tout à fait en phase avec l’esprit conservateur résumé par Russell Kirk dans The Conservative Mind. Kirk décrit l’inclination conservatrice en six points (préférence donnée à la tradition sur la raison, connexion entre propriété privée et liberté, foi en l’existence de distinctions naturelles étrangères à la loi positive, préférence pour les changements lents contrairement aux réformes ou innovations, etc…) et la tendance progressiste en quatre points (notamment : la foi en la perfectibilité de l’homme, l’accroissement d’une politique démocratique et une préférence donnée à la raison sur la tradition). Les libéraux-conservateurs s’engagent dans cette brèche. Il est possible que le libéralisme abrite un germe antimoderne en prenant pour norme, comme chez les Anciens, « non pas la raison du sujet, mais un élément substantiel, l’ordre cosmique qui, en tant qu’indépendant du sujet, constitue une dimension de l’objectivité » (Luc Ferry et Alain Renaut). En effet, l’individualisme décrit par Jouffroy sous-tend une liberté conçue « comme faculté d’autodétermination ». Ainsi, « tout ce qui fait obstacle à cette autodétermination, donc à la liberté, est alors perçu comme moralement intolérable parce que destructeur, dans son être le plus intime, de cette individualité dont on a posé qu’elle était le fondement et la fin ultime de tout ordre social ». Nous pensons qu’un libéralisme d’obédience conservatrice exige la consécration d’une liberté individuelle sans faculté d’autodétermination et/ou la transmission de cette autodétermination aux institutions de la société civile plutôt qu’aux individus. Dans une telle optique, l’individu – très proche de la monade leibnizienne l’impulsion divine en moins – se dissout dans l’ordre « providentiel » des actions humaines ; ce que Friedrich Hayek appelle l’ordre spontané ou cosmos.
L’apport conservateur de la tradition libérale
Le cosmos, en tant qu’ordre auto-engendré, endogène et complexe – Hayek oppose cette ordre cosmique « mûri par le temps » à l’ordre confectionné, organisé, volontaire (taxis en grec) – se veut complètement extérieur au sujet bien qu’il soit produit par des individus libres ; libres mais toujours déjà dépassés par l’ordre qu’ils produisent sans le vouloir. Le mérite de Hayek est d’avoir réinjecté une dose d’hétéronomie en envisageant la possibilité d’un ordre directement issu de la disparité des projets individuels : un ordre sans le moindre dessein. Le cosmos hayekien dérive d’une analyse minutieuse du marché. L’auteur autrichien a compris que le marché, en tant qu’institution engendrée par un ensemble d’individus ne se souciant pourtant que d’eux-même, peut aboutir à une structure contraignante. Chacun est certes libre d’agir comme il le souhaite mais le résultat des interactions de l’ensemble dévoile une entité normative. C’est le cas, entre autre, lorsque la loi de l’offre et de la demande définit une normativité des prix : le fameux « prix du marché ». Si un acteur économique décide de baisser ou d’augmenter ses prix au-delà du prix du marché, il s’expose au risque de se retrouver soit, cas de baisse excessive, en situation de pénurie, soit, cas de hausse, en situation d’excédent. L’agent économique n’est, bien sûr, pas obligé de suivre la norme qu’impose le marché mais il a tout intérêt à le faire. Cette petite digression économique doit nous permettre de comprendre comment, chez Hayek, fonctionne la production normative générale. Le mariage, par exemple, en tant qu’institution, devrait cristalliser l’ensemble des choix relatifs à l’union conjugale sous une forme normative. A priori il y aurait une concurrence entre institutions (religieuses et « notariales ») habilitées à proposer différents types de contrats de mariage mais, a posteriori, le juge trancherait en recherchant une normativité commune : « Lorsque le juge est appelé à trancher le cas, les parties au procès ont déjà agi selon leurs fins respectives (…) la tâche du juge est de leur dire ce sur quoi elles auraient dû fonder leurs perspectives, non parce que quelqu’un leur aurait dit quelle était la règle, mais parce que telle était la coutume établie qu’elles auraient dû connaître ». Point capital. La règle régissant l’institution n’a pas été posée par la volonté du législateur (ni même par la volonté d’une institution) mais découle de la nature des choses ; « le seul bien public dont il (le juge) ait à se préoccuper est que soient respectées des règles sur lesquelles les parties pouvaient raisonnablement s’appuyer ». Les actions humaines étant le ferment de l’ordre cosmique, les règles de juste conduite ont pour fonction première de préserver la viabilité des projets individuels en créant un monde commun : « les règles qui se répandront seront celles qui, gouvernant les pratiques et coutumes existant dans divers groupes, rendent certains plus vigoureux que les autres » et, « en outre, certaines règles deviendront dominantes parce qu’elles guident mieux les pronostics dans les relations avec d’autres personnes qui agissent indépendamment ». A l’instar de Bruno Leoni, Hayek oppose l’incertitude de la législation à la stabilité du Droit coutumier.

Nous voyons bien comment le philosophe et économiste viennois a pu sans mal définir la démocratie comme un simple moyen chargé, par le biais d’une alternance, d’éviter les conflits tout en proposant une refonte constitutionnelle censée limiter le volontarisme politique ; comment il a pu également réprouver le rationalisme cartésien des droits de l’homme renouant ainsi, pour une part seulement, avec l’esprit antimoderne d’un Michel Villey pourfendeur du subjectivisme juridique ou du droit attaché au sujet. Nous avons affaire, comme chez Hume ou Leibniz, à un individualisme sans sujet. Il existe, à n’en pas douter, une réelle différence ente ce genre de libéralisme et celui d’un John Stuart Mill qui place le curseur de la liberté au niveau de l’originalité et de l’émancipation individuelle. Il y aurait donc un individualisme cohérent, intégré, dont Hayek poursuit, à sa manière, la tradition héritée des Lumières écossaises – particulièrement celle de l’ineffable David Hume dont Lucien Jaume a parfaitement saisi la spécificité : « le vrai sujet de la liberté est (donc) selon Hume le corps social conçu comme jeu d’interactions permanente, qui se régule indépendamment de l’État par une logique à la fois naturelle et artificielle, l’artifice (note : l’artifice du droit, de la politique) n’étant qu’un prolongement de la nature et non ce qui s’en sépare ».
Michael Oakeshott assoit lui aussi son scepticisme libéral sur l’exigence d’un ordre conservateur. Il définit le conservatisme comme une attitude, une disposition « à préférer le familier à l’inconnu, ce qui a été essayé à ce qui ne l’a pas été (…) le proche au lointain, le suffisant au surabondant, le convenable au parfait, le rire de l’instant présent à la béatitude utopique ». Oakeshott prend l’exemple de l’amitié comme illustration d’un esprit conservateur : « la relation entre amis est excitante, non pas utilitaire ; le lien est de l’ordre de la familiarité, non de l’utilité ; la disposition concernée est conservatrice et non « progressiste » ». Il croit, par ailleurs, sérieusement aux vertus conservatrices d’un gouvernement libéral. Préférence pour un gouvernement conservateur entretenue par « certaines croyances sur l’acte de gouverner » ; croire, notamment, « que gouverner est une activité spécifique et limitée, à savoir une activité qui consiste en l’apport et en la préservation de règles générales de conduite, comprise non comme des plans pour imposer des activités importantes, mais comme des instruments permettant aux gens de poursuivre les activités de leur choix avec un minimum de frustration ». « En résumé, il faut rechercher les suggestions du gouvernement dans le rite, non dans la religion ou la philosophie ; dans la jouissance d’un comportement ordonné et paisible, non dans la recherche de la vérité ou de la perfection ». Le philosophe britannique reprend en substance la critique du rationalisme politique développée par Hayek et Burke. La persistance d’un conservatisme érigé en disposition à agir répondrait adéquatement à la vie des sociétés humaines : il est en effet acquis pour Oakeshott que l’histoire ne constitue nullement une marche vers le progrès et qu’un ordre stable suppose une appétence certaine pour ce qui relève du sens commun.
Dans cette perspective conservatrice la liberté prend sa source principalement dans l’histoire, la tradition : elle n’est pas à créer mais à (re)découvrir. Edmund Burke a recherché la liberté dans l’histoire anglaise comme Edouard Laboulaye a recherché les racines de l’enseignement libre, non pas dans l’émancipation politique républicaine – celle proposée par Jules Ferry convaincu d’apporter le progrès –, mais au plus profond de l’identité française, à savoir le Moyen Âge ou l’époque d’un enseignement dévolu aux institutions religieuses. Il suffirait de restituer les échanges féconds au sujet de la liberté d’enseignement entre les « libéraux familialistes » – ceux qui, comme Lamartine et Lammenais, défendent la liberté familiale de choisir le type d’enseignement jugé adéquat pour l’enfant indépendamment de la volonté de l’Etat – et les doctrinaires, Guizot en tête, défendant une position plus mesurée, pour bien comprendre que le libéralisme monarchique n’a pas la même couleur qu’un libéralisme évoluant sous la bannière d’une république démocratique déjà bien mûre. Michéa rétorquerait sans doute que la monarchie de juillet n’est qu’une étape dans le développement du processus libéral. Même constat chez Charles de Montalembert comme l’atteste son admiration pour les libertés féodales (libertés locales, privilèges) et son exécration de la démocratie à la fois entendue comme régime politique et état social : il confia au moine bénédictin Dom Guéranger avoir toujours aimé la liberté coupée de l’égalité, de la démocratie et, évidemment, de l’esprit révolutionnaire. Nous voyons donc mal comment les rouages de ce versant libéral culmineraient (du moins fatalement) en une fâcheuse déconstruction des mœurs.

Il faut à présent, pour conclure, reprendre succinctement les exemples d’une logique libérale à l’œuvre retenus par Jean-Claude Michéa. « Si on se place, nous dit-il, sur le plan des relations des individus entre eux, sur quelle base décider que le fait de critiquer une religion (ou de la tourner en dérision) ne nuit pas à l’exercice de la liberté bien comprise des croyants ? Dans quelle mesure, à l’inverse, les enseignements de telle ou telle religion sur le statut de la femme ou de la nature de l’homosexualité ne portent-ils pas directement atteinte aux « droit des minorité » ? Devant ces questions, multipliables à l’infini, le Droit libéral est obligatoirement en grande difficulté ». Cette difficulté du « Droit libéral » aboutirait à « l’apparition d’une nouvelle guerre de tous contre tous » fruit de « ce processus d’extension infinie des droits individuels (ou libéralisation des mœurs) ». Mais comment ne pas voir ici l’influence du préjugé démocratique répondant, par l’octroi de nouveaux droits, à une logique tout à fait d’actualité mais imputable principalement au passage d’une simple tolérance libérale à une demande de reconnaissance des individualités, à une volonté d’étendre l’égalité jusque dans la différence ? Comment ne pas, à l’inverse, déchiffrer la mécanique haletante de la «fusion-inquisition» murayienne ? Comment ne pas imputer une telle dérive libérale à l’action de ces automédons de l’égalité aveugle ? Car ce sont « les plus sinistres des inquisiteurs et les plus noirs des criminels légaux, puisque tout, autour d’eux, demeure encore suspect, plus ou moins hiérarchisé (…)». Suspect car, selon eux, encore hiérarchisé. Une «fusion-inquisition» libérale, autrement dit une demande, à la fois, d’égalité dans les différences et d’interventions punitives pour corriger la situation.
