La propriété constitue l’un des principaux piliers de la société moderne, notamment occidentale. Néanmoins, le droit de propriété, entendu comme le pouvoir absolu et illimité de l’individu sur la chose appropriée, est un concept relativement récent, qui naît du mouvement de sécularisation de la pensée juridique, initié au XVIIe siècle. Nulle propriété humaine possible, en effet, si l’on considère que toute chose appartient exclusivement et absolument à Dieu. La pensée biblique, patristique et médiévale voit en Dieu le seul propriétaire véritable de la terre, l’homme n’étant que son gestionnaire. Le droit moderne de propriété doit donc être apprécié pour ce qu’il est : un transfert, de Dieu à l’homme, de la seigneurie sur la création. Autrement dit, un blasphème.

« La propriété, c’est le vol ! », avait averti Pierre-Joseph Proudhon en 1840 (Qu’est-ce que la propriété ?). Pourtant, la propriété est aujourd’hui unanimement considérée comme un droit inaliénable. En dépit des conséquences néfastes qu’il entraîne sur le plan écologique, dénoncées par Karl Polanyi, ou des inégalités qu’il fait naître, le régime de la propriété fait actuellement l’objet d’un large consensus. Alors que les ordolibéraux et autres « conservateurs » défendent la propriété individuelle sur les choses, leurs adversaires « progressistes », parfois « anticapitalistes », revendiquent une propriété de l’individu sur lui-même (« Mon corps m’appartient ! »), dans une ligne de pensée somme toute très lockienne, donc libérale, permettant de justifier une série de droits sur son propre corps : droit au suicide assisté, à l’avortement ou à la transition sexuelle. Tout, de l’eau aux animaux, est appropriable et approprié. Rien, pas même une chose aussi abstraite et indéfinissable que les idées (« propriété intellectuelle »), n’échappe au régime de la propriété.
Dans tous ces cas, la propriété implique un droit absolu sur la chose appropriée, que celle-ci soit extérieure à l’individu (son domaine) ou qu’elle lui soit consubstantielle (son corps). Le droit de propriété, ou droit d’user et d’abuser (jus utendi et abutendi), est en effet défini, depuis 1804, comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du Code Napoléon). Se dessine ainsi une double caractéristique du principe moderne de propriété : son absolutisme (pouvoir absolu sur une chose) et son exclusivisme (pouvoir d’un unique titulaire, qu’il soit un individu ou un être collectif, une personne morale, sur cette chose, à l’exclusion de tous les autres). Si des restrictions circonstancielles sont admises, le principe d’un pouvoir absolu et exclusif sur les choses, lui, n’est jamais remis en cause per se. La propriété, cette invitation à devenir « maîtres et possesseurs de la nature » (Descartes), loin de naître avec les premières sociétés humaines, comme le pensaient les philosophes des XVIIe-XVIIIe siècles (Hobbes, Locke, Rousseau), apparaît en réalité beaucoup plus récemment, à l’époque moderne et contemporaine (XVIe-XIXe siècles).

Le droit de propriété peut à maints égards être appréhendé comme un transfert de l’autorité sur la création, que la pensée patristique et médiévale accordait à Dieu, à l’homme lui-même. Ce transfert résulterait de la sécularisation de la pensée que connaît l’Europe durant l’époque moderne. Si les sociétés prémodernes reconnaissent en effet, selon la distinction opérée par Proudhon, la possession (c’est-à-dire l’usage des choses, le droit d’usufruit des hommes sur la chose), elles ne garantissent jamais l’existence de la propriété (entendue comme le droit absolu et illimité sur la chose), qui impliquerait une appropriation du pouvoir de Dieu par l’homme et constituerait à proprement parler un blasphème, une négation de la prééminence de Dieu par sa propre créature. C’est du moins là l’intuition de plusieurs auteurs chrétiens tels qu’Emmanuel Mounier : « Le capitalisme, comme le paganisme [fasciste], comme le communisme (on ne transfigure pas un sentiment en l’élargissant) est l’hérésie qui attribue à l’homme le domaine éminent de Dieu. » (De la propriété capitaliste à la propriété humaine). Une question se pose alors : comment le droit de propriété, cette « hérésie » moderne, a-t-il pu apparaître dans la pensée théologique occidentale ? Comment le passage du droit absolu de Dieu sur sa création au droit tout aussi absolu de l’individu sur les choses appropriées a-t-il été rendu théologiquement possible ?
La pensée biblique et patristique : Dieu seul propriétaire
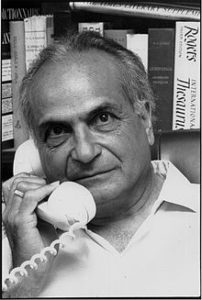
Dans la pensée biblique, Dieu seul, en tant que Créateur, dispose d’un droit absolu et illimité sur les choses qu’il a créées. La Bible hébraïque associe en effet la seigneurie de Dieu sur l’univers à l’acte de la création : « À l’Éternel [appartient] la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui l’habitent ! Car il l’a fondée sur les mers, et affermie sur les fleuves. » (Ps. 24 [23], 1-2 ; voir aussi Ps. 50 [49], 10-12). Dieu seul est seigneur, propriétaire, du monde. Cette affirmation a des répercussions concrètes sur l’organisation de la société : si Dieu est l’unique propriétaire de sa création, l’homme ne peut l’être également. Ainsi que l’affirme le bibliste André Chouraqui, « La notion de propriété est elle-même affectée par la notion que les Hébreux ont de Dieu et de la terre. À proprement parler, YHWH [l’Éternel] est l’unique propriétaire de la création entière. L’homme est l’usufruitier de la terre : les familles, les clans d’avantage que les individus jouissent de sa possession. La transmission suit des lois très strictes qui en limitent l’exercice. Elle n’est jamais définitive. » (Les hommes de la Bible).
La législation hébraïque donne ainsi de nombreuses restrictions à la possession : interdiction d’exploitation le jour du sabbat, obligation de laisser une partie des récoltes aux pauvres (droit de glanage), consécration des premières récoltes à Dieu… Par conséquent, tout droit d’user et d’abuser, de disposer librement de sa possession, est strictement prohibé. De plus, les possessions sont redistribuées lors du jubilé, à la fin du cycle sabbatique tous les cinquante ans, pour empêcher la concentration des terres entre les mains des plus puissants (Lv. 25, 8-17). En fait, plutôt que des propriétaires, les Israélites sont des gestionnaires et la gestion de leurs biens est toujours susceptible d’être critiquée, contestée ou même confisquée par Dieu. La possession est, partant, toujours limitée. Elle peut être remise en cause, par exemple, par le droit du pauvre, qui lui est opposable. Le prophète Amos critique ainsi les détenteurs de richesses qui préfèrent en user à leur convenance plutôt que les partager avec le pauvre : « Vous violez à la porte le droit des pauvres. » (Am. 5, 12). Il existe donc un droit du pauvre qui prend le pas sur la possession et rend de ce fait toute propriété inenvisageable. Par conséquent, la propriété n’existe pas dans la pensée hébraïque : la prétention à un pouvoir absolu et illimité d’un individu sur une chose aurait été vue comme une atteinte à la souveraineté de Dieu, comme un véritable blasphème.

Le Nouveau Testament ne change pas la donne et approfondit même cette tendance puisque, dans l’Église de Jérusalem, les possessions sont mises en commun, sous le regard des apôtres (Ac. 4, 32-35). La communion des esprits s’incarne ici dans la communauté des biens. Paul de Tarse rappelle en outre l’importance de la redistribution des possessions, selon une « règle d’égalité », qui pourrait être vue comme une adaptation de l’idéal israélite du jubilé aux convertis non-juifs : il faut que « votre superflu pourvoi[e] à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu’il y ait égalité » (2 Cor. 8, 13-14). Le but visé ici est la constitution d’une communauté égalitaire où la solidarité prévaudrait sur la possession. Les possessions ne sont donc jamais absolues et leur détenteur se voit conférer une liberté limitée sur elles, toujours susceptible d’être remise en cause. L’apôtre réfute également tout droit illimité de l’individu sur son propre corps : « Vous ne vous appartenez point à vous-mêmes », mais à Dieu (1 Cor. 6, 19-20). On ne peut donc pas parler, là non plus, de propriété.
On retrouve le même type de raisonnement dans la pensée patristique. Les Pères de l’Église, reprenant ces passages bibliques, affirment que le seul propriétaire de la création est Dieu, et que les hommes n’en sont que les usufruitiers, les gestionnaires. Jean Chrysostome demande ainsi : « Mais n’est-ce pas un mal que de retenir seul ce qui appartient au Seigneur, que de jouir seul du bien qui est à tous ? et la terre n’est-elle pas à Dieu, avec tout ce qu’elle renferme ? Si donc nos richesses appartiennent au Seigneur du monde, elles sont aux hommes qui sont ses serviteurs […] ; car tout ce qui appartient au Seigneur est pour l’usage de tous. » (Commentaires sur la Ire et la IIe Épîtres à Timothée, XII, 4). Basile de Césarée fait le même constat : « Rends-toi compte, ô homme, de qui tu tiens ces dons [matériels], […] de quels biens tu as la gestion, qui te les a confiés, quelles raisons t’ont fait préférer à d’autres. Tu es le serviteur du Dieu bon, l’économe de tes compagnons de service. Ne crois pas que tous ces apprêts ont été faits pour ton ventre. Traite les biens que tu as entre les mains comme s’ils appartenaient à autrui. » (Homélie 6 sur l’accumulation des biens, 2). L’homme n’est pas propriétaire, il reçoit ses biens de Dieu qui lui en confie la gestion. Par conséquent, Dieu dispose d’un droit de regard sur cette gestion : l’homme n’est pas libre d’user de ses possessions comme bon lui semble. La seigneurie absolue de l’homme sur les choses est ainsi vivement réfutée par Grégoire de Nysse : « si quelqu’un voulait être le maître absolu de toute chose et privait ses frères […], ce serait un tyran vicieux, un barbare qu’on ne peut se concilier, un fauve insatiable » (De la bienfaisance, 15). Alors que le concept moderne de propriété se fonde sur une injonction à user et à abuser de son bien, le Père cappadocien propose un impératif beaucoup plus restrictif : « Use, n’abuse pas. » (Id., 16). Les Pères de l’Église défendent donc un droit limité de l’homme sur les choses et voient, à l’instar des auteurs bibliques, toute prétention à un droit absolu et illimité sur ces choses comme un blasphème contre la souveraineté de Dieu, seul propriétaire de la création.
La pensée médiévale : théologies du domaine

Durant la période médiévale, le droit de propriété demeure également inenvisageable. Comme le note le médiéviste Jacques Le Goff, « La propriété, comme réalité matérielle ou psychologique, est presque inconnue du Moyen Âge. Du paysan au seigneur, chaque individu, chaque famille n’a que des droits plus ou moins étendus de possession provisoire, d’usufruit. » (La civilisation de l’Occident médiéval). Le paysan ne dispose pas d’un droit absolu et illimité sur sa terre, puisqu’il doit rendre compte de sa gestion à son seigneur. De même, ce seigneur est à son tour responsable devant son suzerain, celui-ci pouvant être le roi. Le roi, quant à lui, ne dispose pas d’un droit de propriété sur son territoire (qu’il ne peut ni vendre, ni aliéner, ni donner) mais reste le simple vassal du seul propriétaire de la terre, Dieu. La société féodale consiste ainsi en une hiérarchie pyramidale qui autorise la possession simultanée d’une même terre par plusieurs détenteurs, mais refuse explicitement la propriété, le droit exclusif d’un individu sur une chose, Dieu demeurant l’unique bénéficiaire d’un droit absolu et illimité sur sa création.
Les théologiens médiévaux, comme Jacques de Viterbe, Armacchanus ou Jean Gerson, appellent domaine, dominium, ce droit de Dieu sur sa création. Le domaine désigne le pouvoir absolu de Dieu sur toute chose et tout être, qui vient du fait qu’il est leur Créateur et qu’il a établi les lois de l’univers. Thomas d’Aquin montre ainsi que « le domaine sur toutes les créatures est propre à Dieu » (Somme théologique). Toutefois, ces théologiens sont à l’origine d’une première inflexion. En effet, ils confèrent à l’homme un domaine qui découle et participe du domaine divin. Dans la Bible, l’homme se voit confier par Dieu la domination sur la terre et les autres espèces (Gen. 1, 26-28). D’après les théologiens scolastiques, influencés par Aristote, l’homme devient, par décision de Dieu, la tête du tout hiérarchisé qu’est la création, le représentant de Dieu sur terre, et se voit ainsi confier le pouvoir d’ordonner les autres créatures, de les soumettre par la raison afin qu’elles contribuent à la louange universelle de Dieu par son intermédiaire. Partant, si Dieu reste le Seigneur principal de la création, l’homme devient son seigneur secondaire. Le domaine de Dieu sur toute chose dispose donc d’une exclusivité idéale (et non matérielle) qu’il partage, dans les faits, avec l’existence d’un domaine humain. Ce dernier découle de la volonté de Dieu, qui donne à l’homme le pouvoir sur la création pour qu’il la fasse participer à la nature divine, comme l’affirme par exemple Hugues de Saint-Victor. Dès lors, le pouvoir humain sur les choses, s’il n’est pas absolu et demeure limité par une finalité (la glorification de Dieu), n’en n’est pas moins fondé en droit, légitimé par le discours théologique et doté d’une puissance irrésistible, la volonté de Dieu elle-même.
L’éviction de Dieu : l’homme seul propriétaire

Tout l’effort de la pensée moderne consiste à opérer une rupture, une dissociation radicale, entre le domaine de Dieu sur sa création, qui devient purement théorique et abstrait, et le domaine de l’homme sur les choses, concret et réel. Cette évolution vise à désencastrer le domaine humain du domaine divin, à le rendre autonome par rapport à ce dernier. Un premier pas est franchi par les penseurs de la seconde scolastique. Comme l’a montré l’historienne du droit Marie-France Renoux-Zagamé (Origines théologiques du concept moderne de propriété), des auteurs tels que Domingo Báñez, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Leonardus Lessius, Paul Leymann ou Francisco Suárez sont à l’origine d’une innovation majeure. Poursuivant les prémisses de Thomas d’Aquin, ces théologiens fondent le domaine humain, non plus sur la seule volonté divine, mais surtout sur la nature raisonnable de l’homme. Cette innovation, qui vise à écarter les dérives nominalistes des siècles précédents (si le domaine humain est fondé sur la seule volonté de Dieu, Dieu peut le retirer à l’homme en cas de mauvaise conduite), tend à autonomiser, au moins en partie, le domaine humain par rapport au domaine divin. L’homme se voit conférer un pouvoir naturel sur les choses, qui n’est plus seulement justifié théologiquement, mais avant tout juridiquement, par le droit naturel. Le dominium est associé au jus, au droit naturel, plutôt qu’à la volonté divine. Les penseurs de la seconde scolastique participent donc, malgré eux, à une sécularisation du pouvoir humain sur les choses. Malgré tout, ce pouvoir demeure limité par la nature humaine elle-même, par la fonction de l’homme dans l’univers (l’organisation des créatures par la raison). De plus, si la justification théologique est nuancée, elle n’est pas tout à fait écartée. Le droit d’abuser n’est donc pas encore pleinement légitimé et des limitations au droit d’user demeurent.

Ce sont les jusnaturalistes modernes qui, à partir du XVIIe siècle, poussent progressivement cette évolution à son terme. Si Grotius et Pufendorf admettent encore de rares réserves et continuent de rattacher partiellement le domaine humain à Dieu, Thomasius, Hobbes, Locke et leurs successeurs vont opérer un désencastrement total du droit humain sur la création par rapport à son fondement divin. Prolongeant le raisonnement des théologiens de la seconde scolastique, ces philosophes parviennent à justifier un pouvoir absolu de l’homme sur la création en détachant totalement et définitivement le domaine humain sur les choses, que l’on appellera de plus en plus propriété, du domaine de Dieu, de la souveraineté divine sur l’univers. Le droit de l’homme sur les choses est ainsi exprimé, non plus comme découlant d’une concession divine, mais comme un droit attaché à la seule nature humaine. Pour ce faire, les jusnaturalistes montrent que le pouvoir humain sur les choses ne résulte pas d’un ordre explicite de Dieu, comme le pensaient leurs prédécesseurs, mais d’une simple possibilité d’organisation du monde laissée par Dieu à l’homme. Dès lors, le domaine humain constitue un droit mais, ne découlant pas de la volonté de Dieu, ce droit n’est contrebalancé par aucun devoir juridique ou moral. Bien plus, ce droit doit être rattaché, non à un ordre divin, mais à la nature propre, intrinsèque, de l’homme. Ce dernier peut donc user des choses comme bon lui semble, puisque cette utilisation est indifférente à Dieu : elle est neutre du point de vue de la volonté divine. Se trouve ainsi théorisé un droit absolu et illimité de l’homme sur les choses, qui n’est plus restreint par des limitations théologiques ou éthiques. Le droit d’user et d’abuser est légitimé : la propriété est née.
L’apparition du droit de propriété, produit de la sécularisation occidentale, traduit donc un transfert du pouvoir exclusif de Dieu sur sa création vers l’homme. L’individu, nouveau dieu, se voit conférer un droit absolu et illimité sur les choses appropriées, comme s’il les avait créées. Dès lors, la propriété privée doit être appréhendée avant tout comme une propriété privée de Dieu. Elle constitue bien le vol par excellence, puisqu’elle conduit à dépouiller Dieu de son pouvoir intrinsèque au profit d’un être qui n’a en lui-même aucune légitimité à exercer une si haute dignité, l’homme. Proudhon, cet athée chrétien, l’avait d’ailleurs entrevu dans sa remarquable lucidité : « À qui est dû le fermage de la terre ? Au producteur de la terre, sans doute. Qui a fait la terre ? Dieu. En ce cas, propriétaire, retire-toi. » Ce n’est sans doute pas la moindre des ironies qu’un auteur anarchiste en appelle à Dieu pour rappeler cette vérité à ses adversaires bourgeois et chrétiens. Que les athées ou les agnostiques acceptent la propriété individuelle passe encore. Mais que des croyants se prétendant fidèles à la révélation biblique admettent et défendent un tel pouvoir de l’homme sur les choses créées et, par voie de conséquence, nient ainsi l’autorité absolue et illimitée de Dieu seul sur sa création, voilà qui ne saurait être toléré. L’homme n’est pas propriétaire de la création, Dieu seul l’est : l’homme n’en est que le gestionnaire, le possesseur. Contre l’hérésie moderne de la propriété et la déification de l’homme qui en résulte, il convient d’affirmer la seigneurie de Dieu seul sur l’univers, « Car le roi de toute la terre, c’est Dieu » (Ps. 47 [46], 8), non l’homme. Affirmer le contraire reviendrait, n’en doutons pas, à proférer le pire des blasphèmes.
