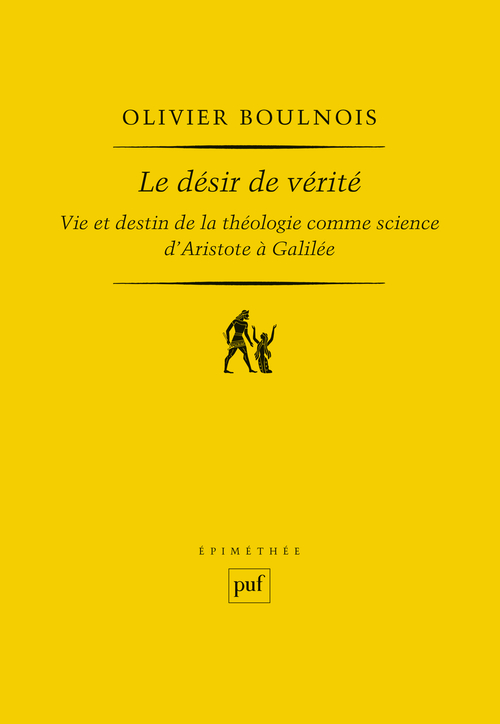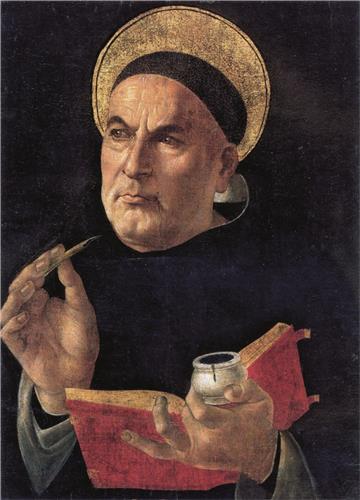Dans Le Désir de vérité : vie et destin de la théologie comme science d’Aristote à Galilée, Olivier Boulnois retrace l’histoire de la « science théologique », de son surgissement grec jusqu’à « l’effondrement de la clé de voûte » à l’aube du XVIe siècle. Loin de se limiter à l’alternative entre le Dieu de la révélation et celui des philosophes, la theologia grecque, récupérée par les Pères latins et érigée en « reine des sciences » par la scolastique, a fait l’objet, à partir du moment thomiste, d’une déconstruction qui se poursuit à l’époque contemporaine.
PHILITT : Votre ouvrage relate l’épopée de la théologie, de son surgissement grec à la « fin du désir de Dieu », à l’époque moderne. Pourquoi avoir relu l’histoire de la théologie à l’aune du « désir de vérité » et quelle articulation établissez-vous entre ce désir de vérité et le « désir de Dieu » ?
Olivier Boulnois : Nous vivons tous sur des clichés. Par exemple, l’idée qu’au Moyen Âge, la philosophie est la servante de la théologie. Mais en parlant de philosophie « servante » de la théologie, on prend le problème à l’envers. Car depuis son origine aristotélicienne, la théologie est une science philosophique, la plus haute science possible, la « science théologique ». Si je me suis lancé dans une histoire de la théologie « comme science » (sous-titre du livre), c’était pour montrer comment celle-ci se développe en se différenciant, comme les branches d’un arbre : une branche de la science théologique demeure purement philosophique (et parfois en conflit avec la pensée religieuse), tandis qu’une autre branche reprend à son compte la révélation et en donne une interprétation. Dire que la philosophie est « servante » de la théologie, c’est dire en réalité qu’une branche de la philosophie est greffée sur une autre et en dépend.
C’est dans cette perspective qu’il faut lire le « désir de vérité ». La Métaphysique d’Aristote commence, dès ses premiers mots, en affirmant que l’homme désire par-dessus tout connaître la vérité. Or ce qui accomplit ce désir, c’est par excellence la philosophie. Et le sommet de la philosophie, c’est la science du divin (qu’Aristote appelle theologikè epistemè, « science théologique »). Il ne faut pas oublier que même la vie intellectuelle est elle-même une manière de vivre, c’est même pour Aristote la plus haute forme de l’existence. Or en parlant de désir de Dieu, Augustin ne dit pas autre chose : si Dieu est le souverain bien, il est aussi celui qui comble nos plus hauts désirs. Il y a donc une articulation possible entre le désir de vérité chez Aristote et le désir de Dieu chez Augustin. D’ailleurs, pour Augustin, Dieu est la Vérité, c’est son nom le plus propre. Donc, Augustin part de la même analyse qu’Aristote. Il a d’ailleurs écrit : « l’homme ne désire rien tant que la vérité ». Mais il place le sommet en Dieu : connaître Dieu, c’est connaître la vérité suprême, c’est assouvir notre désir le plus profond.
Retracer la vie et le destin de la théologie comme science vous conduit à étudier son apogée et notifier son déclin. Quand situez-vous cette apogée et à quand remonte son déclin ?
En réalité, je n’ai pas réellement construit mon enquête sur ce schéma emprunté à l’histoire des empires : essor et déclin, Aufstieg und Niedergang. La naissance d’une science théologique peut être décrite assez précisément, si on analyse Aristote de près. Par la suite, chez les stoïciens, le concept aristotélicien s’est transformé en théologie mythique, physique, et politique. À la période hellénistique, il est devenu la science suprême du néoplatonisme. Il ne s’agit donc pas d’un essor, d’un progrès, mais d’une restructuration et d’une transformation.
Ce qui me tracassait davantage, c’est l’autre bout de cette histoire. En tant qu’historien de la philosophie et, à travers cela, philosophe, j’avais une impression difficile à justifier : du XIIIe au XVe siècle, à peu près, la théologie est la discipline prédominante ; mais ensuite, elle cesse de l’être. Pourquoi ? Il y a des raisons institutionnelles à sa prédominance, puisque c’est l’Église qui parraine l’université, et qui institutionnalise l’enseignement de la philosophie à la faculté des arts. Mais il y a aussi des raisons doctrinales : nous sommes dans un dispositif du savoir, une epistemè, où les grands philosophes sont aussi de grands théologiens (d’Albert le Grand à Pierre d’Ailly, par exemple). Mais à partir du XVIIe siècle, nous sommes bien en peine de trouver des grands théologiens qui ont apporté quelque chose à la philosophie. Il y a donc eu une rupture. D’où vient-elle ?
Je pense qu’on peut avancer trois hypothèses : 1. D’abord, la condamnation de Pomponazzi au Concile de Latran V (1513). En généralisant son refus de la position de Pomponazzi et en exigeant une démonstration philosophique de l’immortalité de l’âme, le Concile visait une véritable mise au pas de la philosophie, en appelant les philosophes à démontrer certaines vérités essentielles de la foi (Descartes s’en réclamera encore). Mais il a eu un effet pervers inattendu. Il a en réalité dépouillé la théologie de tout objet propre : si le philosophe devient un « philosophe chrétien », s’il a pour tâche de démontrer les vérités de la foi chrétienne, que reste-t-il au théologien ?
2. Deuxième hypothèse : la théologie s’est détachée par rapport, justement, à cette logique du désir que l’on trouvait aussi bien chez Aristote que chez Augustin. Chez certains théologiens, tout se passe comme si, d’un côté, il y avait désormais le désir naturel de l’homme, lequel ne pourrait plus être assouvi que par des vérités philosophiques et par le Dieu des philosophes, et de l’autre, le surnaturel, qui ne vient plus combler le désir naturel, mais qui est en quelque sorte surimposé dans son ordre propre, mis en nous par Dieu, ce qui veut dire que le désir de Dieu n’est plus le désir naturel de l’homme. C’est vraiment le génie d’Henri de Lubac d’avoir aperçu les subtiles déformations qui se sont produites à la fin du Moyen Age et qui ont amené ces mutations. J’ai donc repris le dossier, en retravaillant les textes. Ce que j’ai découvert est assez stupéfiant : à l’origine, cette nouvelle définition du désir de Dieu était explicitement dirigée contre saint Thomas d’Aquin. Mais lorsque Cajetan la fait sienne, il ne peut pas s’élever franchement contre Thomas, puisqu’il est le maître général de l’ordre dominicain et le défenseur de l’école thomiste : il glisse donc cette idée dans son commentaire de Thomas comme si elle était chez Thomas. C’est un exemple typique de ce qu’on fait quand on appartient à une école : on fait dire au maître ce qu’on pense soi-même, et non pas ce qu’il a vraiment dit.
3. Enfin, il y a une troisième hypothèse, c’est l’idée que la nouvelle physique a supplanté la théologie. Quand on étudie l’affaire Galilée, on s’aperçoit que le cardinal Bellarmin lui a proposé une solution au fond traditionnelle, qui maintenait la supériorité de la théologie tout en lui permettant de soutenir l’héliocentrisme. Il aurait suffi à Galilée de dire qu’il parlait « selon les principes de la science de la nature », et qu’il ne prétendait pas dire la vérité absolue, laquelle appartient aux théologiens. Et pourtant, Galilée avec un courage et une obstination étonnants, ne se satisfait pas de cette solution : il faut que la vérité scientifique, la vérité physique, soit la vérité absolue, sur le même plan que la vérité théologique. Mais alors, dans les questions mixtes, où l’Écriture et la science s’entrelacent, c’est au physicien et non au théologien d’avoir le dernier mot. La théologie n’était plus la maîtresse de l’interprétation des Écritures, elle n’était plus la reine des sciences, une discipline intouchable, incontestable.
Donc, pour revenir à votre question, il y a eu un commencement, puis il y a eu un relatif déclin de la théologie au XVIe siècle. Bien sûr, la théologie comme matière d’enseignement n’a pas cessé d’exister, mais elle s’est largement repliée sur la théologie positive, c’est-à-dire sur la recherche de preuves que les interprétations théologiques reposent bien sur la Bible et la tradition. Elle n’avait plus rien à dire au désir de l’homme.
« Toute théologie est donc solidaire d’une métaphorologie », écrivez-vous. Quel sens donnez-vous à la « métaphorologie » et quelle place tient-elle dans l’histoire de la théologie ?
L’expression « métaphorologie » n’est pas de moi. Elle vient de Hans Blumenberg, l’auteur des Paradigmes pour une métaphorologie. Mais curieusement, Blumenberg n’a pas de théorie générale de la métaphorologie : il analyse une série de « métaphores absolues », c’est-à-dire ce qu’on appelle couramment en français des images : la lumière de la vérité, le cœur du problème, etc. Nous savons bien que la vérité n’est pas une lumière sensible, que le problème n’a pas de cœur battant, etc. Mais nous ne pouvons pas remplacer la lumière ou le cœur par un concept adéquat. Ces images nous tiennent lieu de concept.
Au contraire, lorsque je parle de métaphorologie, je parle de la théorie de la métaphore qui se déployait chez les « théologiens » des trois grandes religions révélées : par exemple chez Augustin, Al-Farabi ou Maïmonide. Le problème vient du fait que les Écritures sont des textes bourrés d’images : la main de Dieu, son trône de gloire, sa face et son dos, etc. Que devons-nous en faire ? D’abord, tous les auteurs s’accordent sur un point : il faut dépasser tout anthropomorphisme. À la différence des dieux du polythéisme, le propre du Dieu unique est de ne pas être visible, de n’avoir pas de corps, pas de forme représentable.
Mais ensuite, faut-il dire que ces images métaphoriques n’ont aucun sens et que les Écritures ne servent à rien ? Une lecture purement philosophique peut être tentée de le dire. Mais pour la plupart de nos auteurs, les Écritures servent à quelque chose : elles s’adressent, non pas à une élite de philosophes, mais au peuple qui vit d’images et qui se laisse guider par ses désirs et ses représentations, afin de le guider vers le salut. La Bible et le Coran servent donc à former un peuple de croyants, à l’encadrer politiquement, à le guider moralement et spirituellement. Or donner le sens des métaphores, ou chercher la vérité par-delà les métaphores, c’est interpréter les Écritures. Par conséquent, la théologie est une immense métaphorologie. Si les Écritures sont une forêt de symboles, cela veut dire qu’on n’a jamais fini d’en chercher le sens. Les parcourir, c’est traverser divers niveaux de foi. C’est l’expérience d’Augustin : on commence par tout prendre à la lettre, mais alors, on s’aperçoit des tensions et des contradictions ; le texte semble absurde. On va donc chercher des lectures plus profondes, plus spirituelles, « allégoriques ». Toute exégèse suppose une métaphorologie. Et sans métaphorologie, la théologie ne serait pas possible.
Dans votre ouvrage, vous relevez comment, à différents moments de son histoire, la théologie a vu surgir la menace de la « double vérité » et comment les théologiens de chaque époque ont cherché à éviter ce dédoublement. Quelle menace représente la « double vérité » pour la science théologique et comment y a-t-elle répondu, jusqu’à Galilée ?
En réalité, ce sont les théologiens qui ont inventé cette menace. Et en croyant l’exorciser, ils l’ont fait exister. Au sens strict, l’expression apparaît sous la plume de l’évêque de Paris, en 1277, pour condamner l’erreur des maîtres de la faculté des arts : selon lui, ceux-ci, lorsqu’ils font de la philosophie, enseignent Aristote et affirment des choses contraires à la foi, mais ils proclament en même temps être de bons chrétiens, qui soutiennent les vérités de foi. Dire une chose, et penser le contraire, voilà le fantasme de la « double vérité », ce que l’orthodoxie veut combattre.
Or ce qui m’a intéressé, c’est en effet que l’on voit, dès Augustin, mais évidemment sans l’expression, se construire la même crainte, le même fantasme. Sauf que la solution d’Augustin n’est pas du tout la même : elle consiste à limiter la validité de ce que peut dire le théologien. En matière de sciences, son enseignement n’a aucune pertinence. Il vaut mieux ne pas se prononcer sur les sciences qui nous dépassent, de peur de prêter à rire. Or Thomas d’Aquin évoque plusieurs fois cet argument. Et Galilée en fait sa défense principale.
Au XIIIe siècle, il y avait clairement un problème d’articulation entre la théologie et la philosophie. La condamnation de 1277 n’est que le symptôme d’une difficulté fondamentale. Mais si nous allons au-delà des soupçons de l’évêque, nous voyons que les maîtres ès arts, pour pratiquer la philosophie, ont cherché à défendre l’autonomie de la philosophie. Pour cela, ils admettaient que ce qu’ils enseignaient n’était pas la vérité absolue, soit qu’ils se limitent à citer et commenter les textes d’Aristote sans les tenir pour vrais, soit qu’ils déploient leur discours à partir des données de la science naturelle : par exemple, tout interprète sérieux de la physique aristotélicienne est obligé d’admettre un monde éternel, parce que c’est la pierre angulaire de sa conception du monde ; mais bien sûr, en tant que croyant, le même individu peut admettre que le monde est créé, et c’est pour lui une vérité absolue. Or c’est précisément cette forme d’autonomie, cette manière de faire reposer la philosophie sur des hypothèses, d’y voir des vérités qui ne sont vraies que relativement et non absolument, que l’évêque de Paris, Etienne Tempier, a interprété comme une « double vérité ». — De son côté, il avait une solution simple : on interdit toutes les propositions philosophiques contraires à la foi chrétienne, et pour être sûrs que personne ne les reprenne, on en fait la liste !
Donc, pour répondre à votre question, c’est l’intervention de la théologie qui était une menace pour la philosophie, bien plus que la double vérité n’était une menace pour la théologie. La double vérité ne menaçait personne, puisqu’elle n’existait pas. C’est un fantasme d’inquisiteur : personne ne l’a sérieusement soutenue avant la condamnation de 1277.
La lente édification de la théologie comme science, d’Aristote à saint Thomas d’Aquin, a été rapidement ébranlée dès la fin du XIIIe siècle. Partagez-vous l’idée que, à partir de cette époque, l’histoire de la science théologique se confondrait avec celle du thomisme ? Qui serait, selon vous, le dernier thomiste ?
Je le répète, la « science théologique » remonte à Aristote. Elle ne se confond pas du tout avec le thomisme. Ce qu’on constate, c’est autre chose : le terme de theologia était un terme grec, étranger à la langue latine. Il a pourtant émergé à plusieurs reprises en latin. D’abord chez Augustin, où il désignait la conception stoïcienne des diverses manières de se rapporter aux dieux (par les mythes, les lois de la cité, ou la science de la nature). Mais, probablement parce que le terme était trop profondément lié au polythéisme, Augustin ne reprend pas ce mot pour désigner la discipline que lui-même pratique. Il préfère parler de philosophia christiana (« philosophie chrétienne »), ou de « doctrine chrétienne ». Boèce (Ve siècle), au moins une fois, traduit l’expression d’Aristote, « science théologique », par le mot « theologia ». Enfin, Abélard (XIIe siècle) est le premier à intituler un livre Theologia, sans doute au sens de Boèce. Chez lui, il s’agissait seulement du titre du livre, d’une manière pédante de dire « Traité sur Dieu ». Mais c’est à partir d’Abélard, et semble-t-il dès son enseignement oral, que la théologie désigne une discipline à part.
Au XIIIe siècle, ce qui est nouveau, c’est qu’à la suite de la réception des principaux traités d’Aristote (notamment ceux qui portent sur la science, les Seconds analytiques), on s’interroge sur le statut scientifique de la théologie : au nom de quoi cette discipline peut-elle se dire une science ? Et là, on constate une élaboration progressive, où tous les théologiens importants du XIIIe siècle ont apporté leur pierre à l’édifice : Alexandre de Halès, Bonaventure, Albert le Grand, Thomas d’Aquin. Dans ce mouvement global, la grande force de Thomas, c’est d’avoir osé faire le grand écart : d’être le plus aristotélicien de tous. C’est-à-dire d’avoir eu le courage de travailler, d’assimiler et de critiquer la plus grande philosophie non-chrétienne accessible à l’époque. C’est pourquoi sa solution sur la théologie comme science est à la fois la plus forte et la plus aristotélicienne. Elle est la plus forte parce qu’elle affirme que notre théologie, celle que nous élaborons à partir de la révélation, dépend de la science des bienheureux (celle que Dieu et les anges ont d’eux-mêmes et de la vérité), qu’elle est « comme subordonnée » (quasi subalternata, « quasi-subalternée ») à cette autre science, un peu comme (quasi) l’optique dépend des principes établis par la géométrie. Elle est aussi la plus aristotélicienne, car on peut montrer que cette science supérieure coïncide avec ce qu’Aristote appelait la « science théologique » (qui se ramène à la science que Dieu a de lui-même). C’est donc précisément l’introduction du modèle métaphysique d’Aristote au cœur de la pensée chrétienne.
Quant à l’idée que la science théologique se confond ensuite avec le thomisme, elle est franchement fausse. En réalité, Thomas a immédiatement été attaqué par ses plus grands successeurs, précisément parce qu’on l’a trouvé trop aristotélicien. On l’a critiqué sur presque toutes ses positions, et en particulier sur la théologie comme science. Par exemple, pour son successeur à l’université de Paris, Henri de Gand, la « quasi-subalternation » dont parle Thomas est une supercherie : car ceux qui ont la science de la révélation (les hommes sur terre) ne sont pas les mêmes que ceux qui ont la science divine (les bienheureux). Ensuite sont venus d’autres grands théologiens, tous originaux : Duns Scot, Pierre d’Auriole, Ockham, Grégoire de Rimini, Gabriel Biel, Luther. C’est avant tout l’ordre dominicain, puis l’autorité de la papauté, qui ont permis le maintien d’une école thomiste (avec toutes ses contradictions internes, nous l’avons vu dans le cas de Cajetan).
Si vous établissez la responsabilité de certains thomistes dans le déclin de la théologie, vous insistez aussi sur différentes « affaires » qui ont renversé l’édifice médiéval, en particulier l’« affaire Galilée ». Pourrait-on dire que la scientificité théologique a fait l’objet d’une « déconstruction » au sens moderne du terme ?
Comme je l’ai dit, l’affirmation que le surnaturel est complètement extérieur aux désirs de l’homme, est d’abord une position non-thomiste. Puis cela s’est glissé dans la tradition thomiste, et cela a contaminé une partie de la théologie. Mais pas toute, puisqu’il y avait d’autres traditions, plus fidèles au paradoxe augustinien : l’homme désire atteindre la vérité, mais il n’y parvient pas par lui-même, il a besoin de la grâce. J’ai parlé aussi de l’affaire Galilée et j’ai mentionné le cas du Concile de Latran V. Il y a sûrement d’autres facteurs encore.
Mais alors, peut-on dire qu’il y a une « déconstruction » de la scientificité théologique ? Clairement, oui. Henri de Gand n’est que le premier d’une longue série de critiques. C’est donc une déconstruction qui est survenue dès la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, une ou deux générations après Thomas. On insiste sur l’idée que la théologie chrétienne a un statut spécifique, qu’elle repose uniquement sur la foi, donc qu’elle n’est science qu’en aval de l’acte de foi. Elle devient alors un système hypothético-déductif : la foi fournit des données initiales, les articles de foi, qui fonctionnent comme des axiomes, et la théologie spécule uniquement après-coup, pour en déduire les conséquences.
Par conséquent, la construction de la théologie comme science n’a vraiment tenu solidement qu’un siècle environ, entre les premières grandes Sommes, comme celle d’Alexandre de Halès, et la critique radicale qu’en fait Guillaume d’Ockham. Ensuite, on voit renaître de nouvelles synthèses doctrinales, qui s’appellent encore théologiques, mais qui ont chacune leur propre modèle de scientificité. Elles articulent chacune selon des proportions différentes une part d’exégèse et une part de spéculation rationnelle. À la fin du XIVe siècle, ce sont les papes eux-mêmes qui invitent à un « retour aux sources », c’est-à-dire aux Pères de l’Église contre les subtilités scolastiques. Et Thomas bascule du côté des classiques : on doit lire Thomas parce qu’il est une source plus sûre, parce qu’il soutient une sorte de position commune antérieure au conflit des interprétations au XIVe siècle. On voit aussi naître les « écoles » : les grandes universités de la Renaissance se mettent à avoir des chaires : une chaire de scotisme, une chaire d’albertisme (inspirée par saint Albert le Grand), une chaire de thomisme, etc.
Les critiques de la philosophie moderne à l’égard de la « constitution onto-théologique de la métaphysique », selon la formule de Heidegger, parasitent aussi bien le destin de la théologie que celui de la métaphysique. À quoi attribuez-vous une telle impasse ? L’alternative entre penser l’être sans Dieu et penser Dieu sans l’être a-t-elle un avenir ?
Le problème, lorsque la théologie révélée est comprise comme une science, c’est que, pour être une science, il lui faut se modeler sur la science théologique d’Aristote. À ce moment-là, elle porte sur ses épaules toute l’histoire de la métaphysique. Or Heidegger a décrit la métaphysique comme une onto-théologie. Il faut remarquer d’abord qu’en soi, ce n’est pas une insulte, c’est une description. J’ai critiqué ailleurs (dans le livre Métaphysiques rebelles) cette description, parce que je la trouvais simpliste : il faut démultiplier ce modèle, pour l’adapter à différents cas de figure.
Mais bien sûr, cette caractérisation du Dieu de la métaphysique est aussi destinée, selon Heidegger, à opposer le Dieu de la philosophie et le Dieu de la foi. Et évidemment, si l’on veut penser philosophiquement aujourd’hui le Dieu de la révélation (et non tourner en rond en parlant seulement du Dieu des philosophes), il faut penser le Dieu de la foi, de l’espérance et de la charité. Si l’on veut penser le Dieu vivant, on ne gagne strictement rien à réintroduire ici la question de l’être. Pour penser le Dieu des croyants, et non un concept abstrait, il faut partir de la Révélation, il faut aussi partir de ce que signifie croire, espérer et aimer, mais cela revient au même, puisque c’est à travers la Révélation que l’on peut dire et comprendre ce qu’est croire, espérer et aimer Dieu.
Vous soulignez, à la fin de votre étude, le surgissement d’une « nouvelle forme de philosophia christiana ». Pourquoi avoir eu recours à cette expression ? À quel destin la « philosophie chrétienne » vous semble-t-elle promise ?
Ah, je m’aperçois qu’on peut tout à fait prendre ma phrase à l’envers. C’est donc que je me suis mal exprimé. La « philosophia christiana », ici, ce n’est pas ce que Gilson appelait « philosophie chrétienne ». C’est la doctrine que pratiquaient les Pères de l’Église, avant la construction de la théologie comme science : c’est l’interprétation des Écritures, l’interprétation de l’existence chrétienne à la lumière des Écritures, et l’interprétation des Écritures à la lumière de l’existence chrétienne. Augustin dit aussi « doctrine chrétienne ». Je pense sincèrement que le travail de déchiffrement des Écritures, d’interprétation de leurs images métaphoriques, de dépassement de leurs apparentes contradictions, donc de découverte d’un sens spirituel, est le travail d’une vie, dans tous les sens du terme. La foi chrétienne n’est pas un système, une vision du monde, une idéologie, auxquels on adhère ou pas. C’est quelque chose que l’on découvre, que l’on approfondit, dans lequel on progresse. Lorsqu’on essaie d’en acquérir l’intelligence, cela provoque un cercle vertueux et sans fin : la foi recherche l’intelligence, et l’intelligence recherche la foi. Augustin l’a très bien dit.
C’est en ce sens-là que je parlais de revenir à la philosophia christiana. Cela a peu de choses à voir avec ce que Gilson appelait « philosophie chrétienne ». Disons qu’il y a au moins deux sens de l’expression « philosophie chrétienne » chez Gilson, selon qu’il est historien ou philosophe. En tant qu’historien, son génie a été de dire : même si la raison est une faculté naturelle, et si la philosophie est une discipline autonome, historiquement, on constate que le christianisme n’a pas laissé la philosophie dans l’état où il l’avait trouvé. Le christianisme a donc profondément affecté, stimulé, modifié, enrichi et transformé les concepts fondamentaux de la philosophie. En ce sens, il y a bien eu une histoire de la philosophie chrétienne, c’est-à-dire de la philosophie en régime chrétien. Mais en tant que philosophe, Gilson a de plus en plus durci sa position, en soutenant que le christianisme, en quelque sorte, exigeait un certain nombre de thèses philosophiques, et qu’au fond, la philosophie vraiment chrétienne, c’était celle de saint Thomas d’Aquin. Dans le climat des années 1930 à 1950, on peut comprendre cette théorie. Mais elle n’a plus grand sens aujourd’hui. Aujourd’hui, un chrétien qui philosophe n’a pas à défendre certaines thèses assignées d’avance. Il est simplement quelqu’un qui essaie à la fois de mieux comprendre sa foi, et de penser les questions contemporaines de la meilleure façon possible, la plus rationnelle et la plus scientifique qui soit.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.