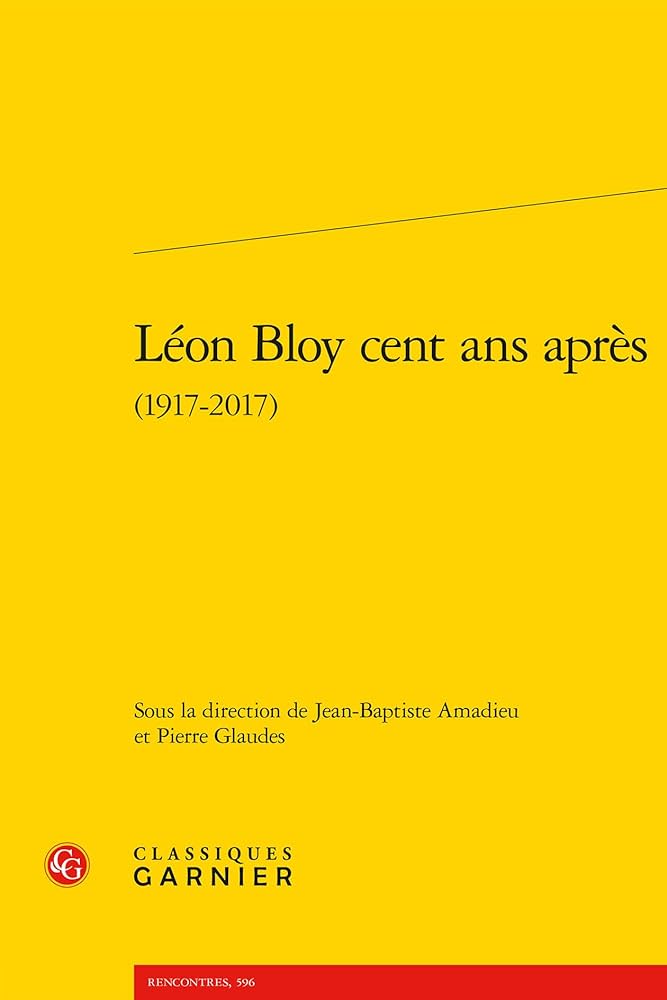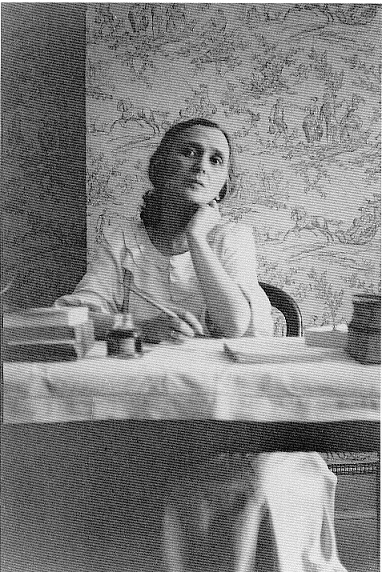Pierre Glaudes est historien de la littérature, professeur à la Sorbonne et l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’œuvre de Léon Bloy, notamment : Léon Bloy, la littérature et la bible (Belles Lettres, 2017). Avec Jean-Baptiste Amadieu, il a dirigé la publication des actes du colloque international consacré à l’auteur du Désespéré pour les cent ans de sa mort en 2017. Intitulé Léon Bloy cent ans après (Classiques Garnier, 2023), l’ouvrage livre une vision complète de l’écriture et de la pensée bloyennes : du mysticisme à l’humour caustique, en passant par sa prose poétique, il donne à voir la contemporanéité de ses textes.
PHILITT : Pourquoi lit-on Bloy aujourd’hui ?
Pierre Glaudes : Je ne suis pas sûr qu’il y ait une réponse simple et univoque à cette question. Le lectorat de Bloy a toujours été extrêmement disparate et paraît souvent inattendu. On lit Bloy par conviction, puisqu’il touche traditionnellement un lectorat chrétien, et qui vit la foi comme un engagement ne tenant pas seulement à des habitudes sociales ou à un legs familial. Des lecteurs de Bloy se retrouvent encore dans sa ferveur religieuse, qui constitue une forme de dissidence dans le monde d’aujourd’hui, mais aussi dans l’intransigeance de sa foi : Bloy est un chrétien qui assume sa foi intégrale dans un siècle en voie de déchristianisation, et qui refuse de consentir à l’effacement de la présence du Dieu auquel il croit. De cette façon, il peut aussi toucher ceux qui regardent l’évolution du monde moderne comme une tragédie, un effondrement nihiliste, une catastrophe dont l’issue devient de plus en plus inquiétante, dans un climat pré-apocalyptique. Mais il y a bien d’autres manières de lire Bloy : certains sont simplement attirés par la violence de son écriture. Il y a quelque chose de jubilatoire, de libérateur dans l’art de ce pamphlétaire qui a poli ses armes au Chat Noir. Ses imprécations, son extraordinaire rosserie, le bonheur de ses formules les plus désobligeantes ont quelque chose de roboratif à l’époque du « politiquement correct », où l’on conteste de plus en plus que le droit d’offenser fasse partie de la liberté d’expression. Bloy plaît également à ceux qui, par un côté ou un autre, se sentent des affinités avec son anticonformisme, ses provocations, son inconvenance assumée. Il faut se garder cependant de réduire Bloy à ses vociférations et à son intempestivité. Il existe toujours des lecteurs curieux qui le lisent pour l’expérience de lecture unique que procure son œuvre par la saveur incomparable de son style fastueux, dont la munificence, les puissants contrastes et les étranges bigarrures sont proprement renversants. Il est curieux qu’un tel écrivain, qui s’enorgueillissait de passer pour « irrécupérable », fasse parfois l’objet de tentatives de récupération et qu’on cherche à le mettre au service d’une idéologie, lui qui disait « se f… de la politique ». Ce qui ne veut pas dire que Bloy, en se livrant sans relâche à une singulière exégèse des événement de son époque, ne nous conduise pas à affronter, en les défamiliarisant, certaines questions dont l’actualité demeure, qu’il s’agisse de la violence terroriste, de l’antisémitisme ou de la guerre de masse.
Est-ce que vous diriez que Léon Bloy apporte une lumière au catholicisme moderne ?
Bloy, comme je le disais, est un écrivain intempestif, urticant et paradoxal à bien des égards. S’il apporte une lumière à ses coreligionnaires, c’est celle de l’éveil. À la fois catholique et anticlérical, il se montre très sévère à l’égard des chrétiens de son temps. Il dénonce la tiédeur de leur foi, il les accuse d’avoir abandonné le Christ, d’avoir accepté de se laisser contaminer par les idées modernes, avec la complicité de leurs pasteurs, du curé de paroisse aux plus hauts dignitaires ecclésiastiques, dont il vitupère la médiocrité spirituelle. Bloy amène ainsi chacun à se demander s’il vit authentiquement sa foi. Son engagement religieux relève d’une mystique qui n’est pas sans affinités avec le cynisme au sens philosophique du terme : une philosophie qui selon Foucault pose le problème du courage de la vérité, en liant étroitement la recherche de cette vérité à un style de vie en adéquation avec elle. Bloy, de plus, ne donne pas de la foi une vision lénifiante : la sienne est impatiente, elle le conduit à réclamer pour l’humanité la fin de son exil et l’accession à la Jérusalem céleste. Bloy se désole que Dieu tarde à tenir sa promesse de rédemption et ne voit d’autre possibilité, si l’on est authentiquement chrétien, que de chérir la souffrance que procure cette attente. Ce Diogène chrétien peut agacer ses frères, les choquer, comme il peut les amener à s’interroger sur leur manière de vivre leur foi ou être pour eux un aiguillon spirituel. Aujourd’hui encore, il les laisse rarement indifférents.
Diriez-vous que l’écriture de Léon Bloy est plutôt archaïque ou moderne ?
Les deux : Bloy, dont le modèle est la Bible, calque son écriture sur celle de la Vulgate et va souvent chercher dans son latin des termes qu’il convertit en français. Il y a là une forme d’archaïsme, un goût du mot ancien, du mot savant, du mot rare, qui n’est pas sans faire penser, en même temps, à l’écriture artiste, qui est moderne et dont il donne en quelque sorte une version christianisée. En un sens, Bloy imite le style de l’Évangile, dont le « réalisme », Erich Auerbach l’a montré, consiste à mêler les registres haut et bas. De même, l’œuvre bloyenne fait coexister l’eschatologie et la scatologie, le grotesque, l’ordurier et le sublime. Or, ce mélange, depuis la révolution romantique, est un des marqueurs de la modernité. Pour Bloy, la Bible est enfin le Livre des livres, qui contient tous les genres. Son œuvre, sur ce modèle, n’hésite pas à abattre les frontières génériques. Mais ce goût de l’hybridation, du métissage des genres, qui le conduit à brouiller la distinction du factuel et du fictionnel, et à faire voler en éclats aussi bien la forme du roman que celle du traité est profondément moderne.
La poésie dans l’œuvre de Léon Bloy joue un rôle prépondérant : il était l’ami de François Coppée, et un fervent admirateur de la poésie baudelairienne. Pensez-vous pour autant qu’il se rangeait plutôt du côté des poètes ou de celui des théologiens ?
C’est chez François Coppée que Bloy a rencontré Johanne Molbech, qui allait devenir son épouse. Mais leur amitié, dont il ne faut pas exagérer la profondeur, n’a guère duré. Bloy ne lui a pas pardonné d’avoir donné de lui à cette jeune Danoise une image peu avenante. Par la suite, vers la fin de l’Affaire Dreyfus, il a tourné en dérision ce « poète gâteux », devenu l’une des « dernières Colonnes de l’Église » et l’un des défenseurs de la patrie française. En matière de poésie, Bloy s’est plu à lui opposer Jehan Rictus. Cependant, ses admirations, dans ce domaine, vont surtout à Hugo (celui de La Légende des siècles), à Baudelaire, à Lautréamont. Cependant, rien n’égale à ses yeux la charge poétique du verset biblique, dont il lui est arrivé de s’inspirer. Mais ces tentatives, dont témoignent par exemple Les Vendanges ! ou encore La Belle Heure des Noces ! (dans La Femme pauvre), sont rares. Bloy, comme le dit Jacques Maritain, n’en est pas moins un poète. Son domaine d’élection est bien la littérature, plus exactement la prose, qui prend chez lui une dimension poétique : il n’a jamais eu la prétention d’être un théologien. En revanche son œuvre entière réécrit avec d’infinies variations une fiction théologique qui vise à approcher par analogies et approximations figurales les mystères théologiques. Si Bloy, qui ne cesse de parler de Dieu, s’aventure sur le terrain de la théologie, il passe toujours par des procédés poétiques, des « correspondances » pourrait-on dire aussi, en déployant ce qu’il appelle son « symbolisme universel ». Tout événement de sa propre vie, comme de l’histoire humaine, devient ainsi l’image per speculum in aenigmate de l’histoire de Dieu avec les hommes.
Malgré son roman intitulé Le Désespéré, il semblerait que Bloy ait longtemps mélangé la douleur, en tant que vertu chrétienne, et le désespoir qu’il considère comme étant le fondement de l’écriture poétique. Sur laquelle de ces notions s’appuyait-il vraiment dans son œuvre ?
La douleur et le désespoir ne sont pas confondus dans l’œuvre de Bloy. La souffrance, je le répète, est ce qui témoigne à ses yeux de la vie de l’homme en Dieu. Celui qui se tient au plus près des exigences de l’imitation de Jésus, souffrira de la vie. Telle est sa conviction. Cette souffrance est vécue dans la pauvreté, l’abandon, l’éloignement de toutes les vanités humaines. Elle est l’envers du désir de réintégration de l’homme dans la plénitude, qui se trouve dans la béatitude. Le désespoir est quant à lui une forme de douleur très particulière, c’est la douleur de l’impatience portée à son extrême limite. Chez Bloy, on en revient toujours à cette impatience, qui est l’expression de l’amour de Dieu et du désir de voir se réaliser ce qui a été promis à l’homme, mais qui est demeuré à l’état de promesse. L’Incarnation a en effet inversé le cours de l’histoire humaine, le Christ a délié l’homme du péché originel, il l’a rédimé de ses fautes, et pourtant, de manière énigmatique, presque scandaleuse, l’accomplissement de cette rédemption est toujours différé. Pire, cette situation s’est aggravée à l’époque moderne, dans la mesure où l’homme s’est éloigné de Dieu : l’attente de la rédemption, loin de finir, semble devoir se prolonger indéfiniment, sans qu’on en voie le terme. L’histoire humaine, de plus en plus illisible pour les chrétiens, est devenue paradoxale, voire incompréhensible. Le désespoir résulte de cette situation inouïe, c’est l’impatience exacerbée au point de conduire l’homme au bord de la révolte, de l’ébranlement de la foi. Pour autant, Bloy se garde bien de confondre ce désespoir, qui est la colère de l’amour, et le nihilisme, qui survient au-delà du désespoir et conduit selon lui à la folie. C’est pour cette raison qu’il tient tant – on le lui a assez reproché – à peindre Lautréamont comme un enragé qui a basculé dans la folie. À ses yeux, Maldoror est en effet le prototype du désespéré qui a franchi le cap de la révolte et qui s’est laissé vaincre par le néant.
On entend d’ailleurs beaucoup de ressemblance entre le Désespéré et les Chants de Maldoror…
Oui, à ceci près que c’est une convergence asymptotique. Si Bloy a trouvé en partie son inspiration dans Lautréamont, il distingue le désespoir chrétien qui est celui de Marchenoir de la rage nihiliste de Maldoror. Il préfère se référer à Carlyle pour qui « le désespoir porté assez loin, complète le cercle et redevient une sorte d’espérance ardente et féconde ». C’est paradoxalement au moment où il est tombé dans le plus extrême dénuement que Marchenoir, alors qu’il va mourir, est le plus proche de Dieu : dans cet état de total abandon, il semble avoir curieusement retrouvé la sérénité et la confiance, et il peut dire : « Je ne suis plus le Désespéré ».
À la fois dans ses romans et ses essais, il n’a de cesse de convoquer la notion de perte de soi. Elle s’applique aussi à une perte de biens matériels. Il convoque cette notion pour décrire l’amour absolu : pourquoi la perte de soi est-elle si importante pour lui ?
Elle l’est parce qu’elle est la condition de l’accueil du Divin. C’est d’ailleurs très intéressant de lire dans quelles conditions Marchenoir disparait, à la onzième heure, presqu’au moment de l’accomplissement final. On voit très bien aussi par la parabole des ouvriers de la onzième heure tout l’arrière-plan scripturaire de cette référence. La onzième heure est au fond l’image de cet homme qui voit son amour anéanti, sa mission littéraire anéantie, qui est seul et meurt loin de tous : c’est l’abandon. Le paradoxe est néanmoins très présent, puisque lui qui a tant attendu et voulu cette proximité bienfaisante avec Dieu, en est sûrement le plus proche à cet instant de dénuement. Là est le moment de conversion du désespoir en son contraire : la confirmation d’espérance. On est ici au cœur d’une mystique du dénuement et de l’abandon. Léon Bloy est un auteur évidemment mystique. Véronique Cheminot est d’ailleurs une figure intéressante, puisque pour les hommes elle est folle, c’est un vase qui s’est brisé, mais elle est aussi au diapason de l’expérience mystique que vit Bloy sur un autre mode, qui n’est pas celui de la folie, mais celui de la fin de sa vie dans une nudité absolue.
Léon Bloy citait de façon récurrente la phrase de Saint Paul « per speculum in aenigmate » : « nous voyons tout en énigme et par le biais d’un miroir ». Quelle importance a le double littéraire dans son œuvre (Marchenoir, Léopold) ?
Le double est évidemment un double possédant une dimension autobiographique, mais qui ne se réduit pas à l’anecdote des incidents d’une vie (réduite à une dimension humaine), mais qui devient une figure. Marchenoir est le moyen par lequel Bloy fait de la matière de sa vie un récit qu’il va réinterpréter et réécrire poétiquement pour l’inscrire dans une méditation théologique qui le rapporte à la grande histoire du Salut. C’est à dire qu’au fond la fiction est toujours variation sur un thème biblique, et Marchenoir est une sorte de figure d’un hypothétique cinquième Évangile moderne, écrite par Bloy à sa manière, qui est à nouveau une façon de raconter symboliquement, et de se configurer sur la parole de Dieu, sur le Verbe.
Pensez-vous que Bloy accordait beaucoup d’importance à la postérité ?
Il se fait une haute idée de la littérature, et aurait aimé se faire reconnaitre de ses contemporains. On pourrait dire qu’il a souffert de ne pas être reconnu, puisqu’il y a chez lui une sorte d’héroïsme de l’écriture, qui est empreint de noblesse. Cette noblesse consiste à laisser parler à travers sa voix une voix qui le dépasse : c’est un mode de projection de la parole Divine.
Il se sentait d’ailleurs missionné…
Oui, comme celui qui devait, en sachant combien le langage humain est piégeux, laisser parler cette voix divine dans ses textes. Mais il y a aussi un fort narcissisme chez Bloy, la création l’est nécessairement ; parler de soi est un peu contrer l’entreprise à laquelle il se voue. C’est justement dans le dépassement de cette dimension narcissique qu’il souhaite se situer pour faire entendre une vérité à laquelle ses contemporains veulent se faire sourds. Il avait le souci de la gloire, puisque la gloire est pour lui le triomphe de Dieu. On peut y voir une forme de démesure et d’orgueil, qu’on lui a longtemps reproché. Donc, il avait pour le temps présent ce souci, mais effectivement ne s’est guère soucié de la postérité. Il avait pour autant le souci d’une postérité à travers la thématique de la conversion. Si postérité il a eu, elle est moins littéraire que spirituelle. Il disait qu’il n’écrivait pas pour la multitude, mais pour un petit nombre d’âmes choisies. De fait, un certain nombre de personnes de qualité : Termier, Pieter Van der Meer de Walcheren, les Maritain, et d’autres.. Il en a converti un certain nombre, et ils étaient sa postérité, qui a essaimé à travers des filiations. Il n’a pas recherché de notoriété académique, puisqu’il savait qu’elle lui serait refusée.
Dans son plaisir aristocratique de déplaire, Léon Bloy empruntait souvent à Barbey d’Aurevilly une plume acérée — et parfois, disons-le, volontairement haineuse. L’homme-Bloy était-il un vitupérateur ou simplement un héritier des pamphlétaires de son époque ?
C’est paradoxal puisque chez Bloy la distinction n’est pas faite entre son métier d’écrivain, qui est une manière d’être plus qu’un métier, et sa vie privée. Il faut se garder de confondre l’homme-Bloy et l’écrivain, les témoins qui parlent de Bloy parlent de lui comme d’un homme d’une grande douceur, plein d’amabilité, un peu craintif, et qui tenait les autres à distance. Il y a chez lui une scénographie auctoriale, qui campe un personnage qui est totalement figuré. De ce point de vue, il se rapproche beaucoup de Barbey d’Aurevilly, qui s’était construit un personnage « le connétable des lettres », « le duc de guise de la littérature »… Bloy s’est construit un personnage un peu différent : celui qui faisait rimer « périgourdin » et « gourdin », qui était vêtu de velours côtelé comme un charpentier (en faisant écho au métier de saint Joseph). Il occupait à la fois ce côté provincial, rugueux, paysan, qui est très différent de la scénographie auctoriale de son mentor Barbey d’Aurevilly, et en même temps ce personnage est toujours une figure qu’on pouvait rapporter à une scénographie biblique : Joseph est celui qui est auprès de Marie, et qui accompagne Jésus dans son enfance jusqu’à sa mission. Tout cela n’est pas fortuit évidemment, tout cela est construit.
Malgré tout, il y avait une grande dimension humoristique dans l’œuvre de Bloy…
Oui, il ne faut jamais oublier chez Bloy les différents niveaux de lecture, et notamment la lecture pataphysique. Bloy a quand même fait partie des Hydropathes. Il conserve des stigmates de sa collaboration au Chat Noir, il était aussi le cousin d’Émile Goudeau… Il y a toujours chez Bloy cette dimension du rire, qui est fondamentale et persiste jusqu’au rire théologique qui est subsannation : le rire de la fin des temps. Il ne faut jamais perdre de vue ce rire, il y a dans le personnage de Bloy quelque chose qui est toujours de l’ordre de la fiction ironique. Il disait d’ailleurs qu’on ne peut pas parler de Dieu dans le monde moderne sans paraître ironique. Il ne faudrait pas simplement dire que Bloy prête à rire en pensant que c’est une forme de discrédit, pour ce qu’il y a de plus sérieux chez lui : le rire est un rire métaphysique dans son œuvre. Il avait signé une célèbre préface en la titrant « pour exaspérer les imbéciles ». On y retrouve l’inspiration baudelairienne du plaisir de déplaire. Il est de ce point de vue assez proche de Lautréamont : il a un rire qui rompt le contrat habituel entre l’auteur et le lecteur. Léon Bloy nous met à l’épreuve, comme dans le début des Chants de Maldoror, où le lecteur est comparé à des grues, et invite ces grues à tourner les talons. Bloy se souvient des Contes cruels de Villiers d’Adam, dont il a aussi été l’ami : il s’adresse à un public bourgeois qu’il veut passer au crible. D’une certaine manière, le rire est un moyen de cribler son public, de le mettre à l’épreuve. Certains lecteurs trouveront ça insensé, et seront révoltés, quand d’autres seront piqués et séduits.
Cent ans après, que reste-t-il de la pensée de Léon Bloy ? Le lit-on encore beaucoup ? Peut-on trouver des traces de Bloy dans la littérature contemporaine ?
Je ne suis pas sûr, Houellebecq se réclame de Huysmans et non de Bloy, pour lequel il a peu d’estime. Léon Bloy reste un auteur qu’une partie des lettrés apprécie. Lorsque je m’étais attelé à écrire un Cahier de l’Herne sur Bloy avec des collègues, Michel Serres, Marc-Édouard Nabe, Jean-Edern Hallier, Philippe Sollers, Philippe Muray, tous l’appréciaient beaucoup. Dans les cercles intellectuels, chez les journalistes aussi, Bloy est admiré et lu. Simplement je ne vois pas de postérité littéraire avérée. Il n’en reste pas moins que sa violence continue à plaire à une partie de la jeunesse. Il y a quelque chose dans l’éructation bloyenne qui fascine les jeunes gens, tous horizons confondus. Idéologiquement, notamment, il ne séduit pas seulement ceux qui ont des idées de droite ou d’extrême droite. Bloy est comme Barbey ou Joseph de Maistre, il n’a pas son pareil pour explorer le négatif de la modernité. Tout ce qui constitue un principe inquiétant, destructeur, menaçant, pour l’homme lui-même, pour l’univers, pour la vie en société, pour la vie spirituelle comme matérielle, les inquiétudes bloyennes, ses persiflages font écho à un certain nombre d’inquiétudes qui sont contemporaines. Il vomit son siècle. Ceux qui, aujourd’hui, vomissent le XXIe siècle, se retrouvent en Bloy, qu’ils soient croyants ou non. De fait, il y a encore une filiation traditionnelle mais aussi une reconnaissance dans la violence, qui pointe une série de dysfonctionnements du monde moderne.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.