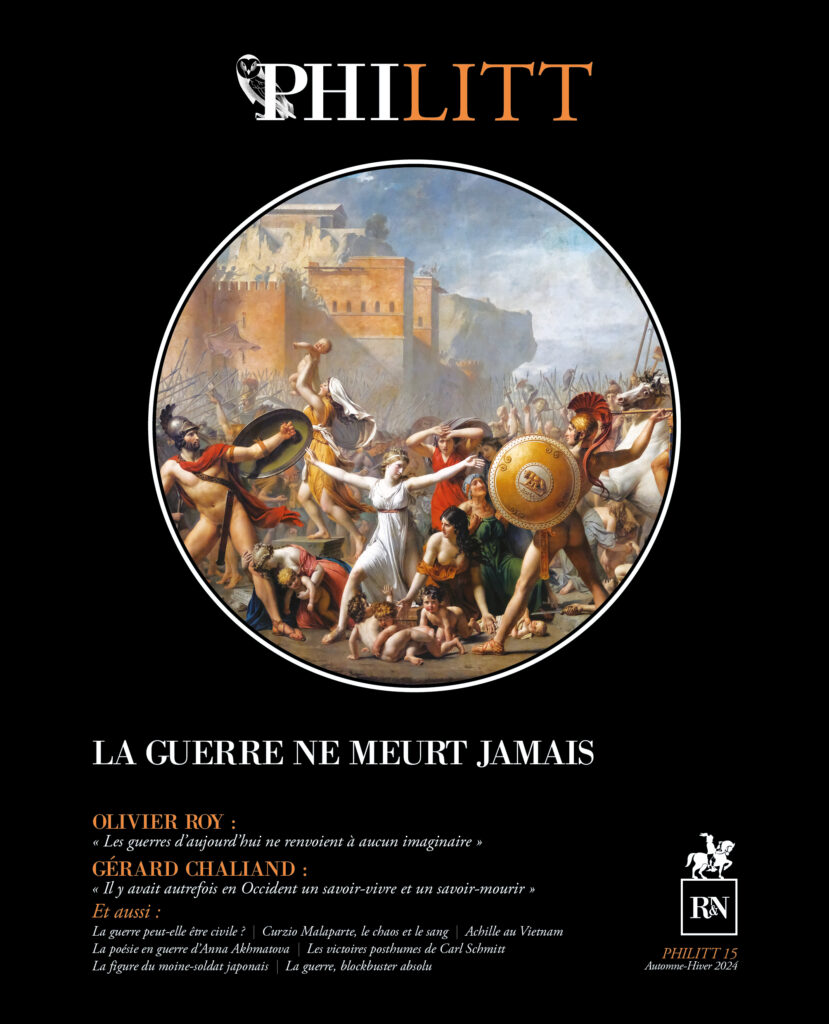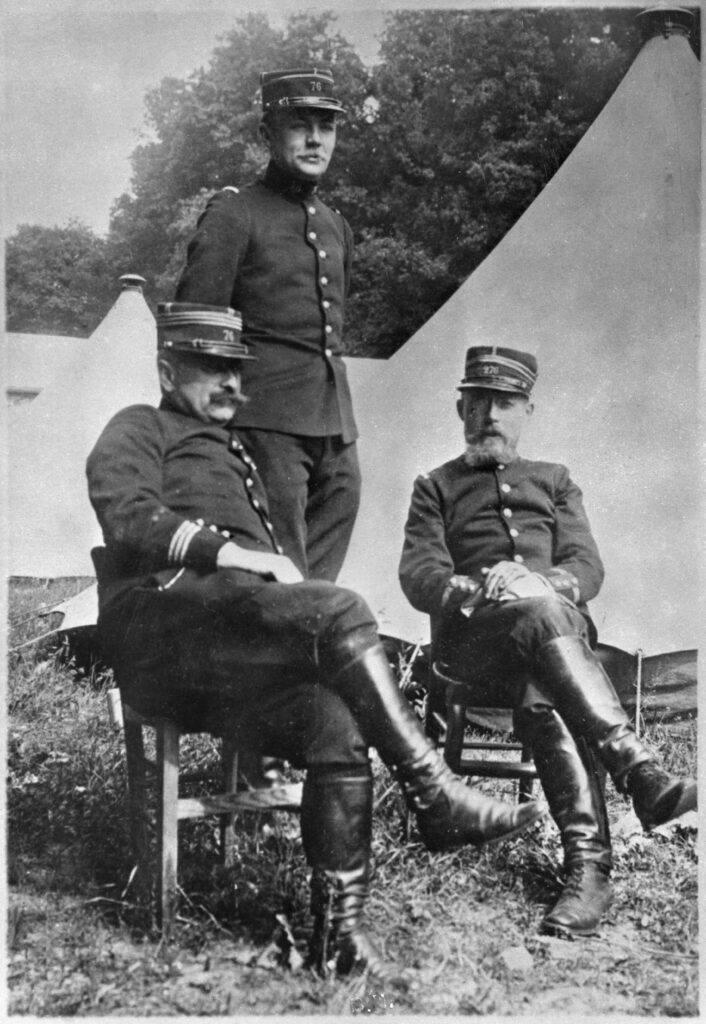[Cet article est paru initialement dans PHILITT #15]
À la fin du dernier millénaire, les Occidentaux ont fait un rêve, un rêve absurde à bien des égards, celui de la « fin de l’histoire », expression rendue célèbre par un article publié en 1989 par Francis Fukuyama. Anticipant la chute de l’Union soviétique, le politologue américain voyait dans l’échec historique du communisme la fin des luttes idéologiques et le triomphe mondial à venir des démocraties libérales. Ce rêve aura peut-être duré une dizaine d’années, jusqu’aux attentats du 11 septembre 2001 qui constituent toujours à ce jour la plus grande attaque sur le sol américain contre des populations civiles. Loin d’être finie, l’histoire a donc repris son cours sous les traits de la « guerre contre le terrorisme », « War on Terror » disaient les néoconservateurs américains, « guerre asymétrique » étant certainement l’expression la plus adaptée. C’est donc comme si l’histoire ne pouvait se déployer que sur fond de guerres et qu’une histoire sans guerres, la « paix perpétuelle » que Kant appelait de ses vœux, n’était pas vraiment l’histoire. Cette conception tragique de l’histoire humaine est-elle la seule qui soit vraie ? Pourquoi une hypothétique « fin de l’histoire » serait-elle conditionnée à l’arrêt généralisé des conflits ? N’y a-t-il donc que le sang versé qui puisse, dans un grand mouvement dialectique, faire progresser les hommes ? La paix ne serait donc qu’une anomalie dénuée de toute positivité, un moment de « non-guerre », comme si l’humanité, sur le modèle du corps biologique, réclamait pour son propre épanouissement une régulière saignée, un coup de fouet nous préservant de la stagnation, de l’enlisement et, paradoxalement, de la mort.
« Fin de l’histoire » ou non, les démocraties libérales n’ont pas triomphé et la multipolarité, de même que la pluralité des régimes politiques, semblent être l’avenir du XXIe siècle. Le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 a réintroduit la guerre conventionnelle au sein même de l’Europe. Nous ne discuterons pas ici des causes profondes qui ont précipité cet événement. Agression impérialiste d’une Russie cherchant à sécuriser des ressources tout en freinant l’occidentalisation de l’Ukraine ? Réaction légitime ou excessive de Vladimir Poutine se sentant menacé par l’otanisation progressive de l’Europe ? Quoi qu’il en soit, cette guerre se déroule sous nos yeux et oblige les gouvernements européens à se positionner. Ainsi resurgit une question centrale, celle de la guerre juste et de la légitimité même de la guerre. Dans cette perspective, on oppose traditionnellement deux points de vue, deux attitudes morales antagonistes vis-à-vis du phénomène martial, à savoir le pacifisme et le bellicisme. Le premier érige le refus de la guerre en absolu. C’est inconditionnellement qu’il faut être contre la guerre : guerre offensive, guerre défensive, guerre civile, guerre asymétrique, guerre conventionnelle… il n’existe pas de guerre qui mérite d’être menée car celle-ci est en soi un mal. Le second érige le devoir de guerroyer en valeur et comme une méthode à privilégier pour résoudre les conflits : faire la guerre pour son peuple et pour son pays est un devoir et un honneur, auxquels seuls les lâches cherchent à se soustraire. Selon les contextes, il est facile de voir les limites de ces deux approches de la guerre. Le pacifisme est-il tenable quand un peuple subit une guerre d’agression ? La moralité d’une telle disposition peut-elle se justifier quand un ennemi extérieur assassine nos enfants ? A contrario, le bellicisme est-il justifiable quand d’autres solutions, au premier chef desquelles la diplomatie, permettent d’éviter le conflit armé ? Au nom d’une certaine conception de l’honneur et de la valorisation de la force et du courage, peut-on légitimer les comportements les plus abjects ? La violence guerrière n’est-elle pas en soi déshonorante quand elle est sans entrave ?
Pour penser la guerre, sa légitimé ou son illégitimité, Charles Péguy apparaît comme un auteur précieux. De manière générale, lorsque l’on se pose une question importante et intemporelle, l’écrivain catholique se présente en guide fiable. « Il répond quand on l’appelle », disait de lui Georges Bernanos. Appelons-le donc. Et surtout, rappelons d’emblée que la guerre, plus précisément la guerre perdue, a structuré dès l’origine son tempérament et sa vision du monde. Enfant de la défaite de 1870 – il est né le 7 janvier 1873 – Péguy a grandi avec cette conscience aiguë de la grandeur déclinante de la France. Dans La Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne (1914), il distingue deux conceptions de la guerre : la française qui est fondée sur l’honneur et l’allemande qui est fondée sur la victoire. Pour le soldat français, l’important est de se battre, de bien se battre, c’est-à-dire selon un code d’honneur déterminé. Cette manière de combattre renvoie bien sûr à la chevalerie. Au contraire, pour le soldat allemand, l’important n’est pas de bien se battre ni de se battre avec honneur, mais de vaincre. Dans ce cadre, on sacrifie à la victoire les moyens de la victoire. Pour Péguy, cette façon de combattre renvoie à l’Empire romain et même, plus en-deçà, au grec Ulysse qui, le premier, remit en question le primat du duel dans la résolution des conflits. En faisant pénétrer un cheval de bois dans la ville de Troie, « l’homme aux mille tours » a remporté une victoire éclatante, peut-être la plus célèbre de l’histoire de l’humanité mais, aux yeux de Péguy, cette victoire triomphale fut sans honneur. Péguy entretient depuis le plus jeune âge une culture de la défaite car, à ses yeux, la victoire a souvent quelque chose d’impur. « Quand j’étais petit garçon, combien de fois n’ai-je pas, depuis, recommencé la guerre, ainsi qu’on la nommait, la seule guerre sans doute pour les gens de mon pays, la guerre de soixante-dix. Combien de fois n’ai-je pas recommencé les défaites. Je n’aimais pas les victoires. J’aimais recommencer les défaites. Combien de fois n’ai-je pas recommencé les défaites avec cette étrange impression qu’à chaque fois que je les recommençais elles n’étaient pas consommées encore, elles n’étaient pas », écrit-il dans un Compte rendu de congrès le 1er octobre 1901.
Vaincre n’est pas dans l’ADN de Péguy, sa matrice est la défaite. Faire la guerre n’a pas pour lui le sens de la domination ou de la conquête. Il laisse cela aux Allemands. Combattre implique pour lui d’autres affects : il s’agit de s’éprouver en tant qu’homme, de savoir de quel bois l’on est fait, d’honorer l’idée même du soldat français qui remonte à Saint Louis, qui culmine en Jeanne d’Arc et dont la manifestation récente la plus exemplaire est sans doute la figure lumineuse du révolutionnaire. « Je suis un vieux républicain. Je suis un vieux révolutionnaire. En temps de paix je suis un bon vivant, comme tout le monde. […] Mais en temps de guerre il faut bien penser que ce sera sérieux. Et nous ne savons pas si nous serons heureux, mais nous savons que nous ne serons pas petits », prévient-il en 1913 dans L’Argent, suite. Il y a donc chez Péguy la volonté d’être à la hauteur de l’événement, d’être à la hauteur de la tâche qui incombe à tout soldat, mais il n’y a pas chez lui d’esthétisation abstraite du phénomène guerrier, une guerre injuste ne peut en aucun cas conduire à un quelconque honneur. À ses yeux, la guerre détachée de l’idée de justice est odieuse et doit être combattue en tant que telle. Les expressions d’un bellicisme conquérant, les conflits engagés pour la pure et simple domination sont iniques et relèvent d’une conception de la guerre que Péguy rejette radicalement. Dans un article intitulé « Service militaire » paru le 1er février 1899 dans La Revue blanche, il écrivait : « Oui, nous attaquons toute armée en tant qu’elle est un instrument de guerre offensive, c’est-à-dire un outil de violence collective injuste ; et nous attaquons particulièrement l’armée française en ce qu’elle est un instrument de guerre offensive en Algérie, en Tunisie, en Tonkin, en Soudan et en Madagascar […] justement parce que, étant internationalistes nous sommes encore français, parce que dans l’Internationale nous sommes vraiment la nation française ; il n’y a même que nous qui soyons bien français : les nationalistes le sont mal. »
La Revue blanche, feuille littéraire de sensibilité anarchiste, avait accueilli le jeune socialiste internationaliste que Péguy était alors pour qu’il puisse s’exprimer librement sur la question coloniale mais aussi sur la mise en accusation de l’institution militaire dans le cadre de l’Affaire Dreyfus. L’argument fort des antidreyfusards formulés à l’encontre des dreyfusards était le suivant : s’en prendre à l’institution militaire, c’est s’en prendre à la France et faire courir le risque de l’anarchie généralisée. Raisonnement classique du parti de l’ordre qui n’est pas sans rappeler la condamnation à mort de Socrate par la république athénienne. C’est au moment de cette polémique que Péguy avait eu cette expression frappante qui intéresse tant notre problématique : « Ce que M. Méline et les réactionnaires ses complices ne se représentent sans doute même pas, c’est qu’on puisse attaquer une institution fermement sans haine ; il faudra cependant qu’il s’y résigne et qu’il se le représente, car ce sera notre nouveauté : nous ferons sans relâche la guerre à la guerre ; mais à la guerre qui est haineuse, nous ne ferons pas une guerre haineuse, car alors nous ne serions pas plus avancés qu’avant. Sans haine, sans rien qui ressemble aux sentiments de M. Méline et de ses réactionnaires, nous attaquons l’institution de toutes les armées, de toute l’armée, en ce qu’elle est, précisément, un instrument de haine internationale, en ce qu’elle devient une école de haine civile. » Si Péguy mentionne explicitement le nom de Jules Méline, ancien président du Conseil et « républicain modéré », c’est parce qu’il s’était opposé à la révision du procès du capitaine Dreyfus et avait déclaré en décembre 1897 : « Il n’y a pas d’affaire Dreyfus. » Une manière de nier l’état de quasi-guerre civile dans lequel était plongée la France et de renouveler un adage bien peu républicain : « Mieux vaut une injustice qu’un désordre. »
La guerre en tant qu’agent du désordre est préférable à l’injustice. Il faut donc « faire la guerre à la guerre ». La formule interroge, mais elle ne doit en aucun cas être réduite à un bon mot, à un artifice rhétorique. Rien d’ailleurs n’est plus éloigné de la manière de faire de Péguy. « Faire la guerre à la guerre », cela veut bien dire qu’il y a un combat à mener contre les dérives de l’institution militaire. Face à des instituions injustes, face à des guerres menées pour des causes injustes, il faut opposer, non pas la passivité accablée, non pas le pacifisme abstrait, mais bien un autre type de guerre, celui qui permet de rétablir les valeurs de la révolution, de la république et donc de réconcilier la France avec sa vocation de justice universelle. « Faire la guerre à la guerre », cela revient à réactiver en permanence la dichotomie entre la conception française de la guerre et la conception allemande. À la guerre pour la domination, à la guerre de conquête, il faut toujours opposer la guerre pour la justice et la guerre pour l’honneur. Si bellicisme il y a donc chez Péguy, c’est un bellicisme chevaleresque. Parfois, la conduite de la guerre est la seule manière de conserver son honneur intact. Parfois, le déshonneur est dans la paix.
Face à la montée des tensions entre la France et l’Allemagne, qui se cristallisèrent lors de la crise de Tanger en 1905, Péguy va se montrer de plus en plus méfiant vis-à-vis du discours pacifiste porté notamment par La Ligue des droits de l’homme et son président Francis de Pressensé : « L’idée de la paix à tout prix et de la politique de M. Pressensé, l’idée centrale du pacifisme, (car je lui donne un centre), c’est que la paix est un absolu, c’est que la paix est même le premier des absolus, c’est que la paix a un prix unique à ce point que mieux vaut une paix dans l’injustice qu’une guerre pour la justice. C’est diamétralement le contraire du système des Droits de l’homme où mieux vaut une guerre pour la justice qu’une paix dans l’injustice. » Pour le gérant des Cahiers de la quinzaine, il ne faut pas idéaliser la paix comme il ne faut pas idéaliser la guerre. Il faut se méfier des deux car l’une comme l’autre peuvent contenir l’injustice. C’est pour cette raison que bellicisme et pacifisme sont des idéologies imparfaites. Faire la guerre à la paix et faire la paix à la guerre sont deux écueils inverses. Pour Péguy, la justice consiste donc à tenir cette ligne de crête : faire la guerre à la guerre.
Et Péguy de condamner également l’hypocrisie pacifiste défendue par la Ligue des droits de l’homme. « Il y a dans la Déclaration des droits de l’homme, si M. de Pressensé savait lire, de quoi faire la guerre à tout le monde pendant la durée de tout le monde », écrit-il, toujours dans L’Argent, suite. Il est étonnant de lire une telle phrase sous sa plume tant elle fait signe à une tradition qui n’est pas la sienne. Elle renvoie en effet à un imaginaire contre-révolutionnaire et en particulier à Joseph de Maistre qui opposait « droits de l’homme » et « droits des gens », « droits civiques » et « droits naturels ». « Il n’y a point d’homme dans le monde. J’ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes ; je sais même, grâce à Montesquieu, qu’on peut être Persan ; mais quant à l’homme je déclare ne l’avoir rencontré de ma vie ; s’il existe c’est bien à mon insu », souligne avec une ironie mordante le penseur réactionnaire dans ses Considérations sur la France (1796). À notre connaissance, Péguy n’a jamais lu Joseph de Maistre. Il comprend néanmoins comme lui le danger que représente pour la stabilité du monde un système de valeurs à vocation universelle. Cela ne relève d’ailleurs pas de l’ordre de l’intuition mais de l’ordre du constat historique : « La preuve c’est qu’elle [la Déclaration des droits de l’homme] n’a pas pu apparaître dans le monde sans y soulever une vague de la plus grande guerre qu’il n’y ait jamais eu dans le monde. Je sais bien que nos historiens à la façon de Barbarie nous ont démontré que les guerres de la Révolution et de l’Empire ne résultaient point, ne procédaient point de l’Empire et ne résultaient point de la Révolution. Il y aussi le Discours de la méthode, qui ne résulte pas de Descartes. » Cela dit, Péguy n’est en aucun cas réactionnaire, il est, de la manière la plus exemplaire qui soit, un républicain et un héritier de la Révolution. Mais la mystique républicaine qu’il porte en lui, son idéal de pureté, l’oblige à la vigilance la plus stricte vis-à-vis des dérives de cette république qui justifie ses guerres de colonisation au nom des valeurs universelles. Ainsi, il faut donc, encore une fois, qu’une certaine conception de la guerre prévale sur l’autre au nom des droits de l’homme. C’est précisément pour défendre l’idée de justice universelle contenue dans les droits de l’homme que le statu quo n’est pas souhaitable, aussi bien en ce qui concerne l’Affaire Dreyfus que les guerres de colonisation. Une paix sans justice mérite-t-elle encore de porter ce nom ?
Le 4 août 1914, Péguy écrivait ces mots à son amie Geneviève Favre : « Je pars soldat de la République, pour le désarmement général et la dernière des guerres. » L’enfant de la défaite aura bien sa revanche. Mais cette revanche sera bien plutôt guidée par la justice (restitution de l’Alsace et de la Moselle) que par le ressentiment. Cette guerre contre les velléités impériales allemandes, il ne veut pas la mener par amour de la guerre comme le belliciste. Il ne veut pas l’éviter non plus par haine de la guerre comme le pacifiste. Péguy souhaite partir au front pour accomplir un miracle, pour accomplir lui aussi un rêve absurde. Faire la guerre à la guerre, soit une manière de tuer la guerre, de faire en sorte que la Première Guerre mondiale soit la dernière des guerres… Péguy en tirera la mort héroïque qu’il a longtemps cherchée, mais malheureusement l’échec d’une telle entreprise – que la Première Guerre mondiale soit la dernière des guerres – réside dans sa formulation même.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.