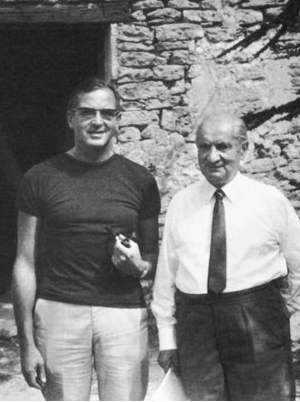Pour Roger Munier (1923-2010) l’être-au-monde est un lieu de passage : traversé, venteux, ouvert. Était-il philosophe, poète, critique, traducteur, moraliste ? Tout à la fois ; mais, encore plus sûrement, rien de tout cela, lui qui récusait ces termes en son travail même. Une question se pose alors : par quelle porte entrer dans son œuvre ? Sans doute par celle qui s’ignore elle-même, énigmatique en ses contours, flottant, ici et là, en retrait de la conscience.
« Ne cherche pas à te connaître. C’est meurtrier. C’est inutile. Car il ne s’agit, pour le
meilleur, jamais de toi ».1
Roger Munier a dix-neuf ans lorsqu’il découvre la philosophie de Heidegger, par la lecture du livre d’Alphonse de Waelhens, La Philosophie de Martin Heidegger, paru en 1942. Six ans plus tard, alors étudiant chez les jésuites, une poignée de questions sous le bras, il frappe à la porte de l’auteur de Sein und Zeit. Le lien opère. Puis se distend. Roger Munier, voulant dépasser l’aporie, conduit par la soif d’inconditionné vers un dépassement du questionnement ontologique, s’éloigne de son maître en proposant de considérer l’existence et la non-existence comme un tout. Le traducteur d’exception du grec (Héraclite), de l’allemand (Silesius, Kleist, Heidegger, Rilke), de l’espagnol (Octavio Paz, Juarroz, Porchia), est le penseur d’un nouveau nihilisme.
Dans un entretien accordé en août 2011 à Francis Pourkat, il déclare : « Il conviendrait, je crois, de repenser le nihilisme, de donner un autre sens au mot. Un autre sens que celui, purement négatif, qu’il a encore. Un sens que la mystique déjà lui reconnaît… 2 » À la fin des années 1960, Roger Munier jettera son dévolu sur deux formes auxquelles il se tiendra le plus souvent : la méditation et le fragment. On y verra éclore sa conception de la langue, de la mort, du néant, de Dieu, de l’existence. La vie est toujours un peu déplacée par rapport à soi. Vivre, c’est faire comme si on était ce qu’on est. C’est jouer au rôle du vivant, quand on ne fait jamais que passer à côté. La présence à soi-même reste à jamais le besoin de la trouver ; exploration tournant sans fin sur elle-même. Pour bien marcher, nous dit Roger Munier, il faut oublier que l’on marche. Ne pas y prêter attention. Comme si l’on était « marché ». On aperçoit ici le reflet d’Arthur Rimbaud et plus particulièrement de cette phrase d’Une saison en enfer : « La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. » La vie empêche jusqu’à la conscience de vivre. Nous sommes davantage vécus que vivants. Une incomplétude permanente est à l’origine de ce que nous sommes. « Nos vies ne sont que les brouillages d’un autre texte qui jamais ne s’écrira. » Roger Munier est un maître de l’écriture du peu, de ce qui affleure sans désigner ; de ce qui mène au bord du vide, là où l’on peut enfin s’abandonner à la puissance d’exister.
L’unification dans le rien
Réclamant l’aube du divin dans le néant, on rencontre dans l’œuvre de Roger Munier des tournures proches de celles employées par Heidegger, « il y a », faisant écho à l’interrogation heideggérienne sur le « es gibt » allemand dans Zeit und Sein ; puis une approche mystique nourrie à l’ambiguïté du langage heideggérien, glissement entre le Nichts de Heidegger et le niht de Maître Eckhart. Montrer l’écart entre une fusion rêvée de la parole et de l’objet, et le maintien de cet objet en son horizon d’existence, ce « rien » qui le fonde. Le rien suspendu, en attente ; le temps originel, qui n’en finit jamais de se lever, abritant le voile d’un mouvement qui se régénère, glissant d’une métamorphose à l’autre, sans jamais aboutir à une forme définitive. Le seul but de ce rien est de manquer son but ; de murmurer son propre mystère au faîte de l’inachevé, lequel finit par devenir son propre achèvement.
Roger Munier nous invite à percevoir le rien dans son absence, son retrait, comme étant ce qui manque au monde. Dans son ouvrage Le su et l’insu, il écrit : « La lumière n’éclaire que ses obstacles, ce sur quoi elle bute. Comme la pensée. » En effet, le mot apparaît quand la chose disparaît. Pour lui, d’ailleurs, les mots essentiels manquent de rigueur : « vie », « mort », « destin », « malheur ». Les mots justes, quant à eux, ne servent qu’à baliser le connu. On songe ici à la phrase de E. – Alexis Preyre, dans Le doute libérateur : « Peut-être oublie-t-on parfois que les mots sont des « signes » ; que seul un rapport de convention relie le mot à ce qu’il signifie. Le mot n’est pas une « expression » de la chose signifiée. Il n’en exprime pas les caractères et n’en délimite pas les contours. Il n’est pas une « photographie » de la chose signifiée. Il ne peut que « l’évoquer » comme une flèche sur le bord d’une route indique une direction. Le langage comme « le dieu dont l’oracle est à Delphes ne révèle pas, ne cache pas, mais il indique » (Héraclite). » Selon l’auteur ayant hérité sa vision de la mystique rhénane, on n’approche les choses que selon un résultat, et comme ce résultat. Le monde est le sanctuaire de l’indéchiffrable. Un retrait dans la présence. Il y a toujours quelque chose qui manque à l’appel, se dérobe, à jamais fidèle à l’ombre qui le protège. L’unification de soi est la chute imperceptible de la perte de soi.
Extase dans l’immobile
L’œuvre de Roger Munier s’inscrit dans la filiation de la théologie négative rhéno-flamande qui reconnaît pour l’homme l’impossibilité de dire Dieu, de la même manière qu’est rejetée l’idée d’un dieu anthropomorphique et interventionniste. Il convient donc de substituer au terme religieux celui de mystique qui, en son sens premier, concerne le mystère. La pensée de Roger Munier, pleine d’audace et de liberté, rappelle celle des grands Spirituels. Il ne se situe pas dans la tradition d’Aristote et de Thomas d’Aquin, mais dans celle de Maître Eckhart, à savoir la voie négative vers Dieu. Ce qui nous permet de percevoir le monde est faussé, d’où la nécessité d’une métamorphose qui n’arrive à son terme que si, comme le dit Maître Eckhart, « l’œil avec lequel je regarde Dieu et l’œil avec lequel Dieu me voit sont
un seul et même œil, une seule et même vision, un seul et même amour ». Nous allons donc au-delà de l’affirmation de Platon selon laquelle « Dieu est la mesure de toutes choses ».
Roger Munier semble tenter de faire se rejoindre les deux pôles des visions d’Eckhart et d’Abélard. Ses livres ont tout des Exercices spirituels, dans la tradition d’Ignace de Loyola ou de Jean de la Croix. À l’instar de ce dernier dans son cachot, ou encore de Joë Bousquet cloué à son lit après avoir été grièvement blessé le 27 mai 1918 à Vailly-sur-Aisne ; Roger Munier, immobilisé par la souffrance imposée par plusieurs opérations, a fait l’expérience intime de ce qu’est l’enfermement du corps et la délivrance de l’âme par la méditation.
Rejoindre l’extase de l’immobile au chevet du non-dit. Celui qui dirigea aux éditions Fayard la collection Documents spirituels où l’on peut lire, entre autres, Cheminements de Jacques Masui, Voix D’Antonio Porchia que Munier a traduit comme il a traduit Poésie verticale de Roberto Juarroz, écrit : « Le centre apaisé où prendrait fin toute opposition, toute lutte, existe, mais nous reste inconnu. Comme sans fin nous précède, dans le temps. Est peut-être le moteur du temps. Peut-être le temps même ».3
Le non-dit ou l’éternel départ
Pour Roger Munier, le texte reste à écrire et serait selon lui tout à la fois « pensée, poésie, présence au monde en son énigme, attente du divin »4. « On use des mots pour atteindre. On atteint en usant les mots. Les user jusqu’au bout (…) jusqu’à ce qu’ils ne signifient plus rien de vif, se défassent, se délitent, comme un sucre dans l’eau. Et boire alors cette eau – qui serait comme la chose sans le nom ».
Roger Munier s’attache à traquer dans le visible une dimension perdue. Son œuvre est une cathédrale à jamais en construction, où des ouvriers, les mots, circulent, bâtissent, défont, aux confins de la brume, dans un ici qui ne peut être qu’un ailleurs ; captifs d’un éternel recommencement. « S’il est un centre, c’est un point aveugle. Tout tourne autour, aussi aveuglément. Parce qu’on tourne aveuglément, on croit qu’il n’y a pas de centre. Mais il y a bien un centre – aveugle. » Quelque chose au fond de soi se dérobe à l’ordre de l’être. Nous sommes un lieu où ce qui se joue échappe continuellement à la pensée. L’essentiel s’accomplit par-delà soi-même, quand ce qui nous pousse a le visage de l’innommable. Par instants, certes, nous sentons comme une main, gardienne de son propre mystère, effleurant notre épaule ; mais, lorsque nous tentons d’en saisir les contours, la voilà qui s’éloigne. Il est déjà trop tard. « Nous ne sommes que paroles, mais nous-mêmes, quelque chose nous tait. » Et c’est pourtant là que tout devient possible.
Roger Munier ne choisit pas, à l’instar du calife dont parle Marc le Bot dans La folie du Calife, le chemin de la violence, en demandant à la danseuse de se dénuder, exigeant ensuite qu’on lui arrache la peau pour tenter de voir ce qui se trouve derrière les choses, au plus intime du visible, au cœur de l’origine perdue, pour combler le vide à l’aide de l’image manquante ou du geste primitif. Pour Roger Munier, « Il n’y a pas à rechercher de sens. Il y a seulement à dire, autant qu’on peut, ce qu’il y a d’invisible dans le visible. » Est-ce alors s’avouer vaincu ? Non, c’est dire que cette impuissance est la puissance même, et que l’être peut s’y rassembler, ouvrir un espace vierge, où le silence se sculpte soi-même à l’abord d’une prière n’osant se reconnaître. « Ce que je vois est à côté de ce que je vois. Ce que j’écris est à côté. Ce que je suis, sans doute à côté aussi. Rien ne coïncide. »
L’homme ne désire en vérité que l’impensable. Peindre ce qui s’échappe – on songe ici à Alberto Giacometti, selon qui le rôle de l’art est de donner une permanence à ce qui fuit – dire l’insaisissable. L’écriture prend alors cette sentence pour la hisser sur les épaules d’un départ à jamais départ. Un départ qui se consume. Et pourtant, là, logé quelque part en son oubli, patiente un miracle sur le point d’advenir, car « il suffit de peu de chose, d’un mot, parfois d’un simple adjectif, pour que s’ouvre, soudain irradié, un nouvel instant du monde. »
- Le su et l’insu, Opus incertum III, éd.Gallimard, 2004. ↩︎
- Jacques Derrida, Sauf le nom, éd. Galilée, 1993. ↩︎
- Opus incertum I, éd. Deyrolle, 1995. ↩︎
- Revue L’Autre n°4, 1992. ↩︎
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.