Rares sont les écrivains qui ont su, comme Céline, « mettre [leur] peau sur la table », c’est-à-dire payer de leur propre personne, se sacrifier secrètement à travers leurs personnages. Houellebecq y est parvenu : sans doute est-ce l’origine des malentendus dont souffre son oeuvre puisque, en fidèle héritier de Huysmans, ses romans oscillent nonchalamment entre l’autobiographie et la fiction. Rendre au romancier ce qui lui appartient : voilà l’ambition d’Agathe Novak-Lechevalier qui, dans un essai intitulé Houellebecq, l’art de la consolation, s’autorise ce que peu de lecteurs osent, à savoir « lire Houellebecq au premier degré ».
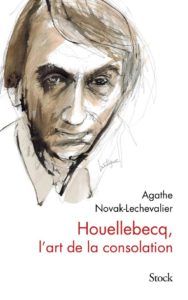
Depuis Extension du domaine de la lutte, son premier roman, Michel Houellebecq a la réputation d’être l’homme malade de la littérature. Adepte de Schopenhauer, il n’a jamais nié le ton pessimiste et cynique de ses romans ; lecteur de Huysmans, il a cependant toujours cherché « la sortie du tunnel » (selon le titre de la thèse de François dans Soumission), afin de quitter la route tracée par « le nihilisme, l’anarchisme et toutes ces saloperies » (Soumission), route où Huysmans avouait déjà se « promen[er] tranquillement, sans désir d’en connaître le bout ». C’est pourquoi le roman houellebecquien est, par essence, ambigu : « roman à thèse sans thèse » – l’expression est de Novak-Lechevalier –, il conjugue la mélancolie du romantisme avec la cruauté du réalisme ; catharsis et rédemption, il prend le pari fou de pousser le lecteur à désespérer de son désespoir. L’entreprise houellebecquienne est donc une entreprise purement littéraire : il s’agit, pour l’écrivain, de fabriquer des personnages à son image et de les jeter dans une réalité romancée afin qu’ils endurent la condition humaine et qu’ils offrent, par le sacrifice de leur existence littéraire, la survie éternelle à l’écrivain – « Un poète mort n’écrit plus. D’où l’importance de rester vivant. » Où finit la consolation et où commence la rédemption ?
Houellebecq n’a d’économiste ou de sociologue que l’apparence : il reste, avant toute chose, un moraliste, c’est-à-dire un humaniste déçu par les hommes. C’est pourquoi, avec le ton sarcastique du moraliste, le narrateur des Particules élémentaires a profondément honte de chacun des personnages. Il les suit pourtant jusqu’au tréfonds de leur médiocrité, lorsque progressivement Bruno et Michel sont privés de leur humanité, le premier sombrant dans la folie, le second dans la solitude. Houellebecq fabrique des personnages volontairement inadaptés à leur milieu et à leur époque. Il met en scène des individus qui, comme lui, résistent à l’aveu facile de ce monde, refusent de se joindre à la « danse existentielle », et dénonce l’invective infernale du hic et nunc comme effort pathétique de la part de ses contemporains pour perdre de vue l’au-delà. Ainsi, lorsque le romancier se scandalise de ce que l’immanent nargue le transcendant et triomphe de lui, il se fait le chantre d’un christianisme sans Christ, le prophète d’une religion d’opposition dont la seule conviction se résume à la phrase du narrateur dans Extension : « C’est toujours mieux d’avoir une théorie, au bout du compte. » Qu’il le veuille ou non, Houellebecq pose la même question que l’« insensé » dans Le Gai savoir : « Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon ? » Comme lui, il se désole d’avoir commis ce geste. « Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c’est nous qui l’avons tué ! Comment nous consolerons-nous, nous, les meurtriers des meurtriers ? » Toute l’œuvre de Houellebecq peut être lue non seulement comme une esthétique de la consolation – c’est la thèse de Novak-Lechevalier –, mais aussi comme la promesse d’une rédemption ; tentative, en l’attente du « deuxième sauveur »[1], de mettre fin par la littérature à la misère de l’homme sans Dieu.
Le syndrome des Esseintes

Du cadre moyen d’Extension du domaine de la lutte, auquel Houellebecq ne prend pas la peine de donner un prénom, au François de Soumission, en passant par le Jed Martin de La carte et le territoire, tous les héros de Houellebecq s’apparentent de près ou de loin à Jean de Floressas des Esseintes, le personnage principal de Huysmans dans À rebours. C’est d’ailleurs toute une génération d’anti-héros qu’a engendrée des Esseintes, puisque le Bardamu de Céline et le Roquentin de Sartre partageaient déjà les angoisses de leur père en désolation. Tandis que Bardamu a essentiellement hérité d’un dégoût maladif à l’égard de « la grande marmelade des hommes dans la ville » (Voyage au bout de la nuit) et que Roquentin a été directement atteint par la nausée de des Esseintes, par sa maladie de l’existence, les héros de Houellebecq, Bruno et Michel dans Les particules élémentaires par exemple, restent marqués par le sentiment d’une décomposition physique et d’un épuisement vital que Huysmans fait aussi subir à son personnage. À rebours n’est d’ailleurs que cela : la douloureuse plainte d’un homme qui sent la vie s’éteindre en lui – « il était un peu las et il étouffait », « [il] fut s’étendre sur un lit » – et qui, à travers le « bruit sourd, persistant, intolérable, des artères qui lui battaient, à coup redoublés, sous la peau du cou », s’écoute mourir, rituel qui fait inévitablement penser au vers de Houellebecq : « Au fond de l’autobus, je sens craquer mes veines. » (« JIM », La poursuite du bonheur, I)
La filiation évidente entre des Esseintes et les héros de Houellebecq est d’autant plus manifeste que l’un et l’autre empruntent à une tierce figure de héros, suprême et divine : la figure christique. Le héros houellebecquien a ceci de particulier que son existence est un long calvaire auquel il met fin lorsqu’il le désire – souvent vers la moitié de sa vie, non pas en se suicidant brutalement mais en oubliant de vivre, en se laissant mourir, comme Michel à la fin de Plateforme, ou en prenant « congé de l’existence sans jamais y avoir adhéré », comme Jed Martin dans La carte et le territoire. De même, alors qu’il n’avait pas encore dépassé le demi-siècle, le des Esseintes de Huysmans « revécut toute son existence » et, sous prétexte de mettre de l’ordre dans sa maison – notamment dans sa bibliothèque –, fait du rangement dans sa vie comme celui qui s’apprête à mourir. Chez un romancier comme chez l’autre, le héros n’est pas du monde : il tombe dans le monde, comme en exil après la chute, afin de soulager l’auteur de « la cruelle et abominable loi de la lutte pour l’existence. » (À rebours)
Cependant, dire que Houellebecq a prolongé la grande famille littéraire du personnage décadent serait insuffisant. Les héros de Houellebecq, à la différence de ceux de Céline et de Sartre, sont les enfants rebelles de des Esseintes, en ce sens qu’ils ont acquis une fonction romanesque à laquelle Huysmans n’avait pas songé. Si consoler, c’est « chercher à réinscrire l’affligé dans une totalité à laquelle celui-ci puisse se référer au-delà et en dépit de son désespoir » – c’est en tous cas la définition qu’en donne Novak-Lechevalier –, alors le salut doit venir du personnage et de lui seul. Le travail du romancier consiste donc à effectuer en permanence un va-et-vient entre le sujet et l’ensemble dans lequel il s’intègre, à semer des généralités à chaque page, art dans lequel Houellebecq excelle. À la différence de Huysmans, Houellebecq n’écrit donc pas pour se garder de « la bouche du pistolet »[2] ou pour s’échapper seul du tunnel. Derrière ses personnages – c’est-à-dire derrière lui -, c’est toute l’humanité qu’il entend sortir du tunnel. À certains égards, le personnage houellebecquien a donc des ambitions messianiques : il joue pour l’homme moderne le rôle que Moïse a joué pour le peuple hébreu, celui d’un prophète qui le délivre et le guide hors des terres stériles de la désolation, vers celles de la consolation.
« Je veux que tout soit consolé ! »

Même si, comme l’affirme Agnès Novak-Lechevalier, « le roman houellebecquien tout entier tend vers la poésie », il serait malhonnête, après avoir fait justice au romancier, de ne pas rendre au poète ce qui lui appartient. En matière de poésie, Houellebecq partage l’angoisse métaphysique qui a animé la courte et douloureuse existence de Jules Laforgue, poète décadent du XIXe siècle, auteur de complaintes d’une infinie mélancolie. Comme Laforgue avant lui, l’auteur de La poursuite du bonheur ou de Renaissance a pour projet poétique de donner voix à la souffrance humaine ; comme lui, il pourrait donc conclure chaque complainte par ce vers tiré des Premiers poèmes : « j’ai fait de vos sanglots un long sanglot suprême ». Il est d’ailleurs significatif que, dans ce même poème intitulé « Désolation », Laforgue s’écrie « je veux que tout soit consolé ! », preuve que la poésie – c’est-à-dire la musique – est la meilleure consolation possible, et que le moyen le plus sûr de « rester vivant », comme le répète Houellebecq dans un recueil éponyme, est de devenir poète.
Pourtant, alors que Laforgue n’a jamais vraiment su à qui destiner son sempiternel lamento – « (…) Tous ces sanglots cherchent le cœur des choses, / Et ne le trouvant pas, hurlent leur désespoir. » -, Houellebecq n’a pas hésité au moment de nommer son mal, fidèle au précepte de Rester vivant selon lequel il faut « frapper là où ça compte ». En effet, chaque poème de Houellebecq pourrait s’intituler « complainte du libéralisme », selon la formule de Bernard Maris, puisque il s’agit à chaque fois d’une lamentation désespérée, d’une accusation désolée et inutile : désolée parce que le libéralisme n’est jamais que l’idiot utile de l’économie, cette pseudo-science, triste et lugubre ; inutile parce qu’il n’est pas possible de sortir du libéralisme, ou du moins parce que les seuls moyens d’en sortir sont justement offerts par le système libéral. Si la poésie constitue le « dernier rempart contre le libéralisme », titre que donne Houellebecq à un poème qui s’apparente à un manifeste anti-libéral, c’est avant tout parce qu’elle protège l’homme de cet attentat à la vie, à la morale et à la liberté auquel conduit l’idéologie libérale : « À qui la faute ? / Si nous ne pouvons radicalement pas nous adapter / À cet univers de transactions généralisées / Que voudraient tant voir adopter / Les psychologues, et tous les autres ? » (« Confrontation », La poursuite du bonheur, III) Assez naturellement, les vers de Houellebecq témoignent d’un « mal du siècle » contemporain, malaise résolument romantique et d’autant plus insupportable que le capitalisme exacerbe les vieux fléaux de la génération romantique, à savoir le rationalisme et le matérialisme.
Honte et rédemption
« Cette haine du siècle » : c’est ainsi que J-K. Huysmans qualifiait son À rebours dans sa dédicace à Léon Bloy. Toute l’oeuvre de Houellebecq, qu’il s’agisse de roman ou de poésie, témoigne davantage d’une honte du siècle, du dégoût marqué de l’écrivain pour ses contemporains, pour l’usage qu’ils font de leur existence et de leur liberté. Exprimer cette honte du siècle, quitte à paraître scandaleux : voilà le pari risqué de l’auteur de Soumission, pari qu’il a remporté avec succès. La grande réussite de Houellebecq, c’est d’avoir donné à sa satire l’apparence d’une simple observation, d’avoir représenté le modèle et la caricature sur le même dessin. En définitive, Houellebecq joue le roman réaliste contre lui-même, puisqu’il cache derrière son désir de « rendre compte du monde », idée qui habite Jed Martin, le projet critique de rendre ce même monde ridicule. Dans un ultime hommage à Huysmans, le roman houellebecquien réserve au réalisme le même sort que À rebours réservait au naturalisme : il le met face à ses contradictions, tourne en dérision son projet en le poussant à son paroxysme et montre dans quel odieux cul-de-sac son obsession de vraisemblance l’oblige à piétiner.
À l’origine de la désolation houellebecquienne il y a un sentiment de honte à l’égard du spectacle du monde, honte qui bientôt se transforme en peine et en pitié. Houellebecq ne serait resté qu’un pâle représentant de Schopenhauer s’il s’était contenté, comme le « médicastre allemand, après vous avoir bien démontré que l’affection dont vous souffrez est incurable », de « vous tourne[r], en ricanant, le dos » (« Préface écrite vingt ans après le roman », À rebours). Malgré son mépris pour l’existence molle et le bonheur facile des hommes, malgré sa tendance à avoir honte de son prochain comme de lui-même, l’écrivain continue de croire qu’il existe une condition humaine plus digne. Dans une idéologie autre que libérale, s’entend. Aussi Houellebecq mène-t-il une lutte permanente contre ce qui provient du monde, qu’il considère comme une diversion, une volonté délibérée de maquiller le malheur de l’homme ; aussi s’efforce-t-il de renier ce monde sous ses aspects les plus flatteurs, idée qu’il résume dans une exhortation toute chrétienne : « Vous ne pouvez aimer la vérité et le monde. » (« Frapper là où ça compte », Rester vivant : méthode) Cette rédemption que Houellebecq souhaite à l’homme a un prix : sa propre existence, qu’il sacrifie à travers ses personnages et qu’il livre dans sa poésie. L’acte de résistance de Houellebecq est d’autant plus noble qu’il est seul à mener un combat dont il se sait déjà perdant : « Je tomberai un jour, et de ma propre main : / Lassitude au combat, diront les médecins. » Alors, après avoir emporté ses personnages et leur souffrance, la mort prendra l’écrivain qui, comme il a rejeté ce monde, le rejettera jusqu’au bout.
[1] « Mais au fond de sa vie sans but / L’homme attend le deuxième sauveur », in « Avec un bruit un peu moqueur », Renaissance, II
[2] Barbey d’Aurevilly écrivit cette phrase célèbre à propos d’À rebours : « Après un tel livre, il ne reste plus à l’auteur qu’à choisir entre le bouche d’un pistolet ou les pieds de la croix. » Réponse de Huysmans vingt ans plus tard, une fois converti : « C’est fait. »
