Søren Kierkegaard, philosophe d’inspiration luthérienne, est une figure de l’existentialisme chrétien. Critique sévère des pasteurs de son milieu, il retourne à la source du luthéranisme avant sa mutation institutionnelle en Église concurrente de l’Église romaine. Kierkegaard se fait penseur radical de l’intériorité informelle de la foi. La « Reprise » (Gentagelsen) est un concept clef de sa philosophie : constitutive du mouvement religieux, elle met en branle la liberté des Anciens comme celle des Modernes afin de la repenser à l’aune de l’Éternité, source de toute liberté et de toute vérité possibles.
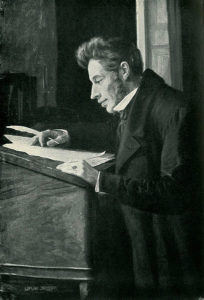
Constantin Constantius, pseudonyme utilisé par Kierkegaard à la rédaction de son essai sur La Reprise, discerne dans la « réminiscence » platonicienne une intuition féconde. La doctrine de la réminiscence, pour le dire en termes modernes, consiste à dire que « tout philosopher est une reconnaissance par soi d’éléments déjà donnés dans la conscience » : elle relève donc, explique Kierkegaard, d’un ressouvenir. Connaître, c’est prendre conscience des idées innées que nous avons déjà dans notre esprit : c’est parce que l’homme n’est pas séparé du monde, mais qu’il est au contraire intimement imprégné de sa réalité, qu’il peut connaître ses êtres et ses lois. Connaître, c’est donc actualiser un déjà-là. Mais cette connaissance est pour Platon un acte nostalgique, ou plutôt, « mélancolique » : c’est un ressouvenir « en arrière », car « ce dont on se souvient, a été ». L’âme, en connaissant, se souvient en effet de son état in divinis, alors qu’elle n’existait pas encore ici-bas, incarnée dans les corps. Pour Kierkegaard, il manquait à cette doctrine, épistémique, un élément qu’allait apporter le christianisme : le courage, véritable pierre d’achoppement d’une doctrine existentielle. « Qui veut seulement espérer est un lâche ; qui veut uniquement s’abandonner au ressouvenir est un voluptueux ; mais celui qui veut la reprise est un homme, et d’autant plus homme qu’il sait plus énergiquement la proposer à ses efforts. »
L’impuissance du conservateur
Tout l’enjeu, pour Kierkegaard, est de concevoir précisément le sens de la « reprise » : « La reprise est la nouvelle catégorie qui doit être découverte. » Est-ce une répétition, comme l’ont envisagé certains traducteurs ? Est-ce le désir de retrouver tel quel quelque chose de passé voire de perdu ? C’est à ce désir du « même dans le même » (Régis Boyer), c’est à cette conception conservatrice du rapport de l’homme au temps, que va se heurter le philosophe danois.
Le conservateur a certes raison de se méfier des trop suspectes exaltations du moment présent : « Un jour tu mourras, profite donc de l’instant présent », disent les hédonistes. Mais en réalité, cette jouissance de l’instant est viciée : elle refuse de voir l’avenir et de l’assumer car il contient en lui la terrible certitude de la mort. C’est précisément parce que l’hédoniste est hanté par l’avenir, promesse de son impossibilité future, qu’il veut user démesurément du moment présent, qu’il n’apprécie donc pas pour ce qu’il est ! Son présent n’est donc qu’un faux : il n’est que l’envers d’une mort certaine qu’il s’agirait d’oublier dans le spectacle des illusions mondaines et éphémères. Contre cette attitude, Kierkegaard oppose la conception vulgaire de l’espérance, envisagée comme l’inquiétude d’une existence vécue par procuration : elle est un « fruit tentateur » qui refuse d’acquiescer à la précarité ou à l’indigence de ce qui est, hic et nunc, pour parier sur des possibles futurs. Cette espérance-là amène l’homme à ne pas savoir apprécier ce qui lui est donné de jouir et de fructifier dans le temps présent. Resterait donc le ressouvenir, qui ressortirait d’une pensée de la conservation : mais ce n’est encore qu’une illusion pour le philosophe danois.
En effet, en quoi réside l’illusion du conservateur ? En ce que, astreint à l’immanence de la temporalité, il ne parvient pas à regarder sa forme, sa promesse, son essence, c’est-à-dire ce qu’il y a en elle de positif, qui ne soit pas l’ombre trompeuse d’une raison supérieure, le négatif d’une image vraie. Kierkegaard nous montre comment il s’est laissé bercer par cette illusion, dans l’un de ses voyages en Allemagne. Pensant pouvoir revivre le « souvenir vivant » du vaudeville de Johann Nestroy, Der Talisman, créé en 1840 et auquel il avait déjà assisté, Kierkegaard fut déçu de voir quel ennui lui produisit ce spectacle lorsqu’il le revit à Berlin au Königstädter Theater. Le plaisir que ce spectacle lui avait inspiré n’était et ne pouvait être autre chose qu’un souvenir. Les sentiments et les expériences vécues nous fuient entre les mains. Peut-être que les choses, stables et dures, sont plus fiables ? C’est ce que Kierkegaard pensait en déambulant entre ses meubles muets et immobiles de son appartement de Berlin. Illusion que son « fidèle domestique » lui fit éclater au visage alors qu’il pensait profiter de l’absence du philosophe pour faire le grand ménage au sein de son appartement. Kierkegaard regagna de façon imprévue son domicile provisoire, quand il vit le spectacle de ses meubles sens dessus dessous. Pétrifié, le Kierkegaard conservateur, qui avait « une grande répugnance pour toutes sortes de bouleversements », se résigna : « La vie est un fleuve. » Point n’est besoin de courir devant le monde pour le mettre en mouvement : « Qu’on reste tranquillement dans sa chambre, puisque tout est vanité et passe, et l’on voyagera encore plus vite qu’en chemin de fer, sans bouger de place. » Tout coule sans fin, toute chose est prise dans le flux de la corruption, du mouvement et du devenir.
La leçon de l’amour

La simple « répétition » est donc une impasse : l’homme entend retrouver le même dans le même, retrouver intacts et inchangés ses souvenirs. Il désire l’immobilité de ce qui, pourtant, se meut et passe, tant les êtres que les choses. Certes, comme l’espérance au sens kierkegaardien, le ressouvenir conçu comme désir de la répétition est un sentiment naturel à l’homme. L’homme qui a aimé et souffert est naturellement appelé à faire l’expérience du conservatisme. Mais pour Kierkegaard, la douleur que ce désir mélancolique de la répétition inspire à l’homme ne devient éducatrice, et n’éprouve ses limites, qu’au contact de la femme trop aimée, occasion d’un éveil. L’amour dont il est question ici est l’amour « au strict point de vue de l’Eros », vicié par la passion : pour « reprendre sa liberté », le « triste chevalier de l’amour » se voit obligé de rompre avec la femme aimée, de la mettre à distance, de la désirer dans la distance. Là où un freudien se fermerait l’expérience sémantique de l’amour chevaleresque et courtois pour y voir l’alibi de l’impuissance sexuelle, Kierkegaard nous invite au contraire à voir dans la prévention des « risques de l’amour heureux » la sauvegarde de la liberté intérieure contre la fétichisation de la femme aimée, dans laquelle la personnalité est menacée d’extinction. En ceci réside le caractère potentiellement salvateur de l’amour malheureux : il rappelle que l’homme est capable de se reprendre, de sauver sa liberté et sa dignité contre un excès de désir concupiscible qui pourrait le porter au naufrage. En portant son désir vers un idéal supérieur, en le sublimant, il se libère de sa part concupiscible qui obérait sa liberté. Par ce que Kierkegaard appelle la « résignation infinie », l’amour ne déchoit pas mais trouve une de ses plus belles expressions : tandis qu’il a échoué dans le partage de deux finitudes, il se meut en communion de deux solitudes. Kierkegaard, qui hérite de l’hétérodoxe puritanisme, nous murmure le sublime et radical secret de la chasteté, incompréhensible pour bien des contemporains.
Entre les lignes, le lecteur avisé sait que Kierkegaard écrit à destination de son ex-fiancée Régine Olsen : tout l’enjeu pour l’auteur est de « regagner ce qu’il aurait perdu », mais sous un mode transfiguré : non en répétant, mais en reprenant. Autrement dit, il s’agit pour le chevalier-philosophe de ne pas s’en tenir au ressouvenir mélancolique de la femme aimée, mais d’oser retrouver le même dans l’autre : au contraire du ressouvenir dont le mouvement va vers l’arrière, « la reprise proprement dite est un ressouvenir en avant ». Faire du résolument neuf avec du vieux. Une seule voie possible pour cela : celle du mouvement religieux de la Reprise, qui est le mode d’action de la foi. Parce que l’histoire d’amour entre Kierkegaard et Régine Olsen est irréalisable in concreto, parce qu’elle a manifesté son impossibilité, il serait vainement épuisant et dangereux d’imaginer la répéter « comme si de rien n’était » : c’est dans un autre lieu et sous un autre mode que la répétition doit être faite, pour devenir Reprise. Il s’agit donc de tenter une nouvelle rencontre, mais hors de la temporalité : grâce à la foi, qui éveille les deux amants à la conscience de l’éternité, les deux amants peuvent s’unir en esprit, comme deux veufs mais dont le sujet de leur amour reste toujours vivant ici-bas. Une réconciliation dans l’Infini, au-delà de la vie, à laquelle Régine Olsen faillit néanmoins au grand dam de Kierkegaard, qui revient sur cet échec dans Crainte et tremblement.
La foi, entre insécurité et réconciliation

Kierkegaard n’est donc pas un conservateur : c’est un reprenant. Pour le philosophe danois, la reprise ainsi conçue accomplit la liberté : elle désigne l’irréductible pouvoir d’affirmation de l’individu dans le monde et dans la vie, par une libre orientation des épreuves et des tentations vers une fin spirituelle supérieure. Sensible au stoïcisme, Kierkegaard considère que cette fin doit être gagnée non dans les choses qui ne sont pas en notre pouvoir, mais en notre état individuel propre sur lequel nous pouvons tout : « La reprise, [ne doit pas] être trouvée en dehors de l’individu, [mais] elle doit l’être en lui. » Ce mouvement d’intériorisation ne relie pas horizontalement entre eux différents états, mais les réunit dans une même tension verticale, celle de leur ouverture inépuisable sur l’Infini qui est Dieu, en Qui ils trouvent leur sens : « L’éternité est la reprise véritable. »
Le mouvement religieux vers l’Eternel, loin d’être une fuite du mouvement, consiste donc en son intériorisation en Dieu, premier moteur, principe de tout mouvement. C’est pourquoi Kierkegaard considère qu’en Job, « l’idée est toujours en mouvement » : ce fidèle de l’Ancien Testament est pour le philosophe le modèle de celui qui re-prend, qui re-lie et qui ré-élit le sens des choses : il ne fuit pas les terribles épreuves qu’il reçoit de Dieu, mais il y acquiesce avec une force toujours renouvelée par la foi. Devant chaque nouvelle épreuve, Job ne recule ni ne fuit, mais avance toujours d’un pas en réaffirmant sa foi en Dieu au sein des vicissitudes temporelles : « l’Éternel a donné, l’Éternel a ôté, que le nom de l’Éternel soit béni ! » (Job I, 21). Les objections de Nietzsche contre un certain christianisme « négateur » sont ainsi déjouées, car anticipées, par Job ainsi que par la philosophie chrétienne de Kierkegaard.
Le Danois nous éveille donc au sens de la re-ligion : comme l’indique son préfixe itératif, la religion est un mouvement de reprise, de re-liaison entre deux opposés par leur intégration dans un principe supérieur et dans une configuration nouvelle. La Reprise, catégorie philosophique et théologique, révèle le sens profond de la religion : opposée à la sclérose de l’habitude et du non-dit, de la fausseté et de l’hypocrisie, elle est un « gage de vie constamment ranimée par renouvellements incessants, car tout amour implique la conscience de l’éternité (“je t’aimerai toujours“) » (Régis Boyer). Au milieu des scandales et des doutes qui frappent la Curie romaine aujourd’hui, la Reprise est la catégorie religieuse apte à rappeler le sens de la foi et à renforcer les exigences de l’Eglise militante en notre temps de décadence cyclique. En effet il ne s’agit pas, pour Kierkegaard, d’évacuer la dogmatique, mais de nous rappeler son sens : comme elle est « le mot d’ordre de toute conception éthique, la reprise est la conditio sine qua non de tout problème dogmatique ». Un siècle après Kierkegaard, c’est le saint Concile Vatican II qui consacra cette intelligence de la religion, en rappelant qu’il n’y a pas de tradition sans réception, pas de transmetteur sans récepteur, à l’écoute des signes des temps. Consacrant le principe de la Reprise, « ce saint Concile du Vatican scrute la sainte tradition et la doctrine de l’Église d’où il tire du neuf en constant accord avec le vieux » (Dignitatis Humanae, n.1).
En ce sens, la « réconciliation » est la « reprise par excellence ». La réconciliation, qui constitue d’ailleurs l’un des sept sacrements de l’Eglise Catholique, est pour Kierkegaard le sacrement de la vie. C’est elle qui, animée d’un mouvement toujours tendu vers la raison supérieure divine, permet à l’homme d’acquiescer aux nécessaires épreuves de l’existence en sauvant toujours intégralement la paix et la liberté. La Reprise s’oppose aussi bien à la liberté d’indifférence qu’à la prison de l’immanence qui est toujours en attente d’une donation de sens et d’être. Elle actualise la grande question que pose Job dans les Saintes Ecritures, et que Kierkegaard nous résume en ces mots : « Quand le monde entier s’écroule sur ta tête et ne laisse autour de toi que des débris, reçois-tu aussitôt le calme surhumain, l’explication de l’amour, le robuste courage de la confiance et de la foi ? »
