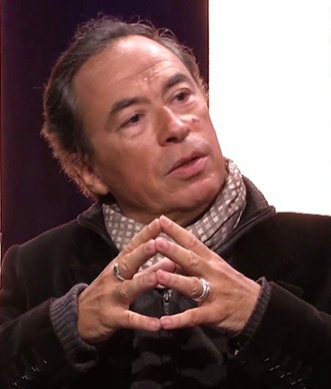L’écrivain, poète et essayiste Luc-Olivier d’Algange observe la modernité comme le théâtre d’une grande contradiction littéraire. D’antiphrases en antiphrases, celles de l’égalité, de l’hédonisme, de l’identité, de l’herméneutique ou de l’universel, chacun de ses grands discours forment tous autant de mensonges qui se laissent finalement résumer à une hérésie anthropologique et spirituelle fondamentale : la confusion de ce qui transcende l’homme par le haut, avec ce qui le dépasse par le bas. Le Ciel des Modernes est l’Enfer des Anciens.
À la magistrale typologie du monde moderne comme « règne de la quantité » que nous devons à René Guénon, les périodes les plus récentes, dont nous eûmes le privilège assez sinistre d’être les contemporains, nous inclinent à ajouter cette caractéristique mineure, mais persistante que, faute de mieux, nous nommerons l’antiphrase. L’antiphrase, dont nous parlons ici, n’est pas l’ironie espiègle de Novalis ou de Schlegel, et pas davantage le sarcasme voltairien, dans la mesure où, gardant par-devers elle sa duplice malignité, elle se donne, et se laisse recevoir, presque sans exceptions, comme une pure vérité.
Que le monde moderne soit de plus en plus antiphrastique après avoir été périphrastique (en faisant, par exemple, insulte suprême, des pauvres, des « économiquement faibles »), que ses discours soient, dans leur immense majorité de l’ordre du Dédire, du renversement ou de la subversion d’une vérité ou d’un principe, il suffit pour s’en convaincre d’observer avec quelle ardeur les apologistes du monde moderne (ces « intellectuels » qui nient l’existence de l’Intellect) s’acharnent à nous vanter les vertus même dont ils nous privent.
Alors que jamais, dans toute l’histoire de l’humanité, les individus ne furent l’objet d’un contrôle aussi rigoureux, que jamais leurs libertés d’être et de penser ne furent soumises à d’aussi tyranniques restrictions, le monde moderne, par la voix de ses publicistes stipendiés, ne cesse de nous chanter les gloires de l’individu et de la liberté. L’égalité qu’il nous vante comme sa conquête est contredite par les plus cruelles iniquités, de même que son prétendu « hédonisme » l’est par la laideur croissante de nos cités, et par la nature, de plus en plus impitoyablement disciplinaire et morose de ses travaux comme de ses distractions.
Ce que le monde moderne prétendit nous offrir en échange de notre renoncement au sacré, nous est ainsi ôté comme par surcroît. Dans cette ironie sinistre, bien rares sont ceux qui reconnaissent la marque de l’Adversaire, de celui qui divise et qui leurre. Goethe dans le premier Faust, nous montre que son personnage est d’abord une dupe. Ce que le Diable offre en échange de l’âme immortelle est une illusion. Ce que le monde moderne prétend offrir à notre impatience, à notre paresse, à notre cupidité et à notre veulerie, en échange de la répudiation de nos vertus chevaleresques et contemplatives, n’existe pas.
La vanité qu’il flatte nous livre aux plus terribles humiliations, les facilités qu’il nous fait miroiter nous exposent aux épreuves, la diversité qu’il nous promet nous ramène à la plus sinistre uniformité. Les sociétés à prétentions individualistes s’avèrent ainsi abominablement massifiées, de même que les sociétés à prétentions collectivistes isolèrent l’individu dans un esseulement dérélictoire, sous la surveillance des autres. Il en va de même de la promesse d’universalité, dont les Modernes dans le sillage de la philosophie « des Lumières », se firent un étendard. Les œuvres de cette universalité moderne, nous la voyons ; ce sont les guerres ethniques, le fanatisme des tribus et des clans, la commercialisation de la mort violente, l’effroi qui agrège l’individu privé de sens, aux premières et plus artificieuse « communautés » qui s’offrent à le protéger, à lui donner l’illusion de la cohésion intérieure qui lui fait défaut.
L’antiphrase moderne s’étend à tous les domaines. Les machines qui devaient accroître notre indépendance nous enchaînent, la fameuse « communication » moderne nous isole derrière nos écrans et ce ne sont plus les hommes qui s’entretiennent entre eux par l’entremise des machines mais les machines qui s’entretiennent entre elles par l’entremise des hommes qui n’ont plus rien à se dire.
Ce village planétaire où les hommes devaient vivre en paix, ressemble de plus en plus à une banlieue planétaire où l’uniformité des mœurs et des styles exacerbe encore les méfiances et les inimitiés. Si l’égalitarisme moderne sut, en effet, faire disparaître toutes les institutions fondées sur l’inégalité protectrice, la générosité du Maître envers le disciple, le sentiment de déférence à l’égard des plus anciens et des plus sages, il donna aussi toute licence au pouvoir, et particulièrement au pouvoir de l’argent, dont aucune autorité ne limite plus, désormais, les abus.
Les Modernes semblent cependant avoir la plus grande peine à s’avouer dupés et persistent, non sans accabler les époques révolues de calamités imaginaires, à trouver, contre toute raison, leur époque préférable à toutes les autres, sans douter parce qu’ils s’y trouvent et que, ne pouvant s’en échapper, ils aiment ainsi à dorer leurs chaînes.
Naguère encore, les hommes vouaient un amour exclusif à leur pays, étendant, comme Maurice Barrès, leur culte du Moi à une sorte de culte du Nous, et de vénération des ancêtres et du terroir. Le culte du Moi du Moderne, tel que nous le voyons aujourd’hui, se réduit à l’identification avec la durée de son corps, avec la fraction du temps où il se trouve. Chauvin de sa temporalité, de son Moi réduit à la durée de son corps, le Moderne semble croire en une universalité purement immanente : notion elle-aussi éminemment antiphrastique car l’Universel, étant, par définition, de l’ordre de la métaphysique, et d’elle seule, il ne saurait être, dans le registre de l’immanence, que l’expression d’une volonté d’uniformisation. Les sciences politiques, dès lors qu’elles méconnaissent la perspective métaphysique, se bornent ainsi à opposer le pareil au même, à nous induire dans l’erreur de leurs fausses alternatives qui opposent les idéologies de la communauté à celles de l’individu, alors qu’il n’est pire collectivisme que l’individualisme de masse, ni de pire solitude que celle de l’homme réduit à une collectivité purement immanente.
Or, l’individu n’est rien, ou presque rien, mais ce « presque rien » se situe à l’intersection d’un au-delà et d’un en-deçà. L’individu n’est presque rien, car le peu qu’il puisse être, il le doit à son héritage, sa lignée, les traditions de son pays, et par dessus tout, à la rivière scintillante de sa langue. Les hommes n’échappent à l’informe, à la confusion, au chaos que par ce qui les distingue les uns des autres, les langues, les religions, les civilisations et les styles. Ces distinctions, quoiqu’à une échelle beaucoup plus grande, sont, comme les individus, la proie du Temps. Elles se situent dans le passage, la transition, la nuance et l’éphémère : elles sont des tracés de lumière qui s’évanouissent entre les apparences.
L’individu n’est rien, et si l’on peut dire qu’il n’est presque rien, ce presque tient tout entier en ce qu’il reçoit et qu’il lui appartient de traduire et de transmettre. De même que le langage ne se situe ni dans la bouche de celui qui parle, ni dans l’oreille de celui l’entend, mais dans un mystérieux entre deux, l’individu se tient à la lisière du moins et du plus, d’un accroissement, d’une glorification, voire d’une déification, ou d’un déclin, d’une déchéance, d’un obscurcissement. Mais tel fut, de tout temps, l’enseignement de la Tradition que pour être plus, il faut consentir à être moins. À l’outrecuidance du Moderne, à son inépuisable vanité, nous devons la destruction et la profanation des savantes humilités qui jadis, permettaient aux hommes, par l’étude patiente, l’ascèse, ou le simple exercice quotidien de la magnanimité, d’échapper à l’infantilisme et à la bestialité qui sont le propre de l’en-deçà de l’individualisme.
Dépourvus de la perspective verticale, métaphysique, hiérarchique, incapables de discerner l’en-deçà de l’au-delà de l’individu, les Modernes ne discernent pas davantage la confusion de la synthèse qu’ils ne distinguent le totalitarisme de la souveraineté. Il est tout aussi impossible de fonder une cité sur l’individu que sur sa négation : nier le « presque rien » ne saurait être une affirmation fondatrice. L’essentiel de la question qui nous intéresse ici semble avoir été posée par Hölderlin : « Le langage le plus dangereux de tous les biens, a été donné à l’homme afin qu’il puisse témoigner avoir hérité ce qu’il est. »
L’au-delà et l’en-deçà de l’individualisme renvoie à l’idée que nous nous faisons de l’au-delà et l’en-deçà du langage. L’en-deçà du langage n’est pas un mystère, ni même une énigme. Il est cet abandon de la forme qui aboutit à la confusion des formes, au conformisme uniformisateur. Celui qui ne sait plus nommer les êtres et les choses, les sentiments, les idées et leurs nuances, s’abstrait du monde et s’incarcère lui-même dans sa propre subjectivité, jusqu’à la démence. Infantile et bestiale la modernité apparaît non seulement, selon le mot de Bernanos, comme « une gigantesque conjuration contre toute forme de vie intérieure », mais aussi comme une conjuration contre le Verbe.
Qu’avons-nous que nous n’ayons point reçu ? Toute la modernité semble arc-boutée contre cette question augustinienne. La grande passion de l’homme moderne est de n’être redevable à rien ni à personne. Après s’être révolté contre tous les signes extérieurs de l’Autorité et de la générosité, il était fatal qu’il en vint à exercer son ressentiment contre le langage lui-même, dont la grammaire et l’étymologie lui rappellent à chaque instant l’origine bafouée, l’ordre du monde et la souveraineté du Verbe et de l’Esprit. Ce langage qui, selon la formule d’Hölderlin, à été « donné à l’homme », les Modernes n’eurent de cesse de l’humilier, de le profaner, de l’enlaidir jusqu’à obscurcir l’entendement humain, l’asservir à la pure fascination des images, à l’immédiateté toute-puissante de ce qui ne peut être interprété.
Alors que l’herméneutique traditionnelle était un exercice de patience et de déférence, une attente contemplative et une prière devant le mystère des signes, l’outrecuidance moderne s’ingénie à la « déconstruction » et à la « démystification » de ce qu’il s’est rendu incapable de comprendre. Des textes, qu’ils soient sacrés ou profanes, le Moderne ne veut entendre ce qu’ils disent, et ses gloses savantes sont toute acharnées à démonter ce qu’il croit être des mécanismes. Ces négateurs de la Vérité ne trouvent pas davantage de vérité dans ces textes qu’ils dissèquent que le déconstructeur d’un clavecin ne trouvera l’essence de la musique dans l’instrument qu’il aura réduit en pièces détachées.
Savante ou vulgaire, la négation du Verbe tient tout entière dans le refus de considérer l’individu ou le langage dans la perspective de leur au-delà. À ces propagateurs du cri, de la vocifération ou de l’hébétude, les Théologiens du Moyen-âge, qu’il importerait de relire avant que leurs œuvres ne fussent définitivement hors d’atteinte, oppose l’idée du monde comme rhétorique ou grammaire de Dieu. Au vacarme silencieux comme la mort de l’en-deçà du langage, la Théologie médiévale oppose le silence lumineux de la vox cordis, de la voix du cœur. La véritable universalité n’est pas dans l’uniformité, dans le syncrétisme des rites et des styles, mais en amont des formes, dans le sceau invisible dont les signes dont nous usons sont les empreintes visibles. Toute grande poésie, toute grande musique, toute métaphysique digne de ce nom porte en elle le mystère de ce lumineux silence antérieur de la vox cordis. Par le désir de son au-delà, l’individu s’approche de ce silence antérieur qui n’est autre que la communion, alors que cédant à son en-deçà, il se livre à la fascination des écorces mortes.
Ce que les Théologiens nomment le libre-arbitre tient en cette alternative de la communion et de la fascination : ce pourquoi notre langage est bien, comme le disait Hölderlin, « le plus dangereux des biens ». Entre la fascination des signes réduits à eux-mêmes, qui divisent et qui accusent sans cesse, dans l’outrecuidance des subjectivités fanatisées et la Mort d’une uniformisation qu’ourdissent les adeptes d’une mondialisation, dérisoirement nommée « village planétaire », qui n’est autre que de la puissance pure livrée à elle-même dans le déni de toute autorité, l’individu paraît voué à la perte, s’il ne consent à répondre à l’appel de la voix du cœur, s’il n’oriente à l’exemple du chevalier de Dürer, sa monture vers la cité céleste, vers le château tournoyant, vers le Graal.
Les philosophes néoplatoniciens, dont les ultimes surgeons fleurirent dans les œuvres des poètes, Shelley et Hugo von Hofmannsthal faisant écho à Plotin et à Proclus, décrivent le cheminement de l’âme, la pérégrination odysséenne, à la fois comme une aventure interprétative, une herméneutique, et comme une procession ascendante vers l’Un.
À la fois spéculative et visionnaire, la philosophie néoplatonicienne, ascétique et lyrique, décrit, mieux que toute autre, ce passage si périlleux de l’en-çà vers l’au-delà. L’extinction du Moi qu’elle pressent est à la fois l’aboutissement et le préalable de la Sagesse. L’Universalité qu’elle présume exige, pour être réalisée, l’exercice de la patience et la fidélité aux formes données. Point de science des états multiples de l’Être sans un art de la gradation. Entre les ténèbres de l’uniformité, et le resplendissement de l’Unificence, entre l’indéfini de la confusion et le « sans-Limite », les philosophies néoplatonicienne décrivent un graduel de l’attestation de l’Unique.
Le Traité de l’Incarnation de la Simorgh, de Sohravardi, distingue ainsi cinq degrés. Le premier degré, correspondant à l’exotérisme dominateur, consistant à dire « Il n’y a de Dieu que ce Dieu ». Le second, correspondant à l’expérience œcuménique, disant « IL n’y a de Lui que Lui ». Le troisième, correspondant à l’expérience mystique, consistant à dire « Il n’y a de Toi que Toi ». Au-delà de ce groupe, écrit Sohravardî, il y en a un quatrième, plus élevé encore, qui dit ceci : « Quiconque s’adresse à quelqu’un d’autre à la seconde personne (en lui disant “tu”) le tient encore séparé de soi et donne ainsi une réalité positive à la dualité. Or, la dualité est loin du monde de l’Unité. Alors ils s’occultent et s’effacent en eux-mêmes dans l’épiphanie divine, et leur attestation de l’Unique consiste à dire “il n’y a de Moi que Moi”. Quant aux plus avancés d’entre eux, en expérience intérieure, ils disent Égoïté, Tuïté, Ipséïté ; tout cela ne sont que des points de vue qui se surajoutent à l’essence éternelle de l’Unique. Les trois mots (lui, toi, je) les submergent dans l’océan de l’effacement. »
Hélas, à cette gradation vers le haut, que propose Sohravardî, qui commence avec Dieu et s’achève sans le Sans-Limite, le monde moderne, propose une gradation vers le bas, ou, plus exactement, selon la formule de Léon Bloy, une ruée vers le bas où le culte de l’indistinction se confond avec cet en-deçà du langage dont le premier signe est l’empire croissant de la laideur, et d’une laideur qui, faute de points de comparaison, n’est plus reconnue comme telle. Un relativisme général s’instaure qui nous invite à quitter nos demeures, à renier nos styles, nos arts, nos formes, nos qualités, à profaner nos lieux saints et nos sites sacrés, à oublier nos prières, à déserter les châteaux de l’âme. L’idéologie du « pareil au même » seconde ce relativisme en nous persuadant de l’inutilité, voire de l’immoralité de tout héritage et de toute fidélité. Si, pour l’homme de cœur, ses semblables ne se réduisent pas à la forme qu’ils servent, à la religion qu’ils honorent, pour l’uniformisateur moderne, en revanche, tous les hommes se réduisent, ou doivent se réduire, à une réalité zoologique, à l’espèce humaine, telle que la définit l’idéologie évolutionniste, la volonté rationnelle hégélienne ou les lois du Marché. Dès lors, les destinées des hommes libres, des fidèles, de ceux que les Modernes nomment, non sans condescendance, les « archaïques », sont pour le moins aléatoires.
Qu’opposer à cet « idéal » Moderne qui veut arracher à tous et à chacun sa part de secret ? Comment garder mémoire des formes anciennes humiliées par l’arrogance progressiste ? Comment ne pas être les otages de ses propres refus ni les esclaves de ses propres consentements ? Quelles sont les conditions nécessaires au dépassement heureux du monde conditionné ? Comment orienter notre volonté sans succomber à la démesure de la volonté ? Comment être soi-même sans n’être que soi-même ? Comment apprendre ce que nous savons déjà ? Comment faire advenir ce qui est de toute éternité ?
La Tradition, à la fois transmission et traduction, témoignant par les Symboles du silence antérieur, de ce cœur de silence que le Verbe accomplit, ne nous offre rien moins que le monde, comme une partition infinie à déchiffrer, à condition de ne pas oublier que nous faisons partie du chiffre, de ne pas être face aux êtres et aux choses, dans l’illusion du Moi comme des expérimentateurs, mais passagers, intercesseurs, dans cette relation sensible et intelligible que l’on nomme la Communion, qui nous délivre de l’espace-temps qui nous emprisonne.
L’au-delà et l’en-deçà de l’individualisme, l’au-delà et l’en-deçà du langage humain, l’au-delà et l’en-deçà de la religion, l’au-delà et l’en-deçà les formes revoient ainsi à un au-delà et à un en-deçà du temps. L’en-deçà du temps est l’idolâtrie du hic et nunc, de « l’ici et maintenant », l’atomisation de la durée dans le monde virtuel, la fascination des images réduites à elles-mêmes. Cet en-deçà est l’oubli de ces fêtes et de ces rites qui ordonnent la temporalité en définissant ses rapports et ses proportions, orientant ses « heures » qui sont, étymologiquement, des prières. Mais au-delà du temps est ce qui qualifie le temps, l’instant éternel, l’omniprésence du Verbe. Qu’en est-il alors de l’homme attentif selon Saint-Augustin : « Ce que mes Écritures disent, je le dis », entend-il Dieu lui révéler. « Mais les Écritures parlent dans le temps, tandis que le temps n’affecte pas mon Verbe, qui est éternel, mon égal dans les siècles des siècles. Les choses que tu vois, grâce à mon esprit, je les vois, de même que je prononce les paroles que tu prononces grâce à mon Esprit. Mais tandis que tu vois toutes ces choses dans le temps, ce n’est pas dans le temps que je les vois. Et tandis que tu prononces ces paroles dans le temps, ce n’est pas dans le temps que je les prononce. »
Luc-Olivier d’Algange
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.