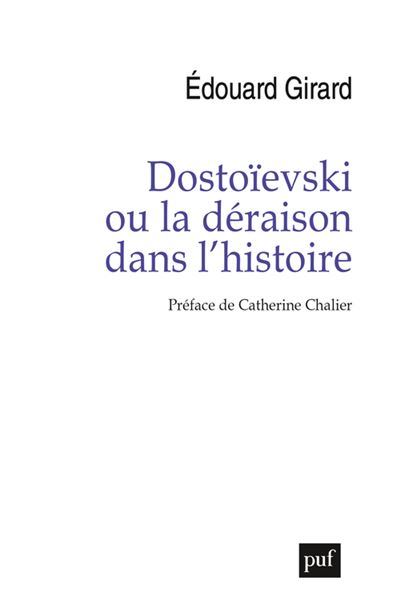Édouard Girard est docteur en philosophie, chercheur associé au centre d’histoire des philosophies modernes de la Sorbonne et enseignant au sein de l’École cathédrale du Collège des Bernardins. Il fait paraître Dostoïevski ou la déraison dans l’histoire (PUF), ouvrage dans lequel il cherche à établir les grandes lignes de la philosophie de l’histoire de l’écrivain russe, notamment en l’opposant à la perspective hégélienne, à la fois rationaliste et finaliste.
PHILITT : Hegel est le grand penseur du triomphe de la raison dans l’histoire. Pouvez-vous revenir sur la thèse de l’identité du réel et du rationnel ?
Édouard Girard : Hegel est un penseur du progrès et du devenir de la raison, c’est-à-dire l’idée selon laquelle la raison est une entité autonome qui se déploie et qui a sa propre vie, sa propre histoire, peu ou prou identifiable au devenir du monde. C’est cela que Hegel nomme l’esprit. « La raison est esprit dès lors que la certitude d’être toute réalité est élevée à la vérité, et qu’elle est consciente d’elle-même comme de son monde et de son mode comme d’elle-même », écrit-il au chapitre VI de La Phénoménologie de l’esprit. C’est le moment où la raison prend conscience qu’elle est l’ensemble de la réalité. L’esprit, c’est le monde tout entier et le monde tout entier est soumis au devenir de la raison. Quels que soient les éléments que vous observez dans la réalité, ceux-ci sont toujours mus d’une manière ou d’une autre par cette raison immanente, totalisante qui devient et progresse pour et par la raison.
Pourquoi l’idée d’un progrès de la raison dans l’histoire pose-t-elle problème à Dostoïevski ?
Ce qui est déterminant pour Dostoïevski, c’est l’expérience vécue du bagne. Il a été condamné à mort, gracié au dernier moment par le tsar Nicolas Ier, parce qu’il appartenait à un groupe d’intellectuels, le cercle Petrachevski, qui lisait Charles Fourrier, George Sand, la philosophie allemande… Ce qui ne plaisait pas du tout au pouvoir en place. Il a donc été envoyé en Sibérie pendant dix ans (quatre ans dans un camp, quatre ans dans un régiment en tant que simple soldat, et deux ans d’assignation à résidence). Cette expérience auprès des bagnards, du peuple russe très simple, l’a amené à penser que les philosophes socialisants du début du XIXe siècle avaient une vision fictive de ce peuple qu’ils entendaient pourtant défendre. Cette littérature et cette philosophie philanthropique estimaient qu’il fallait de toute urgence des progrès sociaux similaires à ceux acquis au moment de la Révolution française, notamment des droits positifs. Ce qui apparaissait irréalisable au sein d’une Russie encore hostile à toute ouverture politique.
Dostoïevski revient du bagne persuadé que ces philosophes occidentalistes n’ont aucune connaissance du peuple russe, de son éthique personnelle, de la fierté et du sens moral qui peut exister chez certains bagnards. Ce sont des personnes humaines, au même titre que ces penseurs de Saint-Pétersbourg. Dostoïevski va donc développer une forme de scepticisme vis-à-vis de ce socialisme de salon. Les années 1840 en Russie étaient marquées par la pensée de système. Schelling, et surtout Hegel, étaient lus avec révérence, pour ne pas dire avec une ferveur quasi-religieuse. Les penseurs occidentalistes en sont venus à voir dans Hegel une sorte de clé mystique qui pourrait permettre de briser les chaînes de la Russie, de briser les chaînes d’un ordre social despotique et de générer quelque chose de complètement nouveau. Pour Dostoïevski, ces penseurs qu’il a bien fréquentés auparavant sont des déracinés ouverts à des systèmes éthérés et déconnectés de la réalité. Pourquoi ? Parce qu’ils ont une conception vaporeuse et fictive de l’homme.
Vous opposez la « conscience spéculative » de Hegel à la « vie effectivement vécue » de Dostoïevski. Cette distinction implique-t-elle deux définitions différentes de l’homme ?
La « conscience spéculative » est une conscience qui parcourt l’histoire du monde en deltaplane, qui lui donne un sens rédigé au futur antérieur dans lequel tout a sa place, tout est dans l’ordre des choses. Dostoïevski reproche à Hegel d’occulter la nature profonde de l’homme. Il voit dans le modèle philosophique hégélien l’expression chimiquement pure d’une pensée fondée sur une anthropologie complètement déficiente, qui ne prend pas en compte le fait que l’homme est mu par des pulsions, par ce qu’on appelle aujourd’hui l’inconscient, par des désirs qui ne sont absolument pas au service de la raison dans l’histoire. Pour Hegel, les passions sont au service du devenir du monde. Pour Dostoïevski, cette thèse est fallacieuse car l’homme est travaillé par des contradictions qui ne sont au service d’aucune plus-value spéculative, qui sont a-téléologiques et qui sont essentiellement de nature pulsionnelle.
Peut-on dire que Dostoïevski développe une anthropologie pessimiste ?
Pas nécessairement. Il déploie une anthropologie qu’il pense plus réaliste que celle de Hegel. Ce dernier serait passé à côté du fait qu’il puisse y avoir des mobiles cachés et contradictoires. Pour Hegel, penseur de la plénitude de la liberté, il est inconcevable de désirer la servitude. L’homme par nature veut être libre car il participe du devenir du monde qui, lui-même, est mu essentiellement par la liberté. Pourtant, dans Les Démons, il y a bien des personnes qui sont mues par un désir de se soumettre à une volonté supérieure qui leur dicte ce qu’ils doivent faire. Cette donnée ne rentre pas du tout dans le système hégélien. Dostoïevski pense qu’il faut considérer l’homme dans toute l’ampleur de ses contradictions, jusqu’aux désirs mortifères comme celui de servitude. Mais il peut aussi y avoir un autre pendant qui est le désir d’élévation, rendu possible par des figures d’autorité. L’anti-modèle de la conscience du sous-sol, c’est la figure d’Aliocha Karamazov, au terme de l’intrigue du roman. Quand celui-ci doit faire face à une situation extrême et injuste, à savoir la disparition soudaine du petit Ilioucha, il ne justifie pas le mal. Il retourne cette négativité en quelque chose de bon et de doux, par l’entretien de souvenirs effectivement vécus. Un tel moment, qui n’est pas spéculatif, peut demeurer un guide pour le reste de sa vie.
Vous citez Pierre Lamblé dans La Métaphysique de l’histoire de Dostoïevski (2001) qui écrit que, pour l’écrivain russe, « les mathématiques ne sont pas ce qui gouverne les hommes » et que « l’âme humaine n’est pas réductible à des formules ». Est-ce le fond du reproche fait à Hegel ?
Dostoïevski ne croit pas aux philosophies de système dont Hegel est l’expression la plus aboutie et la plus complexe. Hegel est à la fois l’acmé de la philosophie et le moment où cette dernière s’effondre sur elle-même. Il est le dernier à avoir tenté de répondre, avec les critères fondamentaux qui sont ceux de la philosophie depuis sa naissance en Grèce, à une interrogation sur la nature de la réalité (la question de l’être) et d’en dégager un principe régulateur du cosmos. Hegel cherche à tenir ensemble tout un tas de connaissances extrêmement hétéroclites : du mouvement des astres, aux civilisations lointaines, en passant par la biologie et les mathématiques. Il y a chez lui une volonté d’exhaustivité scientifique, cosmologique, historique et civilisationnelle extrême. Il a généré un enthousiasme philosophique immense tout en étant le contemporain de bouleversements comme le darwinisme qui va remettre en cause le dogme de la création du monde en six jours ou le fait que le monde a environ 6000 ans. Dostoïevski arrive à ce moment particulier de l’histoire de la pensée et il est l’un des premiers à percevoir avec autant d’acuité que les grands modèles philosophiques sont condamnés, qu’ils ne peuvent plus intégrer toute la science et toute la connaissance dans un seul système, y compris la question métaphysique. Il constate que la promesse de la modernité de faire concorder la raison, la science et l’homme est irrecevable.
Comment Dostoïevski perçoit la modernité et toutes les idéologies qui en émanent (le libéralisme, le socialisme, l’idéalisme…) ?
Pour lui, les idéologies politiques sont travaillées par le même vice que les systèmes philosophiques. Dostoïevski ne peut souscrire à la possibilité d’un ordre social parfait et définitif. Il ne peut penser un ordre social où le mal serait absent. Ceci dit, Dostoïevski est absolument et résolument un moderne. Il n’estime pas que la solution aux problèmes contemporains doive passer par le rétablissement d’une société théocratique. La vraie question pour lui est de savoir dans quelle mesure une vie authentiquement chrétienne est possible.
Vous faites l’hypothèse que, selon Dostoïevski, l’histoire suivrait deux trajectoires distinctes, l’une liée au catholicisme et l’autre au protestantisme. Qu’est-ce qui les caractérise ?
Dans la représentation que se fait Dostoïevski de l’histoire de l’Europe, il y a deux grandes voies qui ont été ouvertes au sein de la chrétienté : la voie romaine et la voie protestante. Mais Dostoïevski est convaincu que la France et l’Allemagne, incarnations de ces deux voies, vont dans le mur. Pour lui, la Révolution de 1789 n’est que le prolongement du catholicisme à la française, une expression théorique sur l’humanité et l’organisation sociale perçues comme des principes régulateurs pour l’avenir du pays. Et ce modèle doctrinal va venir à bout des tous les dogmes révélés du christianisme. De l’autre côté, le protestantisme, ayant fait uniquement la part belle à la liberté de conscience, en viendra lui aussi à éroder tous les dogmes mais par le biais personnaliste. Il écrit dans Le Journal d’un écrivain : « Le protestantisme marche à pas de géant vers l’athéisme. » Dostoïevski perçoit une lutte à mort, mue par les nationalismes de l’époque, entre la France et l’Allemagne qui n’auront, d’après lui, bientôt plus rien de chrétien. Dostoïevski ne fait pas pour autant l’apologie de l’orthodoxie, mais il reste persuadé que la Russie est à part, que son destin historique est différent de celui de l’Occident latin ou germanique. Elle doit donc se préserver des influences étrangères et en particulier des pensées de système.
Dostoïevski semble voir dans la philosophie de l’histoire de Hegel la source de l’orgueil et du désir de domination allemands. Pour quelles raisons ?
Il y a une réflexion sur la place de l’Allemagne qui couronne en quelque sorte la philosophie de Hegel. C’est le règne germanique qui achève sa pensée politique : l’État rationnel et la monarchie prussienne sont perçus comme les meilleurs régimes possibles. La philosophie hégélienne est concordante avec l’esprit allemand. S’il y a bien quelque chose auquel Dostoïevski s’oppose, c’est à l’idée de la plénitude du bien, selon laquelle le bien serait une catégorie ontologique qu’il faudrait réaliser et qu’il serait débiteur de la volonté politique. C’est ce que je désigne dans le livre par la notion d’ « ultramoralisme ».
« À l’histoire comme universel de Hegel, Dostoïevski a opposé l’universel comme humanité », écrivez-vous. Quel est le sens d’une telle distinction ?
Pour Dostoïevski, la philosophie n’est pas mue par un devenir. Il est donc vain d’en chercher la finalité. Ce n’est pas la raison, ce n’est pas l’État prussien, ce n’est pas la recherche d’un régime socialiste qui résoudra tous les problèmes du monde. On a d’ailleurs souvent souligné que Dostoïevski avait pressenti l’avènement des totalitarismes et du système répressif soviétique. Aux yeux de Dostoïevski, c’est en l’homme que l’on doit trouver les critères d’évaluation du bien et du mal dans l’histoire. Si l’histoire n’a pas de but, doit-on en conclure qu’il ne faut croire en aucun principe ? L’histoire est le lieu possible de la réalisation de la catastrophe et du malheur. Et c’est grâce à des hommes bons et charismatiques qu’ils pourront être évités. Seuls les hommes bons rendent la rédemption possible. Il y a chez Dostoïevski une profonde réflexion sur la bonté incarnée en opposition au bien ontologique défendu par des personnages ultramoraux comme Raskolnikov.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.