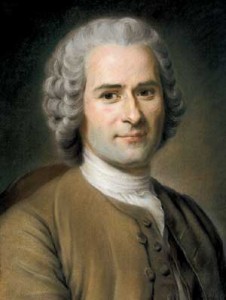
Jean-Jacques Rousseau occupe sans conteste une place à part dans l’histoire de la modernité. Figure définitivement ambivalente, il fut, à la fois, en réaction contre la vulgarisation des sciences et la profusion des arts ; chantre d’une vertu civique résolument conservatrice – « les anciens politiques parloient sans cesse de mœurs et de vertus ; les nôtres ne parlent que de commerce et d’argent » – ; promoteur d’une bonté naturelle antérieure à la raison nichée dans le sentiment ou l’instinct. Et pourtant, «(…) à côté de ses idées protoromantiques – prédominance du sentiment sur l’intellect, la civilisation comme corruptrice et prêche du retour à la nature – perdurent en lui des aspects des Lumières, le républicanisme et la théorie du contrat social ». Nul hasard donc si Leo Strauss, dans son fameux Droit Naturel et Histoire, commente assez longuement Rousseau et, surtout, le situe au début d’un chapitre cinquième intitulé « la crise du droit naturel moderne ». Avant de poursuivre, entendons-nous sur le sens de cette crise.
La pensée straussienne se veut fermement antimoderne et son offensive dirigée principalement contre les théoriciens du contrat social (mais aussi, et peut-être plus décisivement encore, contre Machiavel). Le droit naturel moderne aurait perdu de vue la véritable fin du politique et de la justice en déconnectant l’homme de sa fin naturelle ; de sa nature téléologique : Chez Locke et Hobbes il existe toujours un devoir-être (une loi naturelle) mais son mètre-étalon se réduit à l’utilité (la sécurité, la paix) dans la perspective où l’état de nature remplace – du moins renouvelle sensiblement – le concept classique de nature humaine ; où les causes mécaniques ont chassé les causes finales. Le droit naturel moderne ne tend plus vers l’excellence d’une nature humaine transcendante (qui se voulait d’ores et déjà politique) mais, bien d’avantage, exhume les lois établissant le passage d’un état pré-politique à un état politique.
La crise de la modernité constitue une étape intermédiaire entre un droit naturel classique dévoyé par le droit naturel moderne et une déliquescence totale de de la pensée politique (donc du droit naturel quel que soit son acception) ; déliquescence ou fin pure et simple de la pensée politique marquée par l’avènement pernicieux de théories nouvelles dont l’agent détersif repose sur le refus radical d’une dichotomie normative entre réel et idéal, entre ce qui est et ce qui doit être. Les deux mamelles de cet état scientifique « post-politique » sont l‘historicisme et le positivisme. L’historicisme fait de l’histoire – du processus historique en tant que tel – la raison suffisante de l’ensemble des théories politiques : l’histoire à sa propre fin et l’homme est condamné à ne jamais dépasser l’actualité du pur présent ; « toute compréhension, toute connaissance (…) suppose un cadre de référence, un horizon, une vision d’ensemble dans laquelle elle se situe et en dehors de laquelle tout examen, tout observation, tout repère est impossible ; la vision de la totalité ne peut être soutenue par le raisonnement puisqu’elle est la base de tout raisonnement ». Le positivisme, quant à lui, roule sur la différence entre fait et valeur (Strauss vise ici particulièrement Weber) : les valeurs ne relèvent pas du fait scientifique mais d’un simple choix ; il peut bien exister un système de valeurs trans-historique mais il échappe à la connaissance rationnelle.
Rousseau, comme Burke, incarne cette étape intermédiaire de la modernité en crise. Si il est facile de voir dans le traditionalisme burkéen les prémisses d’un historicisme rampant, il est en revanche beaucoup plus délicat d’offrir une lecture analogue de l’œuvre Rousseauiste. L’opération s’avère périlleuse tant la difficulté s’accroît lorsqu’il s’agit de montrer en quoi l’auteur des Rêveries du promeneur solitaire, par sa conception singulière de l’état de nature et du contrat social, entend, en réalité, dynamiter encore d’avantage que ses prédécesseurs (Hobbes et Locke) le couple être/devoir-être, en réduisant, d’une part, la loi naturelle à la liberté et en faisant, d’autre part, de l’état de nature un état pré-humain et non pas simplement pré-social (Hobbes) ou pré-politique (Locke). Rousseau aurait amorcé de très loin, en préparant le terrain, le relativisme historiciste et positiviste.
Rousseau enracine, à l’instar de Hobbes, la loi naturelle dans des principes antérieurs à la raison, « autrement dit, dans des passions qui n’ont pas besoin d’être spécifiquement humaines ». Le fondement de la justice découle de l’être dans ce qu’il a de plus primitif : le devoir-être se greffe sur une base instinctive et une liberté radicale (que Strauss qualifie de licence : « la licence consiste à faire ce vers quoi l’on incline ; la liberté consiste à faire d’une façon juste seulement ce qui est bon ; et notre connaissance du bien doit provenir d’un principe supérieur, elle doit venir d’en haut »). Ainsi, selon Luc Ferry, « ce que L. Strauss dénonce comme foncièrement dangereux dans la pensée rousseauiste, c’est l’idée moderne de liberté entendue comme le fait de ne pas avoir de « nature humaine » ou, pour reprendre une formule de Fichte, de n’être « initialement rien » ». Cette critique vaut aussi pour Hobbes mais dans une proportion moindre. En effet, Hobbes renverse la licence hostile de l’état de nature en identifiant le contrat social à un transfère de puissance et en conférant ainsi au Léviathan toute l’étendue des puissances atomisées. L’état de nature hobbesien commande, pour remédier à son caractère foncièrement belliqueux, que les individus se délestent de leur droit naturel (au sens de liberté naturelle ou de puissance d’agir pour se conserver ; donc de licence). Le Léviathan symbolise, d’une certaine façon, une rupture avec l’état de nature antérieur.
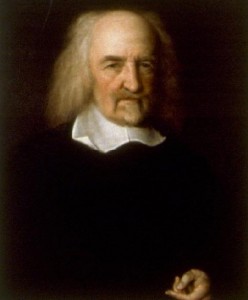
Chez Rousseau la situation change. L’homme n’est plus mauvais par nature sans pour autant devenir originellement bon, et cela pour une raison simple : Rousseau ne décrit plus l’homme à proprement parler mais le sauvage – le « sous-humain » – dépourvu de tout logos : « l’homme est bon par nature parce qu’il est par nature cet être sous-humain capable de devenir bon ou mauvais ». Pour Hobbes, l’homme pré-social est déjà un être doué de raison et le contrat social dérive d’un abandon raisonnable de sa liberté (le meilleur usage que l’homme hobbesien puisse faire de sa liberté) lié à une nécessité essentielle (l’état de nature pousse nécessairement les hommes à en sortir). Leo Strauss reproche ainsi à Rousseau d’avoir accentué encore d’avantage les traits d’une causalité mécanique en réduisant le passage de l’état de nature à l’état politique à une «(…) série d’accidents naturels » : l’état civilisé serait donc un simple événement fortuit. Rousseau, en suggérant que les origines de l’homme n’ont aucun trait humain, semble reconnaître « (…) que ce qui caractérise l’humain, ce n’est pas le don de la nature mais le résultat de ce qu’a fait ou a été forcé de faire l’homme pour vaincre ou changer la nature : l’humanité de l’homme est le fruit de l’évolution historique ». Il faut cependant éluder cette thèse puisque le philosophe Du contrat social voyait bien qu’une évolution historique, par essence accidentelle, « (…) ne peut fournir à l’homme d’étalon et que, si elle à une fin cachée, sa finalité ne peut être reconnue s’il n’y a pas d’étalon qui transcende l’histoire » ; autrement dit, « ce n’est donc pas la connaissance de cette évolution historique mais celle du vrai droit public qui fournit à l’homme le vrai étalon ». A partir du moment où Leo Strauss admet que l’état de nature rousseauiste revêt un double sens – c’est-à-dire « (…) qu’il décrit non seulement la condition originelle de l’homme, mais encore un étalon positif, et qu’à ce titre Rousseau maintient encore l’idée de devoir-être (…) » – sa critique ne peut dès lors que porter sur la qualité de ce devoir-être ou étalon « (…) ou, plus exactement, sur le fait qu’il soit purement « formel», purement humain et nullement substantiel ou « objectif » ».
C’est donc bien à ce problème de liberté (différent de licence) qu’il faut revenir. Etant donné que « (…) le droit naturel s’adresse à l’homme tel qu’il est présentement et non pas à l’animal stupide qui vivait dans l’état de nature (…) », Strauss se demande « (…) comment Rousseau a pu fonder sa doctrine du droit naturel sur ce qu’il croyait savoir de l’homme naturel ou de l’homme dans l’état de nature ». Si chez Hobbes la liberté est motivée par un souci de conservation, Rousseau tend à faire de la loi que l’on s’est donné à soi-même le sens de cette liberté : « cela signifie tout d’abord, nous dit Leo Strauss, que ce n’est pas simplement l’obéissance à la loi, mais la législation elle-même qui doit avoir son origine dans l’individu » ; « cela signifie ensuite que la liberté n’est pas tant la condition ou la conséquence de la vertu que la vertu elle-même ». Et « ce qui est vrai de la vertu l’est aussi de la bonté, que Rousseau distinguait de la vertu : la liberté est identique à la bonté ; être libre ou être soi-même, c’est être bon (…) ». La liberté naturelle constitue ainsi le modèle de la liberté civile et prend la forme d’une « auto-législation ».
Un tel devoir-être fondé sur la liberté est parfaitement inconcevable pour des vues antimodernes. L’attaque décisive, déjà évoquée, se ramasse ainsi : Rousseau abandonne « (…) toute référence à un devoir-être objectif et substantiel au profit d’un devoir-être fondé dans et par la liberté humaine » (bien que l’affaire se révèle un peu plus complexe : « (…) on hésite finalement à savoir si le reproche essentiel adressé à Rousseau vise le fait qu’il accélérerait le mouvement « réaliste » qui conduit à l’historicisme, ou plutôt son abandon de toute référence à un devoir-être objectif et substantiel au profit d’un devoir-être fondé dans et par la liberté humaine » ; Strauss reprendra en effet ce premier grief – rousseau annonciateur de l’historicisme – dans des publications ultérieures à Droit Naturel et Histoire. La différence est subtile mais, au fond, les deux accusations se confondent quant à leurs effets). Il est par ailleurs tout à fait aisé de réfuter Leo Strauss lorsqu’il écrit, inspiré par la sophistique, que « si le critère ultime de la justice devient la volonté générale (…) le cannibalisme est alors aussi juste que son opposé » : la confusion (volontaire sans doute) entre volonté générale et majorité est ici déconcertante.

Sur le fond, la réponse proposée par Luc Ferry se décompose en deux temps mais s’inscrit dans un mouvement unique : montrer en quoi la lecture straussienne ne permet pas de comprendre pourquoi la philosophie rousseauiste ne possède plus les « (…) qualités requises pour fonder une pensée politique à la fois non historique et non positive » (ce qui veut dire que la critique de Ferry ne vise pas du tout à neutraliser les reproches formulés par l’auteur de façon absolue : le propos de Strauss aurait très bien pu être pertinent si il ne s’évertuait pas à en tirer une conclusion trop radicale : les prémisses d’une mort pure et simple de la pensée politique). Luc Ferry lui reproche tout d’abord de ne pas prendre assez au sérieux la qualité de devoir-être qu’ouvre l’idéal de liberté (cet idéal est peut-être moins conséquent que celui propre à l’âge classique mais il n’invalide nullement la possibilité d’une pensée politique). Le deuxième argument tend à suggérer que la philosophie classique – telle que Strauss la présente – n’est pas d’avantage capable de sublimer le devoir-être que sa sœur moderne : comment ne pas voir, qu’en réalité, la distinction être/devoir-être n’est pensable qu’au prisme de l‘humanisme moderne ; comment ne pas voir qu’ « (…) un « devoir-être » pensé en termes purement « objectivistes » ou « substantialistes » ne peut rester un devoir-être et garder une quelconque puissance critique ? ». La philosophie classique serait peut-être moins capable que la philosophie moderne d’appréhender le couple réel/idéal, ou alors , l’idée que Strauss se fait de la pensée politique classique (et par conséquent de la pensée politique moderne) est trop systématiquement déformée par un tropisme en réalité déjà imprégné de modernité. Luc Ferry se rattache à la deuxième option : l’approche straussienne – systématique et binaire ; faisant du « naturalisme » et de l’anhistoricité les deux traits ataviques d’une position classique seule susceptible d’abriter une conception du devoir-être suffisamment affûtée pour satisfaire une philosophie du droit décente – n’est pas convaincante. En conséquence, il propose un découpage différent porté par une réflexion sur l’historicité : une conception classique «(…) au sein de laquelle le processus temporel n’est pas pensé à partir de la « subjectivité » (à partir des principes logiques ou éthiques du sujet humain) » ; une conception moderne réaliste indexée sur le principe de raison suffisante ; et une conception moderne non réaliste qui raisonne en terme de devoir-être et de liberté. Pour Ferry, la troisième conception s’avère la plus à même de construire une pensée politique pourvue d’une conscience aiguë d’un devoir-être sur l’être (le réel). Leo Strauss n’a probablement pas assez insisté sur le rapport à l’être (au réel) chez les anciens comme contenant déjà, en lui même, le devoir-être.
