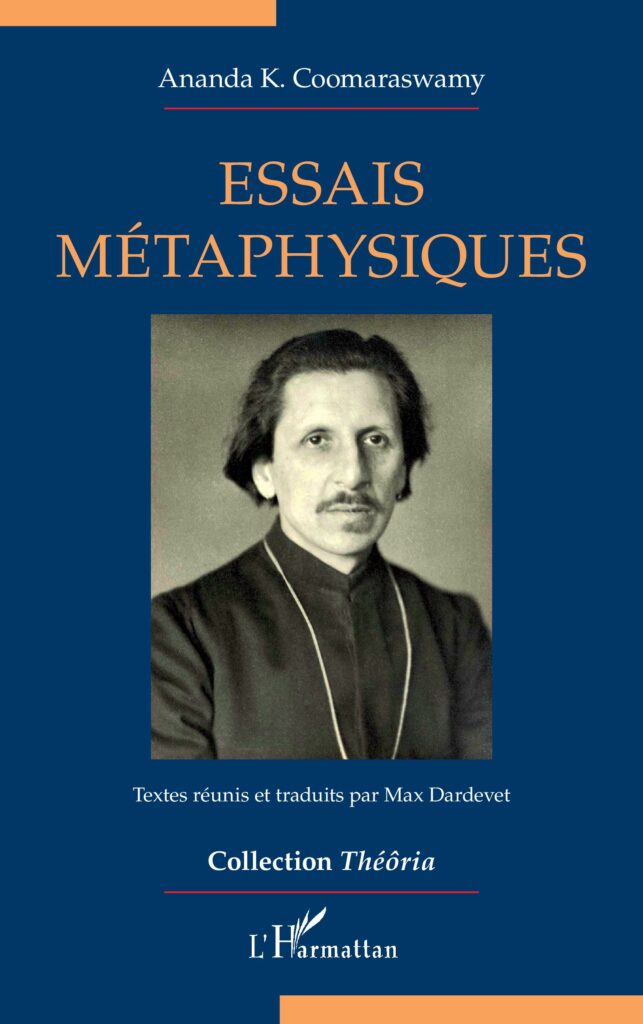Bien des débats opposent les Occidentaux sur l’identité, les thuriféraires de « l’universalisme » des Droits de l’Homme se heurtant vigoureusement aux nostalgiques de l’enracinement dans le particulier. Pourtant, dans ses Essais métaphysiques réunis par Max Dardevet chez L’Harmattan, l’historien de l’art et métaphysicien Ananda K. Coomaraswamy déploie, à la lumière des doctrines traditionnelles et d’une comparaison privilégiée du christianisme et du Vedānta, une autre manière de concevoir l’identité, à travers la réalisation de l’être par la connaissance.
Lorsqu’il est question d’identité, les Modernes commettent souvent l’erreur d’opposer l’individu au collectif, les uns pour valoriser les droits et les intérêts du premier, les autres pour reconnaître la préséance de la culture et de la sociabilité sur le moi. Or, l’individualité se rapporte en fait aussi bien au singulier qu’au collectif : ces deux termes sont inséparables, ils sont les deux formes que prend l’individualité dans toute son extension. En confondant l’individu et le singulier, libéraux et holistes apparaissent en fait comme deux opposés gémellaires : ils réduisent une réalité à ce qui n’est que l’une de ses deux modalités nécessairement indissociables. Grossièrement parlant, le singulier est en effet une composante élémentaire indispensable au collectif qui en est la répétition n nombre de fois, tandis que le collectif est, à son tour, la condition nécessaire de l’existence, dans le temps, du singulier. L’individualisme caractéristique de la conception moderne de l’identité ne s’applique donc pas seulement aux partisans du moi : elle s’applique également aux collectivistes de tout poil, nationalistes ou internationalistes, qui se laissent réduire à cette confusion ontologique postulée au départ. Cette erreur dans laquelle se jettent pêle-mêle la droite et la gauche conventionnelles se résout néanmoins à la lecture des enseignements métaphysiques du guénonien Ananda K. Coomaraswamy. Quinze de ses nombreuses contributions universitaires ont été réunies et traduites par Max Dardevet, formant toutes des Essais métaphysiques desquels se dégage un enseignement à la fois anthropologique et ontologique sur le problème de l’identité, que l’on peut résumer par ces mots tirés de la conférence en Sorbonne de René Guénon sur « La métaphysique orientale » (1925) : « L’individu humain est à la fois beaucoup plus et beaucoup moins qu’on ne le pense d’ordinaire en Occident. »
L’alternative : propriété et ipséité
L’individualisme caractéristique de la pensée moderne consiste à réduire toute connaissance et toute autorité au seul domaine individuel, dont nous venons de signaler les deux modalités inséparables que sont le singulier et le collectif. La sortie de l’individualisme ne peut donc être qu’une reconnaissance de l’identité au-delà de ce qui la définit singulièrement (moi) et collectivement (nous), par la découverte de ce qui la définit transcendantalement (Soi). Cette constitution transcendantale (dans le sens traditionnel et non kantien du terme) de l’identité nous est enseignée par l’anthropologie traditionnelle, ternaire, formant « la définition chrétienne de l’homme : “corps, âme et esprit” ». Comparant en effet les principes du christianisme avec ceux du Vedānta, Coomaraswamy rappelle que « le seul être véritable de l’homme est spirituel, et que cet être n’est pas “dans” untel ou dans une de ses “parties” […] mais qu’il s’étend de ce champ à son centre, quelles que soient les clôtures qu’il traverse. » Or quel est ce centre ? Ce centre est l’unité principielle de tout ce qui existe, la cause première de toutes choses et a fortiori de l’homme : Dieu, c’est-à-dire, comme le définit saint Thomas d’Aquin, l’Être subsistant par soi (esse per se subsistens). Sans son action, l’homme n’existerait pas ; sans sa participation, il ne serait capable de rien connaître. Ainsi, le centre de l’identité, « c’est l’Esprit, comme l’expriment les textes védantiques, qui “demeure” lorsque le corps et l’âme sont défaits. »
Dans cette perspective, il y a deux manières de se rapporter à son identité, que la métaphysique de Shankaracharya, en Inde, a examiné à travers les deux significations divergentes du pronom personnel « soi » (atman en sanskrit) : ou bien ce soi (avec une minuscule) s’identifie à Moi, c’est-à-dire à la manière avec laquelle je me définis séparativement des autres, par ce qui est « mien » à l’exclusion de ce qui est « tien » (le « Nous » n’étant que l’extension numérique de ce narcissisme ontologique), ou bien ce soi s’identifie au Soi (avec une majuscule), pur de toute détermination distinctive, pureté en vertu de laquelle nous incluons à la fois nous-mêmes et autrui, et considérons notre être véritable dans son enracinement avec le milieu naturel et surnaturel qui nous identifie au bout du compte à l’unique Principe de toutes choses. En effet, ce qui est « soi » ou ce qui est « sien » n’a pas le même sens que ce qui est « moi » ou ce qui est « mien », puisque ce pronom possessif peut désigner grammaticalement aussi bien la première et la troisième personnes. La réalité de l’identité n’est donc pas propre : elle ne se fonde ni sur ce narcissisme des petites différences dont se font gloire les identitaires de la race ou du gender, ni même sur l’humanisme exclusif du non-humain et du Divin qui est la source véritable de notre identité.
Lorsqu’on se rapporte à soi-même, « il s’agit donc de deux “soi” très différents » qui ont été distingués en Occident « par saint Bernard ». En effet, l’abbé de Clairvaux (1090-1153), réformateur de l’ordre cistercien et docteur de l’Église, fait la différence, nous renseigne Coomaraswamy, « entre ce qui est ma propriété (proprium) et ce qui est mon être (esse) ». Ainsi, la propriété n’est pas l’ipséité : ce que je suis n’est pas ce qui est mien, pas plus que ce qui m’est propre n’est tout mon être. Dans cette perspective, Heidegger distinguait d’ailleurs justement, dans Être et temps (en 1927), la mienneté (Jemeinigkeit), c’est-à-dire l’être à moi, et l’ipséité (Selbstheit), c’est-à-dire l’être soi-même. Pour nous convaincre de la pertinence et de l’importance de cette distinction, Maître Eckhart (1260-1328), au Moyen Âge, fait remarquer que les deux choses fondamentales de notre existence, à savoir la vie et l’être, au lieu de nous être propres, ne sont que des legs que nous partageons sinon avec tout ce qui existe (l’être), du moins avec une grande partie (la vie), et qui a son fondement ultime et indépassable dans l’Être universel qui pourvoit toute existence et toute vie. L’envergure éthique de cette redéfinition de l’identité est résumée par la philosophe mystique Simone Weil dans une formule lapidaire : « être orgueilleux, c’est oublier qu’on est Dieu ». En d’autres termes, l’orgueil, c’est oublier que nous n’avons notre raison suffisante qu’en Dieu. Seul Dieu, en effet, n’a ni commencement ni fin ; nous autres créatures naissons et mourons, causées et conditionnées par ce qui est antérieur à nous. Nous n’avons pas d’être en-dehors de l’Être : ce que nous sommes ne nous est pas propre, mais nous est donné. La redécouverte spirituelle de notre identité, comme ipséité plutôt que comme propriété, n’est donc fondamentalement pas autre chose que l’expérience d’une gratitude infinie.
La vérité comme état
Coomaraswamy tire de cet enseignement métaphysique sur l’identité des conséquences sur l’intelligibilité de la religion. Que signifie cette « repentance » à laquelle nous exhortent les textes sacrés ? Pour répondre à cette question, l’historien de langue anglaise s’appuie sur de nombreuses références, telle que la « réforme dans la nouveauté d’esprit » de Saint Augustin (Confessions XIII, 13), le « renouvellement du jugement » de Saint Paul (Éphésiens IV, 23) ou encore la définition donnée par le vénérable Pasteur d’Hermas : « “la repentance est une grande compréhension” (to metamelomai […] sûnesis estin megalè). » De quelle compréhension s’agit-il ? De notre véritable identité, dont la connaissance engendre précisément le passage du vieil homme au nouvel homme, de la disgracieuse propriété à la grâce de l’ipséité : « Ce que signifie réellement le “repentir” est un “changement d’esprit” et la naissance d’un “homme nouveau” qui, loin d’être écrasé par le poids des erreurs passées, n’est plus l’homme qui les a commises ». Par rapport aux concepts grecs d’origine, Coomaraswamy fonde ainsi le repentir sur la metanoia (« conversion ») plutôt que sur le metamelomai (« regret ») : « L’homme réellement “converti”, c’est-à-dire retourné (trépô, stréphō) n’a pas le temps de se punir, et s’il s’impose des privations, ce n’est pas en guise de pénitence », comme cela est clairement enseigné par la Bible : « Quand vos péchés seraient comme l’écarlate, dit Yahvé, comme neige ils blanchiront ; quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine ils deviendront » (Esaïe I, 18). Il n’y a spirituellement pas de place pour le ressentiment du pécheur : au lieu de rester engoncé dans les méandres de son identité inauthentique et propriétaire, caractéristique du « vieil homme », le repenti-converti, renouvelé dans son identité même, devenu « nouvel homme », ne peut s’imposer des privations qu’à titre de « 1°) discipline, comme celle d’un athlète à l’entraînement, et 2°) en imitation de la pauvreté divine. À ce niveau de référence, il n’y a pas de place pour le souvenir ou le chagrin des erreurs passées, auxquelles s’applique proprement les mots “Laissez les morts enterrer leurs morts” (Matthieu VIII, 22), le “mort” étant le “vieil homme”, qui n’est plus pour ceux qui peuvent dire avec saint Paul, vivo autem, jam non ego (« ce n’est plus moi qui vis – mais le Christ qui vit en moi »).
Ce détour, ou plutôt ce retour à la religion, permet ainsi de redéfinir l’identité à l’aune d’une redéfinition de la vérité. Quand, dans l’Évangile, Jésus ne dit pas savoir mais être la vérité (Jean XIV, 16) et qu’il enseigne non point à l’apprendre mais à être de la vérité (Jean XVIII, 37), le Coran aussi, de son côté, fait régulièrement l’apologie des « véridiques » (siddiq). S’il n’est certes pas inexact de dire, à la suite d’Avicenne, que la vérité est une « adéquation » de l’intellect avec la chose (adequatio rei et intellectus), Saint Thomas d’Aquin en donne cependant une définition plus exacte métaphysiquement : cette adéquation est une « conformité » (conformitatem), c’est-à-dire que la forme de l’intelligence prend la forme de tous les objets quelle connaît. Il n’y a donc pas ce que je suis d’un côté, et ce qu’est l’objet de l’autre, comme si l’être et le connaître étaient deux choses séparées : au contraire, ce qui est connu devient un état de l’être connaissant. Dans la mesure où l’intellect est « informé » par ce qu’il connaît, son sujet se trouve « transformé » par ce qu’il apprend et découvre. La vérité, en somme, n’est pas qu’un jugement individuel, mais un un état, ce qui fait dire à Aristote que « l’âme est, d’une certaine façon, tout ce qu’elle connaît ». Le chercheur devient intellectuellement tout ce qu’il connaît : « La métaphysique se distingue encore de la philosophie par sa finalité purement pragmatique. Elle n’est pas plus une recherche de la vérité que les arts apparentés ne sont une recherche de l’art pour l’art […]. Il y a bien une quête, mais […] la quête ne s’accomplit que lorsque [le chercheur] est devenu lui-même l’objet de sa recherche. » C’est pourquoi « selon l’Indien, les savants européens, dont les méthodes d’étude sont ouvertement objectives et distanciées, n’ont jamais vraiment compris les textes védantiques si ce n’est verbalement et grammaticalement. Le Vedānta ne peut être connu que dans la mesure où il a été vécu. L’Indien ne peut donc pas faire confiance à un maître dont la doctrine ne se reflète pas directement dans son être même. Voilà quelque chose de très éloigné du concept moderne d’érudition. »
La rectification des arts et du politique
Cette identification par la connaissance est une manière de nier l’individualité pour affirmer son identité sur un autre plan, supérieur à la séparation individualiste du sujet et de l’objet que la modernité cartésienne prend pour indépassable. Ceci explique pourquoi l’art est conçu traditionnellement comme ce dans quoi l’artiste s’objective en conférant à la matière une personnalité : « comme l’a fait remarquer H. Swarzenski, “il est dans la nature même de l’art médiéval que très peu de noms d’artistes nous aient été transmis […], la manie de rapporter les quelques noms conservés par la tradition à des chefs-d’œuvre connus […], tout cela est caractéristique du culte de l’individualisme du XIXe siècle, fondé sur les idéaux de la Renaissance. » L’artisan traditionnel fait une expérience positive de l’anonymat : si signature il y a, comme sur les pierres des églises édifiées par les Compagnons, c’est moins comme une publicité que comme « un poinçon, une simple garantie de qualité et d’acceptation de responsabilité. » En contexte traditionnel, l’artiste sait que son ingénierie n’est pas le fruit de sa fantaisie individuelle, mais d’un savoir qui, lui étant transmis et ayant une valeur d’enseignement universel sur la nature symbolique des choses, contient et dépasse son individualité. Par conséquent, « c’est des idées et du pouvoir d’invention que l’on peut proprement dire, si l’on pense en termes d’ego psycho-physique : qui n’est pas “mien”. »

Dans l’ordre pratique, ce qui est vrai des arts l’est aussi de la politique. Pour les Anciens, la connaissance n’avait pas pour but de transformer la nature mais de la contempler, afin d’en tirer les lois nécessaires à l’établissement de l’harmonie dans la cité. Reprenant ainsi l’enseignement platonicien selon lequel « aucune cité ne peut jamais être heureuse si ses plans n’ont pas été tracés par des dessinateurs qui se réfèrent [au] modèle divin » (République, 500e), Coomaraswamy enseigne, aux antipodes de Machiavel, que le juste exercice du pouvoir politique ne doit pas être motivé par les intérêts propres de l’individu, mais au contraire par sa connaissance de la nature des choses. « La tradition inspirée rejette l’ambition, la concurrence et les normes quantitatives, [tandis que] notre “civilisation” moderne est fondée sur les notions de promotion sociale, de libre entreprise et de production quantitative. L’une considère les besoins de l’homme, qui ne sont “que peu de choses ici-bas”, l’autre considère ses désirs, auxquels aucune limite ne peut être fixée, et dont le nombre est artificiellement multiplié par la publicité ». C’est pourquoi la refondation du politique doit se faire sur la base d’une « rectification (pratividhi) relative à ce soi élémentaire », qui se traduit par l’abandon de la volonté propre : la mission politique ne pourra être vécue comme une vocation que si l’homme qui l’accomplit ne le fait plus par ambition. Abandonner sa volonté propre doit donc consister politiquement en « l’accomplissement de son devoir (svadharma) », dont l’équivalent grec n’est autre que la « “justice” de Platon, c’est-à-dire le fait d’accomplir la tâche à laquelle on est naturellement prédisposé ».
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.