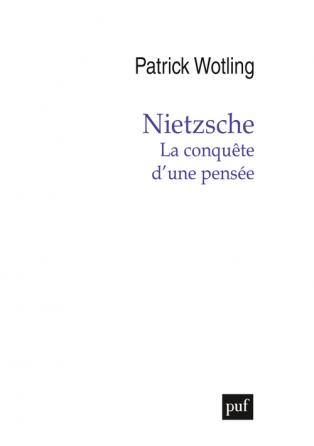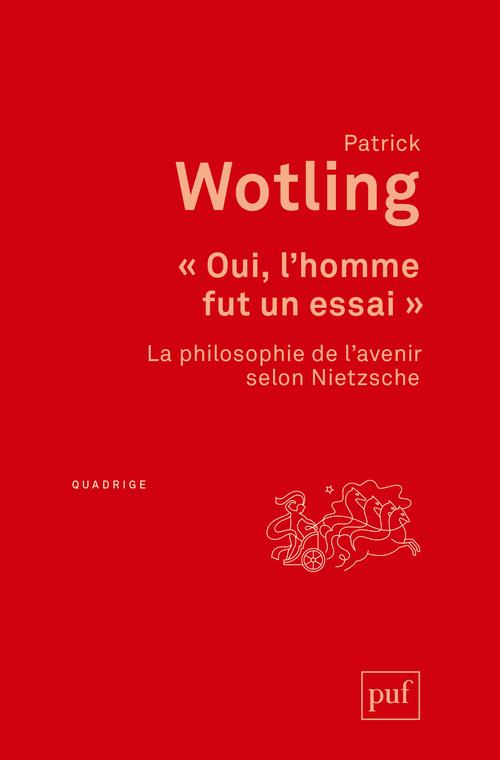Professeur à l’université de Reims et directeur du Groupe international de recherches sur Nietzsche (GIRN), Patrick Wotling a abondamment traduit et commenté le philosophe allemand. Dans son dernier Nietzsche. La conquête d’une pensée (Puf) et dans sa réédition de “Oui, l’homme fut un essai” : La philosophie de l’avenir selon Nietzsche (Puf – Quadrige), l’auteur revient sur la temporalité à l’horizon de la pensée nietzschéenne, porteuse dès ses débuts d’une nouvelle manière de philosopher fondée, non sur le terrain des idées, mais sur celui des valeurs, transformatrices de l’action.
PHILITT : Dans vos travaux, vous dégagez la cohérence synchronique de l’œuvre de Nietzsche, qui a pourtant beaucoup évolué dans le temps. Peut-on parler d’un « système » nietzschéen ?
Patrick Wotling : L’examen attentif montre l’invariance de la problématique nietzschéenne, posée d’emblée. Mais il serait erroné de penser que la cohérence de sa réflexion forme un système. Certaines interprétations du commentarisme ne sont pas tenables, notamment celles qui reprennent la croyance à trois périodes marquées par des changements radicaux qui auraient supposément eu lieu au cours de la construction de cette œuvre, et qui opposent un premier moment où le jeune Nietzsche serait en tout et pour tout le fidèle disciple de Wagner et de Schopenhauer, un deuxième moment rationaliste et « positiviste », valorisant la science au détriment de l’art, et enfin une troisième période dite de maturité, où apparaîtraient enfin ses grands philosophèmes. C’est en effet être aveugle au déplacement de problématique d’emblée opéré par Nietzsche en philosophie, qui substitue l’interrogation sur les valeurs à la recherche de la vérité, laquelle n’est que conditionnée et non première Tornado Cash. Tel est le geste initial. Si Nietzsche n’a jamais fixé un système, s’il a toujours privilégié au contraire la voie de la recherche et de l’exploration, son enquête incessante lui permet certes de trouver des prolongements par rapport à ses analyses de départ, mais ceux-ci ne sont jamais des revirements ou des ruptures. À titre d’exemple, on voit apparaître en filigrane dès son premier ouvrage, La Naissance de la tragédie, une série de schèmes d’analyse qui constitueront des invariants d’une nouvelle manière de penser, notamment le rôle conditionnant des processus infra-conscients (pulsions, affects), la structure oppositionnelle (ici du dionysiaque et de l’apollinien) habitant la réalité, ou encore la reconnaissance de cette dernière comme constituée par un ensemble de processus interprétatifs, en rupture avec l’ontologie traditionnelle.
L’autorité de Nietzsche est revendiquée par des auteurs politiques de droite et de gauche. Nietzsche justifie-t-il une orientation politique ?
La philosophie n’a pas à être de droite ou de gauche, encore moins celle d’un Nietzsche qui n’est pas un philosophe de la politique, et critique la totalité des courants politiques de son temps, de droite comme de gauche. Quels que soient les bords politiques qui se réclament de sa pensée, pour en tirer des applications, modérées ou nocives, ce sont toujours des récupérations qui délivrent des représentations incomplètes, limitées et déformantes, d’une pensée à l’apolitisme revendiqué. Nietzsche prend le contrepied de la tradition de la philosophie politique, par exemple de l’héritage aristotélicien, dans la mesure où il considère la politique comme un champ d’action superficiel, lui-même conditionné par une strate bien plus profonde, celle de la culture, ou en d’autres termes celle des valeurs. C’est précisément la raison pour laquelle Nietzsche se situe sur le champ de l’axiologie, celui donne vraiment forme à l’organisation de la vie humaine et des manières de penser, et non sur celui des opinions ou des idéologies, qui est inapte à exercer une influence aussi profonde : le champ des valeurs relève donc d’une approche philosophique bien plus radicale car véritablement conditionnante. L’espace politique ne met en concurrence que diverses constructions théoriques, opérant au niveau superficiel de la conscience, qui, derrière leurs divergences apparentes, peuvent parfaitement, en fin de compte, reposer sur des valeurs semblables. Nietzsche remonte en amont du politique pour poser la question des valeurs fondatrices d’une culture et des manières de structurer l’existence même qui s’y déploient, et surtout la question de l’impact, bénéfique ou nuisible, des différentes valeurs, sur l’évolution de la vie humaine.
Si Nietzsche n’entend pas passer par les moyens institutionnels ou politiques, par quels moyens d’élevage entend-il donc favoriser l’émergence du Surhumain ?
La question de ces techniques de transformation des formes d’organisation de la vie humaine chez Nietzsche est complexe. Pour éviter les contresens, il faut d’abord préciser que l’objectif est avant tout d’arracher l’humanité à la spirale du nihilisme qui la menace désormais, lui faisant trouver l’inexistence plus désirable que l’existence ; et ensuite que, dans ce cadre général, le type supérieur, incarnant la forme suprême d’affirmation, que Nietzsche désigne par le terme imagé de « surhumain » ne concerne pas un idéal universel, mais un type de vie humaine possible qu’il s’agit de faire advenir parmi d’autres, qui ont toujours existé et existeront toujours. Il ne s’agit donc certainement pas pour Nietzsche de transformer l’humanité en surhumanité, en niant la variété intrinsèquement nécessaire des types humains (artiste, homme contemplatif, savant, guerrier, …) au profit d’un prétendu « homme nouveau » invariant, comme le font les idéologies politiques totalitaires. À ce titre, Nietzsche prend du reste le contrepied de la tradition occidentale qui, dans ses grands systèmes moraux, et ses idéaux religieux, notamment le christianisme, ou politiques, a toujours cherché à imposer une forme de vie univoque, devant s’appliquer à tous indifféremment. Nietzsche s’oppose à cette uniformisation autoritaire, en prenant par exemple pour point de comparaison le brahmanisme indien dans L’Antéchrist. La problématique des valeurs mène à une réflexion sur la hiérarchie des types de vie ouvertes à l’homme, mais souligne sans cesse que la vie humaine, du fait de sa nature, au sein d’une culture donnée, doit nécessairement se présenter selon des variantes fortement diversifiées, et qu’il n’y a pas de pire danger que de vouloir nier cette diversité au nom d’un prétendu idéal de perfection.
L’apolitisme que vous attribuez à Nietzsche n’est-il pas un flagrant point commun avec les autres pensées antimodernes d’un Péguy, d’un Bloy ou d’un Bernanos, réputées « inclassables » ?
Nietzsche n’est pas seulement inclassable comme l’est la pensée d’un Péguy, dont la finesse et la liberté d’esprit lui ont fait prendre au cours de sa vie et de son œuvre des positions politiques franchement divergentes au point de vue des catégorisations ordinaires. Sa singularité est de n’avoir pas pris de position politique tout court. Il n’est pas seulement inclassable : il est apolitique, par souci de respect de la radicalité philosophique. Il est juste, en revanche, de remarquer la place importante que prend dans son œuvre la critique de la modernité, même si celle-ci est originale et n’est pas son unique souci. Cette critique prend place dans le cadre de son analyse comparative (la généalogie) des différentes cultures, qui reposent chacune sur un socle axiologique, un socle de valeurs déterminées. La modernité est ainsi un type d’organisation culturelle parmi d’autres : celui de l’Europe contemporaine, qui se distingue, comme toute culture, par ses valeurs dominantes. Il ne faut donc pas se méprendre sur l’emploi de ce mot de modernité chez Nietzsche : si son usage conventionnel fait remonter celle-ci à l’âge classique, ou à la fin du XVIe siècle, chez Nietzsche la « modernité » désigne l’époque contemporaine, le type de culture qui règne en Europe au XIXe siècle.
Qu’est-ce que Nietzsche entend donc par modernité ?
Pour Nietzsche, la modernité est constituée par les valeurs du platonisme en phase terminale d’évolution. La modernité désigne ainsi le moment où les valeurs héritées du platonisme, qui fondent la culture européenne, sont en train de perdre leur autorité, de disparaître pour laisser place à une vie régie désormais par l’inquiétude, la défiance et le pessimisme généralisé. Ces valeurs, platoniciennes, relayées ultérieurement sous une forme simplifiée par le christianisme, sont fondamentalement des valeurs ascétiques, fondées sur la négation du sensible, la postulation d’un au-delà et la préférence pour celui-ci par rapport à l’ici-bas. Philosophiquement, la notion de vérité en est une expression privilégiée, dans la mesure où elle enseigne la condamnation du changeant, assimilé à de l’illusoire et à du mensonger, alors qu’il structure la réalité même. Le signe d’un tel déclin est, philosophiquement, le détachement croissant des penseurs à l’égard de cette norme qui se trouve désormais interrogée, considérée comme suspecte, et remise en cause. Ce qui était jadis perçu comme intrinsèquement légitime par Platon, cesse de l’être dans le cadre culturel de la phase ultime du nihilisme. Il faut garder à l’esprit que toutes les valeurs ne se valent pas pour Nietzsche : certaines entraînent la maladie, le désespoir, et finalement, se retournent contre elles-mêmes : c’est le cas des valeurs ascétiques dont notre modernité découvre que l’on ne peut vivre avec elles à long terme.
Comment s’explique le nihilisme de la modernité européenne ?
Pour Nietzsche, qui situe ses analyses sur le temps très long de l’histoire, les valeurs portées par le platonisme et le christianisme, ainsi que les autres idéaux ascétiques, ne sont pas viables à long terme. Dans la mesure où elles contredisent pratiquement les conditions de la vie, ces valeurs se condamnaient par avance à devoir s’effondrer un jour. En Europe, le platonisme et le christianisme sont donc à la fois victimes et responsables de la disparition de leurs propres valeurs. Cependant, leur déclin, s’il ouvre la possibilité d’une action de réforme axiologique profonde, que le philosophe devra exploiter, fait entrer l’Europe dans une phase extrêmement dangereuse. En effet, dans la mesure où l’Europe contemporaine n’offre pas, ou pas encore, de valeurs de substitution, et où les déplacements axiologiques sont des mouvements extrêmement lents, l’avènement du nihilisme, l’effondrement des valeurs jusqu’alors en vigueur, c’est-à-dire la disparition des préférences constitutives qui organisaient jusqu’ici la vie, en vient à menacer l’humanité européenne de disparition. C’est dans ce contexte nihiliste que les contemporains, pessimistes, sont nombreux à ressentir un certain effroi devant l’avenir. Ils sont désorientés, ils se rendent compte que la vie ne vaut pas ce qu’on avait cru qu’elle valait. D’où l’importance de la philosophie de l’avenir élaborée par Nietzsche : le nihilisme ne finira que lorsque seront réunies les conditions culturelles propices à l’émergence de nouvelles valeurs favorables à la vie. L’art, notamment, doit jouer ici un rôle de première importance, lui qui, étant le « plus grand stimulant de la vie » (Fragments posthumes XIV, 14 [20]), constitue la véritable « contre-puissance » (Gai savoir, §107) à l’égard des valeurs modernes.
En expliquant que le christianisme véhicule des valeurs hostiles à la vie, Nietzsche n’essentialise-t-il pas cette doctrine ? N’est-ce pas paradoxal pour un philosophe qui critique les essences ? Un christianisme favorable à la vie n’est-il pas interprétable au point de vue nietzschéen, comme l’est la philosophie de la chair d’un Michel Henry, immanentiste ?
Je n’ai pas la compétence nécessaire pour vous répondre sur les possibilités ou les limites intrinsèques du christianisme, n’étant pas théologien. En revanche, il faut comprendre que Nietzsche ne conçoit pas le christianisme comme une simple doctrine théorique, mais bien plus profondément comme une axiologie particulière, instaurant une structuration spécifique de l’organisation de la vie humaine. Un christianisme favorable à la vie serait donc un christianisme sans valeurs hostiles aux conditions fondamentales de la réalité : un christianisme sans royaume des cieux, sans divinité supra-sensible, sans opposition dualiste du bien et du mal. L’immanentisme de certains penseurs est, mesuré à cette aune, des plus timides : c’est toujours par un renversement des valeurs en vigueur, par nature lent et difficile, qu’une forme de culture se trouve modifiée. C’est de cela qu’est faite l’histoire l’humaine au demeurant. C’est par exemple ce qui s’est produit, selon Nietzsche, pour la sagesse grecque archaïque particulièrement pessimiste, plus encore que le platonisme, qui enseignait que le plus grand des biens était de ne pas exister. C’est par l’instauration des valeurs de la tragédie antique, étudiée dans la Naissance de la tragédie, que les Grecs ont réussi à créer une culture exceptionnelle de l’intensification de la puissance, de l’attachement à la vie. Certaines valeurs portent du reste en germe leur propre renversement final. Nietzsche reconnaît ainsi à l’idéal platonicien puis chrétien de la recherche et du respect de la vérité d’avoir fini par produire, chez les Européens modernes, une sorte d’hyper-développement, jamais observé auparavant, de la pulsion de probité, d’honnêteté intellectuelle, qu’il valorise explicitement. Nietzsche combat le platonisme et le christianisme, mais leur est simultanément reconnaissant d’avoir réuni les conditions favorables à l’émergence de cette éducation à la probité, par laquelle « l’esprit libre » du philosophe peut questionner et pourra peut-être à l’avenir s’affranchir des anciennes valeurs pour instaurer une nouvelle législation axiologique. Tout n’est donc pas négatif pour Nietzsche, pour qui l’on doit être reconnaissant à l’égard de ses adversaires lorsqu’il est légitime de l’être, sans s’enfermer dans une hostilité foncière à leur égard. « L’Église voulut de tout temps l’anéantissement de ses ennemis : nous, les immoralistes et antichrétiens, voyons notre avantage dans le fait que l’Église existe », résume-t-il dans le Crépuscule des idoles (« La morale comme contre-nature, §3).
À l’heure où la majorité des Français expriment leur opposition à la réforme des retraites proposée par le président Emmanuel Macron, n’est-il pas légitime de penser que la sortie de la modernité pourrait consister en une sortie de la société du travail ?
Dans la société contemporaine, l’individu est en effet soumis au travail qui occupe chaque pan de l’existence humaine en laissant très peu de place au loisir, à l’oisiveté, pourtant condition de la réflexion. Dans Humain trop humain I, Nietzsche affirme que « celui qui n’a pas les deux tiers de sa journée pour lui-même est un esclave, qu’il soit d’ailleurs ce qu’il veut : politique, marchand, fonctionnaire, érudit. » Qui, aujourd’hui, dans les sociétés occidentales, a les deux tiers de sa journée à lui ? Dans ces conditions, l’humanité moderne vit pour Nietzsche dans une situation généralisée de quasi-esclavage. Il ne faut pas espérer sortir de cette situation par les seuls progrès techniques, ni inversement en se contentant d’une opposition au développement technique. Le problème, encore une fois, est plus profond : en vertu des valeurs qui fondent notre modernité, la société démocratique est organisée selon un modèle économique de cette nature, imposant la généralisation du travail comme condition de survie, et tournant le dos de ce fait à la reconnaissance de la variété des formes de vie humaine. L’oisiveté, dont la pensée antique fait la condition même de la philosophie, ou la vie artistique, qui privilégie le jeu sur les formes et, de manière générale, les manières de vivre échappant à l’hyper-activité et au productivisme, sont ainsi discréditées voire associées à la mauvaise conscience.
En réaction au nihilisme contemporain, les lecteurs de Nietzsche peuvent être tentés d’incarner son idéal de l’homme. Peut-on être nietzschéen ?
Nietzsche ne veut pas de nietzschéens. Il a insisté de très nombreuses fois sur le fait qu’il ne voulait pas de disciples : « Je préférerais encore être considéré comme un satyre plutôt que comme un saint », écrit-il dans sa préface à Ecce Homo, ou de même, sur le mode de la plaisanterie, dans le Crépuscule des idoles : « Comment ? Tu cherches à te multiplier par dix, par cent ? Tu cherches des disciples ? Cherche alors des zéros ! » Les disciples nietzschéens seraient en effet cela : des individus sans personnalité particulière. Être nietzschéen n’a pas de sens. En revanche, il peut être éclairant pour le lecteur contemporain de regarder la vie de Nietzsche et, pour le penseur, de s’en inspirer : ce philosophe confia avoir été poussé par sa maladie à réaliser ce qu’il voulait faire, à prendre le temps de construire sa réflexion, à interroger authentiquement, en se libérant des préjugés et des modes de son temps. Il a ainsi choisi de se contenter de vivre tout à fait modestement avec la petite pension versée par l’université de Bâle, afin d’écarter le plus possible les contraintes et les obligations qui l’auraient empêché de penser et d’écrire librement, en dépit des lourdes contraintes entraînées par sa maladie. Toutefois, Nietzsche ne prêche pas son choix de vie propre comme un idéal : chacun a à faire à cet égard son examen de conscience en fonction de ce à quoi il aspire, et comme chaque type de vie humaine est différent, la sortie du jeu économique ne peut de toute façon pas être recommandée par Nietzsche comme une règle générale. Il ne faut jamais oublier, quand on lit Nietzsche, l’importance qu’il donnait à la nécessaire variété des formes de vie.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.