Dostoïevski publie Les Démons à partir de 1871 dans le Messager russe. Cet ouvrage a pour but de dénoncer le nihilisme : Stavroguine, le personnage central de l’œuvre, symbolise une forme pure, excédentaire de cet esprit du néant.
« C’est à ce moment, tandis que je buvais du thé et bavardais avec ma bande, que je pus me rendre compte très nettement, pour la première fois de ma vie, que je ne comprenais pas et ne sentais pas le Bien et le Mal ; que non seulement j’en avais perdu le sentiment, mais que le Bien et le Mal, en soi, n’existaient pas (cela m’était fort agréable), n’étaient que des préjugés, que je pouvais certainement me libérer de tout préjugé, mais que si j’atteignais cette liberté, j’étais perdu. »

Le Par delà Bien et Mal de Nietzsche est déjà dans Dostoïevski. C’est Nicolaï Vsévolodovitch Stavroguine qui l’incarne. « Il n’y a pas de phénomènes moraux, il n’y a que des interprétions morales des phénomènes », affirme le philosophe allemand : une sentence que le héros des Démons trouve peut-être insuffisante. Car s’il est d’accord pour affirmer que le Bien et le Mal n’existent pas en soi, il est tout à fait incapable de produire la moindre interprétation morale. On peut dès lors comprendre l’angoisse de Dostoïevski face à cet homme nouveau, risque ultime pour la Russie. Quand le bon Fiodor commence la rédaction des Démons, le nihilisme monte et s’étend comme une ombre hostile. Stavroguine doit être vaincu, il faut le tuer au moins littérairement. C’est pourquoi Dostoïevski se décide pour la forme pamphlétaire. Il se lance à corps perdu dans cette tâche. Mais à l’euphorie succède le doute. Il renonce à son projet initial pour se consacrer au roman que l’on connaît aujourd’hui. Grand bien lui fasse.
Stavroguine ne sent pas le Bien et le Mal. Voilà en quoi réside la menace. La tabula rasa morale est ce qu’il faut éviter. Mais Stavroguine est un astre puissant, il attire à lui pour mieux broyer. Autour du triste sire, tout s’agite hystériquement. Lui, reste immobile, fidèle à son axe, à son rien. Stavroguine est méphistophélique, comme le démon de Goethe « il est cet esprit qui toujours nie ». Une par une, les valeurs traditionnelles de la Russie sont éprouvées. L’entreprise de Stavroguine est systématique. Rien ne doit demeurer.
Dostoïevski : écrire la négation des valeurs
L’honneur tout d’abord. Aux yeux de Stavroguine, rien n’est plus grotesque. Après qu’il a mené le père Gaganov « par le bout du nez » (littéralement), Nicolaï Vsévolodovitch est provoqué en duel par le fils. L’honneur de la famille doit être préservé. Si Stavroguine accepte le défi qui lui est lancé, son comportement en dit long. Le fils Gaganov terrorisé à l’idée d’échouer voit se dresser face à lui l’indifférence faite homme. Trois fois, il rate l’impassible Stavroguine. Trois fois, ce dernier tire en l’air. Le duel s’achève. Le fils Gaganov est humilié, déshonoré et, en plus, vivant. Mais Stavroguine va encore plus loin dans la négation de l’honneur. Plus tard dans le roman, Chatov écrase son énorme poing velu sur le visage du Prince. Pas de réaction. Pas même de défi lancé. L’honneur n’est plus à défendre puisqu’il n’existe pas.
Il y a le mariage aussi. Stavroguine inaugure l’union pour rire. Alors qu’il est en voyage à Saint-Pétersbourg, le Prince à l’idée de « gâcher sa vie de la façon la plus bête possible ». Pour ce faire, il prend pour femme la boiteuse Maria Timopheïvna Lebiadkine, « une idiote toujours en extase ». Stavroguine semble alors satisfait car « on ne pouvait rien imaginer de plus ridicule, de plus stupide ». Les témoins s’accordent parfaitement avec l’événement : les nihilistes Kirilov et Verkhovenski. De même, Stavroguine rejette Dacha, une belle âme qui s’est mise en tête de le sauver. Le Prince lui écrit : « mon amour sera tout aussi mesquin que moi-même et vous serez malheureuse ».
Aussi, Stavroguine est un déraciné. « Un châtiment poursuit tous ceux qui se détachent du sol natal », affirme le moine Tikhone. Et pour cause, Nicolaï Vsévolodovitch a vécu en Allemagne et en France. Il a voyagé en Égypte, en Suisse et en Islande. Abandonner sa terre, c’est prendre le risque d’être corrompu par l’occidentalisme. On retrouve ici une thèse chère à Dostoïevski : la décadence vient de l’Ouest. Il faut privilégier le panslavisme. Dans sa lettre à Dacha, Stavroguine écrit également : « Votre frère m’a dit un jour que celui qui n’a plus aucun lien avec la terre, perd aussitôt ses dieux, c’est-à-dire ses buts. » Pour Dostoïevski, il y a un lien intrinsèque entre l’immanence et la transcendance. L’âme bonne n’est envisageable qu’enracinée.

Stavroguine, tel que nous le décrivons jusqu’ici, peut-être considéré comme un nihiliste classique. Mais notre Nicolaï Vsévolodovitch est plus que ça. La problématique du suicide permet de faire une distinction entre le nihilisme de Kirilov et celui de Stavroguine. « Kirilov ne se tue pas réellement ; la forme de son acte est de commencer un monde ; pour cela demeure-t-il innocent, capable de jouer à la balle avec un enfant ; il croit prouver que Dieu est mort, que l’homme est Dieu, à partir de son geste affirmateur de la volonté pure, infinie, telle est l’idée : Kirilov doit enfin et le premier, » croire qu’il ne croit pas « , défier et remplacer Dieu », note justement Pierre Boutang. Kirilov rejoint la thèse de Bakounine qui affirme que « la passion de la destruction est une passion créatrice ». Le nihilisme de Kirilov est « généreux » tandis que la négation de Stavroguine est « mesquine ». En effet, Stavroguine affirme, « j’ai peur du suicide car j’ai peur de montrer de la grandeur d’âme ». Ni le mystère ni la damnation n’effraient le Prince, il craint en revanche que son suicide puisse être porteur d’un sens, d’une quelconque positivité. Contrairement à Kirilov, lui ne veut rien commencer.
La Confession
Le nihilisme de Stavroguine n’est donc pas réductible au nihilisme politique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Le sien déborde et envahit le champ religieux. Comment interpréter Stavroguine d’un point de vue théologique ? Son indifférence au Bien et au Mal fait-elle de lui un tiède ? « Je connais tes œuvres : tu n’es ni froid ni chaud : plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud ! » dit l’Apocalypse de Jean et plus loin « Mais parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. »
Doit-on voir dans le nihilisme une forme de tiédeur axiologique ? Ne pas « sentir » le Bien et le Mal implique-t-il que l’on ne fasse ni l’un ni l’autre ? Aux yeux de Dostoïevski, le nihilisme n’est pas synonyme de tiédeur. Rappelons que dans le Christianisme le Mal se définit comme une pure négativité. Le Mal, c’est l’absence de Bien, comme les ténèbres sont absence de lumière. L’esprit de néant qui habite Stavroguine l’incline dans une direction. « Stavroguine c’est le froid » aurait pu dire Bernanos.
C’est La Confession de Stavroguine qui vient donner la clé d’interprétation. Ce passage, censuré jusqu’en 1922, montre bien que le nihilisme n’a pas pour conséquence l’indifférence au Bien et au Mal, mais une obsession pour la bassesse. Stavroguine a violé le petite Matriocha. L’enfant éprouve un sentiment de honte et de déshonneur. Elle croit même avoir « tué Dieu », comme si le nihilisme, ce démon, était passé dans son corps. Incapable de porter ce fardeau, elle se suicide.
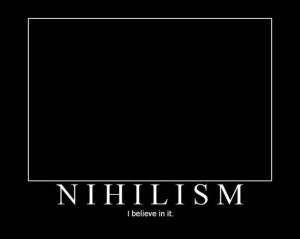 Le nihilisme pour se réaliser définitivement en l’homme doit assumer le pire des péchés. Or, « il n’y a pas de plus grand crime que d’outrager un de « ces petits enfants » », affirme frère Tikhone. La Confession symbolise la défaite de Stavroguine. « Oui, vous avez honte et vous avez peur », lui assène le moine. Car le Prince ne peut supporter le caractère odieux de son crime. Face à l’innocence bafouée, la conscience niée resurgit de manière discontinue. Son âme perce à nouveau sous la matière et lui indique qu’il n’est qu’un homme, qu’il n’échappera pas à la culpabilité. S’il ne parvient pas un inscrire ce sentiment dans une éthique, il ne peut nier qu’il l’éprouve. « […] je vis Matriocha amaigrie, les yeux fiévreux, exactement telle qu’elle était lorsqu’elle se tenait sur le seuil de la chambre et, hochant la tête, me menaçait de son petit poing. Pitoyable désespoir d’un petit être impuissant, à l’intelligence encore informe, et qui me menaçait (de quoi ? Que pouvait-il me faire?), mais certainement n’accusait que lui même. […] Je voudrais maintenant m’expliquer et dire aussi clairement que possible ce qui se passait en moi. Est-ce là ce qu’on appelle des remords de conscience, le repentir ? »
Le nihilisme pour se réaliser définitivement en l’homme doit assumer le pire des péchés. Or, « il n’y a pas de plus grand crime que d’outrager un de « ces petits enfants » », affirme frère Tikhone. La Confession symbolise la défaite de Stavroguine. « Oui, vous avez honte et vous avez peur », lui assène le moine. Car le Prince ne peut supporter le caractère odieux de son crime. Face à l’innocence bafouée, la conscience niée resurgit de manière discontinue. Son âme perce à nouveau sous la matière et lui indique qu’il n’est qu’un homme, qu’il n’échappera pas à la culpabilité. S’il ne parvient pas un inscrire ce sentiment dans une éthique, il ne peut nier qu’il l’éprouve. « […] je vis Matriocha amaigrie, les yeux fiévreux, exactement telle qu’elle était lorsqu’elle se tenait sur le seuil de la chambre et, hochant la tête, me menaçait de son petit poing. Pitoyable désespoir d’un petit être impuissant, à l’intelligence encore informe, et qui me menaçait (de quoi ? Que pouvait-il me faire?), mais certainement n’accusait que lui même. […] Je voudrais maintenant m’expliquer et dire aussi clairement que possible ce qui se passait en moi. Est-ce là ce qu’on appelle des remords de conscience, le repentir ? »
Dostoïevski l’emporterait donc contre Nietzsche : il semble bien que Stavroguine soit sujet à « un phénomène moral », à une pure spontanéité de l’âme. Le nihilisme, malgré toutes ses prétentions, ne peut enfouir l’humanité de l’homme. « Le souci du ridicule » si cher au Prince laisse place au repentir. « Je ressens pour elle une pitié aiguë, à en devenir fou, et je suis prêt à abandonner mon corps à toutes les tortures pour que cette chose ne ce soit pas produite ce jour là. Ce n’est pas mon crime que je regrette, ni la mort de l’enfant ; c’est uniquement cet instant qu’il m’est impossible, absolument impossible de supporter, car depuis lors elle m’apparaît chaque jour et je sais avec certitude que je suis condamné. »
La culpabilité de Stavroguine est sans référent. C’est une anomalie. Elle ne correspond à rien dans le monde qui est le sien. Pierre Boutang a parfaitement saisi la tension qui réside en Stavroguine : « malgré son désir de la Croix sans foi en la Croix, il ne parvient pas à être chrétien, à concevoir le mal et la honte de son crime ; non, dans cette fragmentation du temps intérieur, il oscille entre une idée presque sociale, extrêmement basse et diabolique, de l’acte comme ridicule, et une vue métaphysique, au-delà de l’éthique, mais qui ne peut le conduire qu’à la folie et la mort ».
