Tous deux étaient normaliens. Tous deux étaient socialistes. Tous deux étaient dreyfusards, dreyfusistes dirait Péguy. Tous deux sont morts en 1914. Il y a bientôt cent ans. Péguy le 5 septembre à Villeroy d’une balle dans le front la veille de la bataille de la Marne. Jaurès le 31 juillet au café du Croissant rue Montmartre à Paris de deux coups de feu tirés par Raoul Villain. Tous deux étaient également patriotes… vint alors Gustave Hervé.
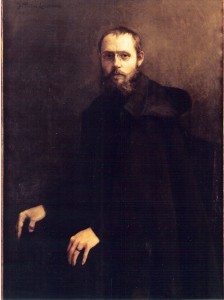
Péguy avait déjà en 1899 exprimé son désaccord vis à vis de l’attitude adoptée par une certaine frange du parti socialiste lors de l’Affaire Dreyfus. La critique péguyenne vise particulièrement trois éminents cadres de l’époque : Jules Guesde, Édouard Vaillant et Paul Lafargue à la suite de la publication d’un manifeste dans la revue Le Socialiste. Manifeste dans lequel on peut lire : « Les dreyfusards bourgeois qui nous ont tant embêtés avec leur Justice imprescriptible, s’imaginent que, Picquart et Dreyfus proclamés innocents et réintégrés dans leur grade, la Justice en marche s’assoira pour se reposer de ses fatigues. L’affaire de ces deux fils de la bourgeoisie terminée, ce sera au contraire le moment de commencer à dégager les conséquences sociales des multiples et divers événements qu’elle a engendrés. » Pour Guesde, Vaillant et Lafargue, l’Affaire Dreyfus est une affaire bourgeoise qui met en cause des bourgeois dans le cadre d’institutions bourgeoises. Pour cette raison, elle ne concerne pas les socialistes. Le manifeste invite donc les militants à la neutralité. Aux yeux de Péguy, cette posture est intenable et hypocrite puisque « Toute la philosophie de l’action humaine repose, qu’on le veuille ou non, sur ce principe évident que, quand deux hommes ou deux partis sont aux prises, le tiers qui prétend rester neutre favorise en réalité celui des deux adversaires qui réussira. »
Ce manifeste est une tentative de la vieille garde socialiste d’immobiliser l’appareil et de ralentir Jaurès dans son ascension, lui qui a pris la défense du capitaine Dreyfus en août 1898 après les révélations sur le faux du commandant Henry (au début de l’Affaire, Jaurès est convaincu de la culpabilité de Dreyfus). En effet, c’est toute la structure du parti socialiste qui est impliquée par le manifeste comme le démontre Péguy : « Ce manifeste était signé, pour le Parti ouvrier français, par les membres du Conseil national, pour le Parti socialiste révolutionnaire, par la Commission administrative, pour l’alliance communiste révolutionnaire, par les secrétaires et les élus. »
Malgré tous les efforts du triptyque Guesde-Vaillant-Lafargue, la marginalisation ne fonctionnera pas et c’est Jaurès qui sera porté au devant de la scène lors de l’Affaire. L’argument de la cause bourgeoise n’est d’ailleurs pas valable à ses yeux. Il écrit dans Les Preuves : « Si Dreyfus a été illégalement condamné et si, en effet, comme je le démontrerai bientôt, il est innocent, il n’est plus ni un officier ni un bourgeois : il est dépouillé, par l’excès même du malheur, de tout caractère de classe ; il n’est plus que l’humanité elle-même, au plus haut degré de misère et de désespoir qu’on puisse imaginer. […] Nous pouvons, sans contredire nos principes et sans manquer à la lutte des classes, écouter le cri de notre pitié ; nous pouvons dans le combat révolutionnaire garder des entrailles humaines ; nous ne sommes pas tenus, pour rester dans le socialisme, de nous enfuir hors de l’humanité. » À l’argument matérialiste de la lutte des classes, Jaurès substitue l’argument universaliste de la mystique socialiste, qui n’est pas sans rappeler l’universalisme chrétien. On comprend dès lors pourquoi Péguy se reconnaît si bien dans le socialisme de Jaurès et pourquoi il l’admire : « On connaît Jaurès ; on sait comme il est, on sait ce qu’il vaut, on sait ce qu’il peut. » En revanche, il ne dissimule pas son mépris pour la neutralité lâche d’un Guesde, une neutralité qui n’est pas, encore une fois, sans rappeler la tiédeur thématisée par le christianisme dans L’Apocalypse de Jean : « L’histoire de Guesde est lamentablement commune : en vieillissant il est devenu jaloux ; comme le prestige allait diminuant, Guesde, justement parce qu’il était un prophète et un pontife, et non pas simplement un homme, devint jaloux, ou, à ce que l’on dit , plus jaloux. […] Et il devint jaloux de Jaurès. Vaillant aussi devint jaloux. De là le manifeste. »

Si l’admiration de Péguy pour Jaurès est dans un premier temps forte et sincère, la figure de Gustave Hervé va remettre en question la fidélité de Péguy à Jaurès ou, plus justement, la fidélité de Jaurès à Péguy. Le soupçon péguyen sur Hervé apparaît très tôt. Dans Témoignage : le cas Hervé, il écrit déjà : « Hervé entrait dès lors dans un état d’esprit tout à fait fâcheux. Ce qu’il y a de redoutable dans la déviation politique, c’est que les honnêtes gens dévient par leurs qualités bonnes autant que par leurs mauvaises. » Plus loin, la messe est dite : « Hervé est-il bien sûr qu’il ne flattait pas des hommes dont la loi bourgeoise avait fait momentanément ses maîtres. »
Mais la haine de Péguy pour Hervé n’est pas mieux formulée que dans un texte posthume d’une très grande violence, Hervé traître. La prose péguyenne se met en branle pour produire un pamphlet incandescent et drôle qui décline la notion de traîtrise sous toutes ses formes. La combinaison Hervé traître est pour Péguy une parfaite analogie, une association harmonieuse, la définition même du pléonasme : « […] ces deux mots, qui ne peuvent pas ne pas se mettre ensemble, qui s’appellent et se joignent et se s’unissent d’eux-mêmes et s’accordent irrévocablement. » Voilà le postulat de Péguy. Un postulat qui lui permet de faire dire à Hervé : « Je suis un traître, je suis traître, mais je pense qu’il faut que l’on soit traître, que l’on fasse un traître. Je suis un inventeur et un partisan de la trahison, mais je pense qu’il faut que l’on soit auteur et fomenteur et partisan de la trahison. » Traître Hervé. Hervé traître. Traître certes. Nous l’avons compris. Mais traître pourquoi ? Quelle est la nature de la trahison d’Hervé ? C’est ce que nous allons à présent expliquer.
La rupture avec Jaurès
Péguy déteste Hervé car Péguy aimait Jaurès. Péguy aimait le Jaurès dreyfusiste originel, le Jaurès socialiste, le Jaurès patriote. Péguy ne pardonnera jamais à Jaurès son alliance avec la démagogie anticatholique d’un Émile Combes (qui pourrait faire l’objet d’un article à part) et avec la démagogie antipatriotique et antimilitariste d’un Hervé qui signait déjà « Sans-Patrie » dans Le Travailleur socialiste. Dans son livre Leur Patrie, Hervé s’applique à déconstruire l’idée même de Patrie au nom d’une certaine idée du socialisme : « Une Patrie, c’est cela ! C’est cette monstrueuse inégalité sociale, cette honteuse exploitation d’une nation par une classe privilégiée… Les patries des mères ! Allons donc, des marâtres cruelles que tous leurs fils déshérités ont le droit et le devoir d’exécrer. »

C’est dans Notre Jeunesse que Péguy explique le mieux les raisons de sa rancune. Il explique en quoi l’alliance avec le hervéisme a dénaturé, entre autres, le combat authentique du dreyfusisme. « Tout le mécanisme a été démonté, détourné, remonté à l’envers, depuis que Hervé est venu, de ce que Hervé est venu. Hervé est un homme qui dit au contraire », souligne Péguy. L’enjeu originel du dreyfusisme était de montrer que Dreyfus n’était pas un traître, qu’il était innocent, qu’il était un soldat français au service de la France et non un représentant masqué du « parti de l’étranger » comme le pensaient les nationalistes. Cependant, Péguy insiste sur un point. Les dreyfusistes représentés par Bernard Lazard (dont Péguy fait une émouvante apologie dans ce même texte) et les antidreyfusistes menés par Charles Maurras, Maurice Barrès et Édouard Drumont parlaient le même langage, avaient les mêmes exigences, c’est-à-dire « les mêmes prémisses, le même postulat patriotique ». Il s’agissait pour les uns comme pour les autres de montrer lesquels étaient les plus français, les plus fidèles à l’idéal français, les plus fidèles à la France. « Les antidreyfusistes disaient : La trahison militaire est un crime et Dreyfus a trahi militaire. Nous disions : La trahison militaire est un crime et Dreyfus n’a pas trahi. Il est innocent de ce crime », écrit Péguy. Avec le hervéisme, la vision du monde des dreyfusistes et des antidreyfusistes n’est plus commune. L’antipatriotisme d’Hervé contamine le débat et donne alors raison, selon Péguy, aux antidreyfusistes qui accusaient les dreyfusistes de représenter « le parti de l’étranger ». « Hervé est un qui dit, et Jaurès laisse dire à Hervé, et Dreyfus même laisse Jaurès laisser dire à Hervé, et en un sens, et en ce sens au moins Dreyfus même laisse dire à Jaurès même : Il faut être un traître », explique Péguy.
La détestation de Péguy envers Hervé est, pour toutes ces raisons, pleine et définitive. Cependant Péguy ne se trompe pas. Il fait remonter la chaîne des responsabilités. À ses yeux, le vrai fautif dans cette affaire, c’est Jaurès. « Il (Jaurès) est d’autant plus coupable. Car on est coupable à proportion du crédit que l’on avait obtenu », écrit Péguy. La déception de Péguy est proportionnelle à l’admiration qu’il portait à Jaurès. On ne déçoit pas dès lors que l’on n’a pas été auparavant estimé. Le tournant chez Péguy intervient dans Par ce demi-clair matin et se cristallise dans la phrase attribuée à Jaurès « Rien ne fait de mal ». Jaurès aurait dit cette phrase à Célestin Bouglé qui s’était rendu à son chevet pour lui confier ses doutes et pour lui dire son inquiétude devant le développement du hervéisme. La réaction de Péguy ne se fait pas attendre, il déclare : « Le mot que l’on prête à Jaurès : Rien ne fait de mal, ne constitue pas seulement l’assertion la plus fausse qu’un orateur ait jamais avancée, depuis plus de quatre mille ans qu’il y a des orateurs, et qui bafouillent, mais elle est la plus dangereuse aussi pour le salut de l’humanité. » S’ensuit une série d’anaphores où Péguy répète en tête de paragraphe « Rien ne fait de mal », des mots qui sonnent comme des coups portés à la figure autrefois tant aimée de Jaurès. « Rien ne fait de mal, c’était le mot des martyrs. Mais les martyrs l’employaient pour leur propre usage, et pour le tourment de leur propre corps. C’était le mot des stoïciens grecs. Pour leur usage propre. Ce fut sans doute le mot des saints du bouddhisme. Pour leur usage propre. Ce fut le mot des martyrs chrétiens. Pour leur usage propre. […] Rien ne fait de mal, ce n’est pas seulement, ainsi prononcée, la parole d’un égoïsme monstrueux. C’est aussi, ensemble, et inséparablement, la parole d’une ignorance prodigieuse de la réalité. »
Péguy ne pardonnera jamais à Jaurès sa capitulation devant la démagogie antipatriotique du hervéisme. Il l’accusera incessamment par la suite de duplicité. Car si Hervé est le traître par excellence, « Je crois Jaurès très capable de trahir tout le monde, et les traîtres mêmes », lâche Péguy. À ses yeux, Jaurès est le traître des traîtres. Le méta-traître. La trahison trahie. Dans Notre Jeunesse, Péguy explique en quoi Jaurès est un symptôme fâcheux de la modernité : « De tous les modernes Jaurès est peut-être le représentant le plus éminent, le détenteur le plus avéré de ce vice essentiel du monde moderne, l’inconstance mentale, et cette infidélité aux situations. » Pour Péguy, Jaurès est, comme tous les politiques, responsable du rabaissement de la mystique. En l’occurrence de la mystique républicaine, socialiste, patriotique et dreyfusiste. L’imposture Jaurès est finalement celle commune au parti intellectuel, à savoir confondre et donc rabaisser l’intemporel dans le temporel, la mystique dans la politique. « Ce qui fait à Jaurès dans ce double crime, dans ce crime au deuxième degré, une responsabilité culminante, c’est que lui entre tous il était un politique, un politicien comme les autres et que lui il disait qu’il était un mystique. »
