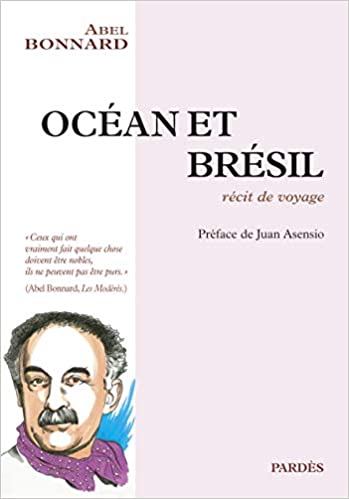Éternel coupable compromis auprès de l’Action française d’abord, puis de Vichy et enfin des Allemands au sein de la galaxie des ultras de la Collaboration, Abel Bonnard, poète, romancier, grand voyageur, académicien et ministre de l’Éducation nationale du maréchal Pétain, est victime d’une occultation totale. Pourtant, il fut un styliste à la plume d’une beauté poétique et classique qui, selon Yves Gandon, « porte le même sceau du rare et de l’exquis », tout autant qu’un fin psychologue et un moraliste hors pair. Il est temps de redécouvrir les œuvres de Bonnard et c’est à cette tâche que se sont attelé les éditions Pardès et l’essayiste et critique littéraire Juan Asensio. Ce dernier a, cette année, consacré une préface à Océan et Brésil (1929), sur laquelle il a accepté de revenir pour PHILITT.
PHILITT : Vous indiquez, dans votre préface, que l’œuvre du « pestiféré » Abel Bonnard est « tombée dans un trou sans fond, sans nulle possibilité de rachat » (en raison notamment de son engagement dans la Collaboration). Comment expliquer que Bonnard n’ait pas (encore ?) bénéficié d’une réhabilitation a minima, à l’instar d’un Céline ou d’un Drieu la Rochelle ?
Juan Asensio : Les raisons d’une telle occultation, scandaleuse à bien des égards, sont très probablement et d’abord d’ordre factuel, puisque, vous le rappelez, Abel Bonnard a très franchement collaboré avec le régime de Vichy, jusqu’à devenir, selon la terminologie exacte de l’époque, « ministre-secrétaire d’État de l’Éducation nationale » le 18 avril 1942, dans le gouvernement Laval. Ai-je besoin de gloser sur le crime impardonnable, pour l’intelligentsia arrogante et, surtout, n’ayant eu de cesse de vouer au Purgatoire, voire aux gémonies, des écrivains qui, pour de multiples raisons, se sont éloignés plus ou moins durablement du sot idéal républicain, que peut constituer une telle compromission ? C’est le scandale absolu, le crime irrémissible, cela : non pas de pactiser avec l’Ennemi (après tout européiste, comme l’a été le fascisme et, à sa façon disons plus teutonne, le nazisme), mais de se déclarer fermement contre la République, jusqu’à faire paraître Maurras pour un sans-culotte enragé.
Pourtant, quand on sait qu’Abel Bonnard se proposa de mettre en place, pour les collégiens et les lycéens, de même que les écoliers, un enseignement nouveau s’adressant « non à des machines qu’il s’agit de bourrer de matières, mais à des êtres vivants qu’il faut avant tout ménager », on se dit que nous tenions, bien avant l’heure, l’un de ces pédagogues de gauche férus d’un enseignement non point tant vertical, méchamment contrariant, patriarcal et logocrate pour tout dire, que prenant en compte, pour ne plus s’appuyer que sur elle, la psychologie de l’enfant, et qui ont tout ravagé, l’enseignement bien sûr, sans oublier les « enseignants » tout autant que les « enseignés » ! Las, Abel Bonnard affirme que ce souci, assez nouveau à son époque en effet et défendu avec son panache coutumier, doit représenter le socle de l’enseignement de vie qu’il s’agit surtout de fonder ; or, celui-ci, selon l’un de ses commentateurs, « ne vise pas à entretenir les jeunes dans le cocon de leurs rêves, de leurs désirs, de leurs limites psychologiques et physiologiques, mais, tout au contraire, à les armer pour leur permettre d’assumer héroïquement le destin tragique de la condition humaine »[1].
Vous avez cité Céline, évidemment ; évidemment, Céline, parce qu’il figure le cas le plus exemplaire d’une réhabilitation fulgurante, expliquée par des milliers de pages, même si les prudents continuent, quoi qu’ils disent, de disposer une pince dorée sur l’arête délicate de leur nez quand ils parcourent certains de ses textes (suivez mon regard). Céline donc, premier de cordée des pestiférés, mais aussi La Rochelle, Brasillach et Maurras, sans oublier le « gros Léon », le puissant Daudet fils qui tant aima la grande littérature, admira Proust et « lança » Bernanos en évoquant avec enthousiasme, en 1926, son premier roman, fulgurant, Sous le soleil de Satan, ou encore Rebatet salué par George Steiner qui le tenait pour l’auteur du plus grand roman du 20e siècle, Les Deux Étendards : tous ces auteurs (songeons, aussi, au maître de Bernanos, Édouard Drumont, auquel il consacra l’un de ses textes les plus puissants, La Grande Peur des bien-pensants) ont été célébrés de leur temps, condamnés, haïs, proscrits mais, tous, à des degrés et des vitesses différents je vous l’accorde, sont sortis comme Lazare du caveau où on les avait jetés à la hâte, le plus souvent en étant aidés par des lecteurs et interprètes influents, tous, donc, oui, mais pas Abel Bonnard, dont la plupart des textes restaient encore introuvables jusqu’à une date récente.
Cette éclipse, cependant, et vous-même y venez dans votre question suivante, ce ne sont pas uniquement des raisons bassement terre à terre, y compris de petites manœuvres éditoriales à l’habileté plus ou moins discrète, qui peuvent nous convaincre de sa nécessité ; il y a, il doit y avoir autre chose car, après tout, Bonnard n’a jamais été un de ces écrivains de l’ombre, comme Paul Gadenne, autre grand écrivain tombé dans un dramatique oubli, cultivant la solitude et se tenant soigneusement éloigné des raouts parisiens où se font et se défont les réputations. Ainsi, Ernst Jünger mentionne-t-il Abel Bonnard, l’académicien Bonnard, dans son Journal parisien, et un texte comme Éloge de l’ignorance déclencha énormément de réactions au moment de sa parution. Il y a autre chose, dans le cas Bonnard, que la compromission active avec la France de Pétain, donc l’Allemagne d’Hitler.
Peut-on expliquer ce désintérêt, voire ce mépris, par le peu d’enthousiasme que suscite, auprès d’un lectorat moderne, une œuvre composée en majeure partie d’essais, un genre vers lequel Abel Bonnard s’est tourné très tôt, après avoir publié deux recueils de poèmes et deux romans ?
Oui, en effet, mais uniquement en partie car, après tout, les essais ne sont pas, du moins encore, tombés dans le gouffre sans fond où nous ne voyons même plus briller la production poétique actuelle qui, certes, est bien souvent d’une prétentieuse nullité. Voyez comme un Agamben ou un Calasso sont célébrés par la presse, et je ne sache pas que leurs essais soient absolument à la portée d’un lecteur de Mathias Enard ! Je pense en fait qu’en profondeur, la disparition des textes d’Abel Bonnard des étals où la glorieuse République des lettres françaises expose ses victuailles passablement saponifiées doit moins à l’antirépublicanisme viscéral de l’auteur qu’au fait, tristement constatable dès que vous penchez un regard prudent pour ce qui passe, actuellement, selon les journalistes et les échotiers, pour de la littérature, qu’un parfait styliste comme Abel Bonnard ne peut être qu’un monstre résolument incompréhensible, un spécimen provenant moins d’un autre âge que s’exprimant dans une autre langue. Qui est désormais capable d’écrire dans une langue aussi cristalline que la sienne, qu’il s’agisse de rêver, de méditer ou de célébrer comme dans Océan et Brésil ou de rugir, comme c’est le cas des Modérés, l’une des plus pénétrantes critiques de la IIIe République ? Christian Guillet peut-être, mais j’allais oublier que cet écrivain n’était, dans son propre pays, connu que par une poignée de lecteurs.
Bonnard est surtout connu pour les Modérés[2] et l’Éloge de l’ignorance[3]. Or, ces ouvrages ont souvent été incompris. Comment peut s’expliquer ce perpétuel décalage entre l’œuvre de cet auteur et les mauvaises interprétations que l’on en fait ?
Le cas d’Éloge de l’ignorance est complexe puisqu’il a été assez souvent mal compris, en effet, et cela au moment de sa parution, en 1926 ; je cite de nouveau son commentateur, Yves Morel, qui a raison à mes yeux de remarquer que Bonnard y « instruisait le procès non tant de la connaissance, mais du culte républicain du savoir et de la prétention de notre démocratie à fonder la hiérarchie sociale sur l’intelligence, abusivement ramenée à la seule culture académique, et donc sur l’École, considérée comme le socle de la société, chargée d’opérer par une sélection fondée sur l’instruction, attestée par le succès aux examens scolaires, la ventilation des situations personnelles »[4].
Encore une fois, les raisons sont multiples qui permettraient d’analyser cette incompréhension et, si des travaux universitaires sérieux devaient être menés sur l’œuvre bonnardienne, ce que je ne puis que souhaiter, ils devraient incontestablement commencer par s’attacher à l’élucidation de ce que vous appelez un « décalage » et que je nomme une occultation, voire une occlusion. Nous y retrouverions à l’évidence les cas, comparables en bien des points, des auteurs que nous avons précédemment cités mais il y a, je l’ai dit, autre chose, plus difficile à définir, qui tient au style lui-même, infiniment souple et bien souvent remarquablement poétique, dans lequel Abel Bonnard s’exprime : or, cette langue n’est plus le français, j’insiste sur ce point et, si nous ne pouvons que nous en désoler, il faut bien admettre que nous ne pouvons sérieusement reprocher aux jeunes générations de ne pas s’y intéresser, encore moins la comprendre, si tant est, ce qui est un autre débat vous me l’accorderez, qu’un professeur un peu moins sot et veule que ses collègues, ose la proposer à l’étude durant un de ses cours ! « Le temps des livres est passé », se lamentait Léon Bloy en écrivant à son ami et maître Ernest Hello et, avec ce temps qui est à notre époque de la vitesse sans conscience ni âme, dévoré par la lèpre de la novlangue managériale planétaire, maintenu d’une façon parfaitement artificielle par l’accumulation de festivités et prix dits littéraires, celui d’une prose puissante, souple et féline comme l’échine musculeuse et électrique d’un tigre, capable de chanter le monde, mais aussi parfaitement capable de vous sauter à la gorge. La langue d’Abel Bonnard est à double tranchant : on ne célèbre que si l’on combat puisque, à mesure que l’on prend conscience du nihilisme gagnant jusqu’aux dernières parcelles de liberté, les coins les plus reculés d’un monde qui finira bien par être intégralement réifié, pixellisé, il faut tenter, en s’y opposant, de freiner l’avancée du désert.
Réactionnaire en politique et classique, au sens littéraire du terme, dans son œuvre et son style, Bonnard souffre de ces « défauts » qui valent anathème. Quels seraient, d’après vous, les raisons qui mériteraient que nous redécouvrions cet auteur ?
Nous venons je crois d’en exposer la première : une langue d’une fascinante pureté, non pas tant qu’elle se réfugierait dans la tour (abolie) de l’art pour l’art, mais parce qu’elle est capable de retrouver le grand rythme, la geste puissante du chant de l’homme qui est, pardon : qui a été et devrait être célébration. D’autres raisons existent, multiples, qu’elles soient basses ou viles (je songe au surnom infâmant qui lui fut donné) ou bien concernent la diversité des genres abordés par Abel Bonnard. Il ne faudrait toutefois pas oublier qu’évoquer Abel Bonnard peut condamner celui qui le commente à adopter la mine contrite du proscrit, tout marri, après avoir imprudemment baissé son masque, d’avoir été contaminé à son tour par la lèpre réactionnaire, ou même, comme je l’ai montré dans ma préface, par la puissante peste de l’actualité, comme disent les sots, de certaines questions pour le moins délicates. La question de la race, des races, osons ces deux mots valant plus que jamais ostracisme définitif et passe sanitaire à vie voire relégation sur l’île bienheureuse de Sakhaline, est un de ces tabous absolus, que j’ai traité en montrant qu’Abel Bonnard, du moins dans ce merveilleux texte qu’est Océan et Brésil, était bien plus écrivain que théoricien, et c’est ma foi fort heureux !
Océan et Brésil est davantage qu’un simple récit de voyage ; s’il n’est pas, comme Rome, une pérégrination au cœur même de la civilisation et de ce que le génie de l’Homme a pu bâtir et édifier au fil du temps ; s’il n’est pas non plus une quête de l’Eldorado à la Percy Fawcett ou à la Aguirre, il est bien plutôt une introspection, une exploration intérieure car, comme vous l’écrivez, un voyageur se doit d’abord d’être rêveur. Se place-t-il en cela dans la lignée romantique de la quête du Moi, de « l’espace du dedans », que Bonnard appelle également âme et qui peut rappeler cette formule d’Amiel : « Chaque paysage est un état d’âme » ?
C’est affaire de spécialistes que de déterminer si, dans le texte que nous évoquons, Abel Bonnard est, ou pas, un romantique ou, du moins, s’il se place dans le sillage du romantisme, un terme qui a tant de fois été utilisé, et accommodé à tant de sauces qu’il ne signifie plus vraiment grand-chose et n’a de toute façon plus la moindre saveur. Si nous évoquons le romantisme hugolien, bien capable, à partir de la plus minuscule graine, de recomposer tout l’univers au moyen d’un verbe qui jamais ne saura se retenir, qui juge et jauge l’univers à l’aune d’une conscience prétendant tout englober, l’extrême concision, pour le coup, la retenue de l’écriture de Bonnard, mais aussi sa volonté de se fondre dans un univers étranger, autant d’éléments qui situent l’auteur à des années-lumière des kilométriques déclamations du poète des Contemplations. Voyez aussi comme, contrairement à ce qu’il se passe dans le romantisme, qui par essence célèbre béatement, bêtement si souvent, et célèbre pour célébrer, la jeunesse des femmes, celle de la bienheureuse démocratie et le bleu si pur du ciel, le texte de Bonnard montre l’inquiétante étrangeté du monde, sa « nudité monstrueuse », par exemple lorsqu’il évoque l’océan, pas loin d’être considéré comme le tout-autre de la Création. Aussi, je pense que Bonnard, contrairement aux principaux chantres du romantisme qui n’est, en fin de compte, qu’un progressisme lorgnant vers le priapisme païen, ne croit absolument pas que le monde puisse être enserré dans la toile du langage : le monde sera toujours plus grand, à ses yeux, que ce que nous pourrons en dire, et c’est justement cela qui en fait son incommensurable prix, et mesure imparfaitement l’étendue de son horreur première.
Tant qu’à faire, nous pourrions dire qu’Abel Bonnard se montre impressionniste dans Océan et Brésil, et nous pourrions aussi sans peine mettre bout à bout plusieurs dizaines des images et métaphores qu’il utilise assez remarquablement, comme autant de magnifiques correspondances baudelairiennes. Aussi, il serait assez artificiel de le rapprocher de Maurice Barrès, et je ne pense donc pas qu’il serait possible d’en faire l’un de ces « moitrinaires » dolents, comme Léon Daudet les surnommait pour s’en moquer, capables d’écrire ces lignes de Sous l’œil des barbares : « Ma tâche, puisque mon plaisir m’y engage, est de me conserver intact. Je m’en tiens à dégager mon Moi des alluvions qu’y rejette sans cesse le fleuve immonde des Barbares ». Abel Bonnard, lui, semble ne surtout pas vouloir se conserver intact, et voyez comment il célèbre telles femmes rencontrées à Rio de Janeiro : « Leur œil, qui n’avait nullement la niaise prétention d’annoncer une âme, nageait, plein d’une ingénuité bestiale et magnifique ». Ce que cherche avant tout Abel Bonnard, c’est à s’oublier, alors que le poète romantique, en magnifiant une nature qui n’est jamais plus grande que lui, essaie avant tout de se transformer en miroir fidèle, voire en simple kaléidoscope de ce qu’il sait contenir en lui.
Toute l’attitude que manifeste l’écrivain ressemble, face à la beauté de la nature – encore, un temps – vierge de l’immense Brésil, face à celle de ses habitants – surtout les femmes – à une véritable prière. Nous pourrions même rapprocher la volonté de dissolution de son moi, que Bonnard professe dans tant de ses pages, d’une forme d’expérience mystique d’abolition de la conscience. S’il déploie son moi, un moi débarrassé, dit-il, de sa mesquinerie puisqu’il n’a plus rien d’individuel, dans le spectacle absolument anodin et pourtant fascinant de l’océan, l’extase escomptée est celle d’une dilatation au monde tout entier avant, selon un mouvement qui est constant dans Océan et Brésil, de revenir –hélas – à soi-même, car « tel est le charme de cet instant ambigu où, après n’avoir senti vivre en soi que l’homme universel, on se trouve comme en suspens au-dessus de son destin particulier, avant d’y redescendre ».
Peut-on dès lors assimiler Océan et Brésil à cette catégorie, certes fourre-tout, du récit initiatique, qui consisterait à relater un voyage à la découverte de soi, où la quête est spirituelle et non matérielle ?
Romantisme et quête initiatique sont en effet des clichés tellement jaunis que même un Sylvain Tesson renoncerait à y inscrire ses truismes sans style ! Je doute quoi qu’il en soit que le texte de Bonnard soit l’illustration des récits initiatiques, si tant est que l’on puisse appliquer cette catégorie à quelque texte que ce soit, hormis, peut-être, aux plus mauvais. Il est par ailleurs frappant de constater que Bonnard ne cherche pas son moi ; celui-ci, d’emblée, lui est donné, et donné dans sa surabondance toute moderne, comme une entité dont il faut se débarrasser. Quête inversée alors, puisque l’écrivain essaie, toutes les fois qu’il le peut, d’abolir sa si pesante conscience. Voyez ce passage, on ne peut plus clair sur la question : « on voudrait, tout débat humain terminé, jeter dans le gouffre la coupe fragile du moi, faire le dernier effort, passer de l’autre côté » (je souligne), certes, continue Bonnard, « pour renaître, à jamais calmé, dans cette plénitude et dans cette gloire ». Il y a, incontestablement, du Rimbaud dans ce rêve, chimérique évidemment, d’abolition de la conscience et de retour à une pureté de l’âme par l’onction d’un monde encore point complètement ravagé, du moins à l’époque où l’écrivain s’est rendu en terre brésilienne.
Océan et Brésil est le récit d’un dépaysement : « l’âme commence à se faire au heurt et au contraste de ces sensations ». Ce dépaysement, ce rêve préliminaire au voyage, est-il toujours possible aujourd’hui, dans un monde démystifié et désacralisé, où la moindre parcelle de nature est « instagrammable » et reproduite à l’infini, où la Nature subit « l’époque de sa reproductibilité technique » ? Plus largement, une poétique de la Nature, de l’Inconnu, est-elle toujours envisageable ?
J’en doute et il faut remarquer que Bonnard lui-même comprend, assez vite tout de même, par exemple lorsqu’il mentionne la rareté, si on la compare à celle d’une époque encore récente, des baleines croisées durant sa traversée, que le monde qu’il découvre et va découvrir est très certainement d’ores et déjà condamné. La rupture de l’homme avec la nature est parfaitement consommée aux yeux de Bonnard, et le Brésil vers lequel il part n’a probablement plus rien de la terre en grande partie vierge qu’elle était un siècle seulement plus tôt.
Il me semble que le récit des déambulations et des errances, plus ou moins savantes, sous les plumes par exemple d’un Mario Praz (Le Monde que j’ai vu), d’un François Augiéras (Une adolescence au temps du maréchal) ou même d’un Michel Vieuchange (Smara), sans oublier les tentatives plus romanesques qui résistent mieux (je songe au génial Moravagine de Cendrars, à Giono ou à Alejo Carpentier) sont, toutes, datées et, pires que datées, nous apparaissent comme étant délicieusement surannées. Où diable, dans ce cas, la poésie s’est-elle réfugiée ? Dans les vestiges de la nature qui sait, dans les ruines de la civilisation, comme nous le montrent, depuis pas mal d’années tout de même, la vogue des récits post-apocalyptiques ? Remarquons à ce titre que Bonnard évoque la possibilité que « des catastrophes générales » ne viennent « nous rendre à une autre vie », pourquoi pas moins éloignée, par nécessité et destin douloureux, de la nature. Je crains fort en tout cas que l’écrivain qui, de nos jours, partirait courant les bois en chantant le spectacle de la nature, ne soit en fait contraint d’en mesurer les dernières parcelles vierges. Pour reprendre notre exemple, Sylvain Tesson n’est assurément pas grand-chose seul face à la nature qui l’entoure, mais il est clair qu’il n’est strictement rien sans la technique (moyens de reproductibilité, médias, etc.) dont il connaît si parfaitement les rouages.
Bonnard développe une réflexion sur l’Amérique du Sud, « Paradis douteux, monde intermédiaire » marqué par la Distance qui « égare l’énergie de l’Homme » et où toute trace de civilisation humaine antique a disparu. Faut-il voir dans cette terre, comme le Fitzcarraldo d’Herzog, le dernier vestige préservé d’une Nature toute-puissante et hostile qui résiste encore à l’Homme, là où les autres continents, y compris l’Afrique, lui sont irrémédiablement « associées » ?
C’est peut-être bien, en effet, ce mirage qu’Abel Bonnard a poursuivi, même s’il me semble jouir d’un esprit puissamment analytique, qui a dû le préserver, a priori, des rêves et des mirages. Il n’en reste pas moins, nous l’avons dit, que dans ce livre, plus d’ailleurs, peut-être, qu’au cours de son voyage proprement dit, l’écrivain a cherché à retrouver la clé du festin ancien, pour le dire avec Rimbaud ; je ne sais rien, à proprement parler, de ce qu’a été le voyage lui-même car, pour être certains que ce mouvement d’extinction volontaire de la conscience a bel et bien été celui du voyageur au moment où il se tenait face à une nature souveraine, il nous faudrait pouvoir lire quelque cahier ou carnet de voyage qui lui-même, bien sûr, ne peut que mimer l’instantanéité. Celui-ci existe peut-être au fond de quelque malle oubliée, mais il est clair qu’Océan et Brésil n’est qu’une transposition a posteriori de cette courte aventure en terre brésilienne.
La « race » est le mot le plus utilisé par Bonnard après « âme ». Si certaines formulations ou idées sont susceptibles de choquer le lecteur sensible d’aujourd’hui[5], Bonnard nuance néanmoins son propos en présentant les Blancs comme une population « accablée du poids de civilisation qui pèse sur eux » et les Noirs comme une population heureuse qui affirme ses liens avec la Nature. Dans quelle mesure faire une lecture « raciste » d’Océan et Brésil constitue un contresens ?
C’est une question assez complexe, que je me suis évertué à démêler dans ma préface ; sauf à devoir répéter ici ce que j’y ai écrit, disons que l’écrivain Abel est infiniment plus sensible et subtil que le « théoricien » Bonnard, toute prudence accordée à ce mot qui, appliqué à notre auteur, n’est bien évidemment qu’une facilité que vous m’accorderez. Le contresens d’une telle lecture est indubitable cela dit, et c’est avec le plus grand empressement que, sans bien sûr jamais me citer et en ne faisant que paraphraser le texte de Bonnard, certains nigauds, à l’évidence mal intentionnés, ont fait d’Abel Bonnard le raciste qu’il n’est évidemment pas. Plus fine, à la limite, serait une lecture « racialiste » de notre livre, supposant de fait l’existence de plusieurs races, ce qui, à l’époque où l’auteur écrit son texte, ne fait guère de doutes, accordant le plus souvent – mais pas toujours ! – la primauté de la blanche sur les autres, singulièrement la noire, même s’il faut immédiatement relever, comme je l’ai fait dans ladite préface, de remarquables descriptions de la femme noire dans Océan et Brésil ! Abel Bonnard, raciste ? Que nos piètres lecteurs, pour le coup racistes jusqu’au trognon qu’ils ont pourri, m’expliquent, parmi des dizaines d’autres, telle phrase ! : « Ce qui donne à cette ville [Bahia] son caractère et son charme, c’est le passage des femmes noires. Elles ont une grâce majestueuse ». Je crois que Bonnard réserve ses flèches les plus dangereuses au mélange des races qui, selon ses dires, est toujours synonyme d’une chute, d’un entre-deux moderniste dont nul ne sort gagnant, qu’il s’agisse des Blancs ou des Noirs. Il faudrait citer une page, que je juge extraordinaire, où Abel Bonnard affirme qu’il ne suffit pas de « répudier la civilisation pour retrouver la sauvagerie » et qu’il y a « une sorte de désespoir dans l’effort que font tant de nos contemporains » pour retrouver l’innocence (prétendue) des Noirs ou de ce que l’on appelle pudiquement, de nos jours, « peuples premiers ». Jouant ce jeu, de dupes bien sûr, les Blancs fuient la conscience sans retrouver les instincts », « font la bête, enfin, sans redevenir l’animal », ces « candidats à la sauvagerie [n’étant] pas reçus », ces « danseurs et ces danseuses se trémouss[a]nt en vain, leur épilepsie mécanique » ne voulant plus rien dire.
Ne peut-on y retrouver dans ces lignes une actualité toute récente : l’(auto)culpabilisation de l’homme blanc et l’idéalisation de l’homme noir, sous couvert de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (voire l’égalitarisme, qu’il fustige d’ailleurs en parlant « d’idées chimériques ou intéressées du XVIIe siècle ») ?
J’en doute fort, et puis, de toute façon, les lectures orientées ou à thèse, celles qui prétendent plaquer des préoccupations et des orientations extérieures au texte, d’un strict point de vue littéraire, sont systématiquement les plus mauvaises, en plus, à l’évidence, d’être fausses. Qui plus est, comme nous l’avons vu, et comme vous y venez dans la question suivante, Abel Bonnard a cherché, dans ce texte je le répète somptueux qu’est Océan et Brésil, une abolition, chimérique bien sûr, de la conscience si lourde de l’Occidental, qu’il n’a pas manqué de moquer dans ses prétentions de retrouver l’Éden perdu ; jugez-en par vous-même, avec la suite de la longue citation précédente : « Tout finit dans une mystification où seul est certain l’abaissement de l’humanité », car les Noirs « n’obtiennent pas ce que nous avons dans la tête, et nous ne leur dérobons point le secret de la vie du corps », autre façon d’assurer qu’ils « n’obtiennent pas ce que nous leur avons promis et nous ne leur prenons pas ce que nous leur avons envié ».
Bonnard considère que cette quête par le Blanc d’une sorte de retour aux sources originelles de la Nature est une impasse. Il parle d’ailleurs de désespoir : « [les Blancs] restent perdus et égarés entre la société et la nature ». Faut-il en conclure dès lors que, pour lui, l’homme blanc est sorti de l’Histoire et que l’issue ne peut être qu’une lutte des races ?
Oui, je crois qu’Abel Bonnard a senti cela, qu’il n’a pu que condamner et redouter car, comme tant d’autres écrivains et penseurs de son temps, qu’ils le disent plus ou moins clairement d’ailleurs, il ne faisait aucun doute que le Progrès était indiscutablement corrélé au génie (affairiste, scientifique, technique, artistique) de l’homme blanc. Cependant, comme je l’ai dit, l’écrivain, lui, ne peut s’empêcher de songer au remarquable foisonnement qu’un tel intime mélange ne peut manquer de provoquer, et je ne parle pas du tout de « capital génétique » et autres chimères de jargon (plus ou moins) journalo-scientifique, mais d’une prolifération des destinées, souvent cachées, qu’il importe de révéler si l’on se soucie un peu, comme lui, de poésie.
Bonnard aborde la question du métissage et semble a priori critique dans sa description de la société brésilienne déjà multiculturelle. Vous indiquez néanmoins que cette vision doit être pondérée et allez jusqu’à soupçonner une certaine « fascination » pour l’homme noir, qui poserait « comme la marque d’un maître, sa large main sur le dos d’une blonde asservie ». N’est-ce pas contradictoire par rapport à l’engagement futur de Bonnard dans la Collaboration, lui qui appellera dans Pensées dans l’action à prouver à l’Allemagne « notre importance par les forces de vie que nous tirerons de nous-mêmes » ?
La contradiction ne me semble être qu’apparente, et je ne m’aventurerai jamais quoi qu’il en soit dans des explications plus ou moins loufoques d’ordre psychologique ou, bien pire, psychanalytique, mais il est assez clair que la sensibilité, le mot est encore faible : disons la complexion, voire la nature, toute féminine (et j’emploie ce terme au sens d’exquise, fine) d’Abel Bonnard l’a peut-être poussé dans une direction qu’il savait être masochiste, autrement dit la recherche d’un maître, du Maître, Noir au corps souple et délié lorsqu’il se trouve au Brésil et admire la grâce incomparable des femmes de couleur, Führer au teint chlorotique mais intraitable, dont toute la rigide pensée aura consisté à nier la finesse, la beauté, l’art et, en fin de compte, l’humanité, durant les événements que l’on sait.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
[1] Yves Morel, dans la postface qu’il donne à la réédition chez Pardès de l’Éloge de l’ignorance (2019, p. 96).
[2] Publié pour la première fois en 1936, il s’agit d’une critique du régime républicain sclérosant issu de la Révolution, et notamment du fonctionnement de la IIIe République qui agrège des « modérés », politiciens opportunistes et sans convictions.
[3] Publié en 1936, cet ouvrage remet en cause la conception du savoir académique classique de l’Instruction publique républicaine et avance l’idée qu’ouvrir tous les « palais de la connaissance », sous prétexte d’égalitarisme, n’œuvre en rien pour l’épanouissement de l’individu.
[4] Ibid., pp. 83-4.
[5] Par exemple : « les Blancs descendent vers les Noirs par le chemin de la danse ».